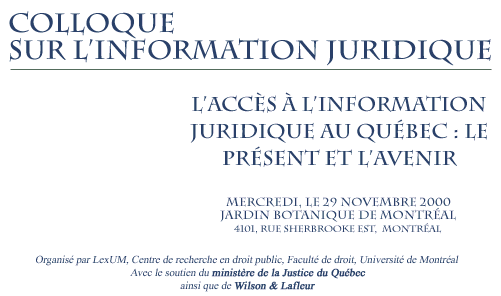
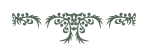
Allocution de Me Jean-Yves BRIÈRE, avocat
Auteur
Comme le titre le suggère, il s’agit d’une présentation
personnelle et non pas du point de vue commun des auteurs. Est-il besoin de préciser que je
ne dispose d’aucun mandat reconnu ou occulte pour parler au nom
d’autrui. De ce fait, mes
commentaires n’engagent que moi-même. Dès le départ, une mise en garde
s’impose, mon propos vise délibérément à susciter la controverse, voire
même la polémique. Je crois
qu’il est essentiel de lancer un pavé dans les eaux troubles de
l’information juridique et des nouvelles technologies. J’espère ainsi provoquer quelques
discussions et débats et je vous serai gré d’excuser à l’avance mes écarts
de langage.
A) Le
paradoxe
En ce début de nouveau millénaire, le monde juridique québécois vit un paradoxe des plus saisissant. D’une part, jamais la communauté juridique n’a disposé d’autant d’information, l’accessibilité à la jurisprudence est maintenant chose faite. Plusieurs milliers de décisions sont dorénavant accessibles. Nous disposons d’une vaste gamme d’outils de recherche :
-
banque de données ;
-
sites internet ;
-
répertoires spécialisés ;
-
lois annotées ;
-
compilations ;
-
etc.
Par ailleurs, malgré l’abondance des sources d’information,
selon moi, l’état de la science juridique est au plus mal pour ne pas dire
dans un état déplorable. Il
me semble que la doctrine québécoise est rongée par un mal pernicieux et
peut-être même incurable.
Pour paraphraser le philosophe Charles Taylor[1], nous pourrions dire que nous
vivons l’ère de la primauté de la raison instrumentale. Ainsi, nous avons tendance à
accroître le prestige qui auréole la technologie et qui nous fait chercher
des solutions technologiques alors que les véritables enjeux sont d’un
tout autre ordre. La
communauté juridique n’a d’intérêt que pour les nouveaux instruments de
recherche qui sont et qui seront bientôt accessibles. D’aucuns prétendent même que les
nouvelles technologies de l’information permettront à l’avocat de rendre
de meilleurs services professionnels, à coût moindre et d’accroître ainsi
l’accessibilité à la justice.
Dans un tel contexte, l’information juridique devient un
produit de consommation comme les autres et de ce fait, elle se doit
d’obéir aux implacables lois du marché. Ainsi, pour stimuler et accroître
la demande, les intervenants inondent littéralement le marché de
différents produits et malheureusement, souvent il y a des doublons. Des efforts financiers et humains
considérables sont orientés vers le développement d’une quincaillerie de
plus en plus sophistiquée et ce, au détriment, selon moi, du développement
d’une analyse critique du droit.
Je pourrais même dire en boutade, qu’aujourd’hui, il importe
davantage de connaître les décisions rendues par la Cour du Québec,
division des petites créances du district de Mingan que d’avoir une
doctrine cohérente et critique dans un domaine du droit.
B) Les effets
pervers
Cette surabondance de l’information juridique entraîne des
effets pervers considérables chez tous les intervenants de la communauté
juridique.
i)
Les
auteurs
Cette nouvelle donne et les impératifs économiques qui en
découlent, imposent généralement aux auteurs l’obligation de présenter en
vrac le maximum d’information possible. Les «best sellers» dans le domaine
juridique sont souvent des lois annotées ou des compilations de la
jurisprudence. Dans ces
ouvrages, l’auteur se doit de résumer les décisions en quelques lignes,
tout en évitant les nuances trop poussées. Cette nouvelle doctrine qui peut
être affublée du titre de «fast food» juridique, interdit presque à
l’auteur de présenter les tenants et aboutissants de chacune des
décisions. De plus, elle lui
interdit également une approche historique et critique des décisions. Finalement, de crainte de se faire
reprocher de ne pas avoir repéré et répertorié une décision, l’auteur ne
procède guère plus à une sélection de la jurisprudence. Il me semble faux de prétendre que
toutes les décisions doivent subir un traitement unique et identique. Dans un tel contexte, la doctrine
se limite souvent à de simples résumés de lecture. Les auteurs, comme bien
d’autres d’ailleurs, confondent quantité et qualité. Sous le diktat des lois du marché,
il est difficile pour un auteur de faire un ouvrage qui va au-delà de
l’information brute et qui dégage l’état du droit de façon précise,
claire, cohérente et par-dessus tout, d’un point de vue critique dans un
domaine particulier.
ii) Les
plaideurs
La raison instrumentale influence également la façon de
travailler des plaideurs.
Certes, les instruments modernes de recherche accroissent
sensiblement la rapidité de l’opération de recherche mais l’abondance des
sources d’information nécessite des recherches de plus en approfondies et
par voie de conséquence, beaucoup plus coûteuses. Il me semble difficile de
prétendre que la technologie abaisse le coût des services juridiques, il
me semble qu’au contraire, les coûts ne cessent de croître. De plus, comme les auteurs ne
sélectionnent à peu près plus les décisions, le plaideur se doit de lire
une masse considérable de décisions qui ne sont souvent, avouons-le, que
des illustrations particulières d’un principe qui est par ailleurs,
souvent bien connu.
Dans ce nouveau contexte, de peur d’oublier une décision, le
plaideur se présente au tribunal armé d’une liasse de documents de plus en
plus volumineuse. C’est alors
que les deux juristes se livrent à une véritable guerre des onglets. Les arguments s’étirent et le
temps des plaidoiries également.
Malheureusement, il faut le dire, dans bien des cas, la majorité de
ces autorités sont peu pertinentes voire carrément inutiles.
iii) Les magistrats
Les magistrats n’échappent pas à cette nouvelle tendance, eux aussi sentent l’obligation de distinguer leurs décisions de celles qui furent citées par les procureurs. De ce fait, il arrive régulièrement que les décisions des tribunaux ressemblent à de véritables thèses de maîtrise comportant de nombreuses notes infrapaginales. Ainsi, en ce milieu, on semble également confondre quantité et qualité ou lourdeur et profondeur. Les décisions sont souvent diluées de considérations accessoires et non nécessaires qui ont pour effet de rendre périlleux l’objectif de toute décision, soit la motivation. Un tel procédé réduit la force de conviction de cette troisième plaidoirie. Au terme de la lecture de plusieurs décisions, il est parfois difficile, après tant de digressions, de comprendre la justesse de la conclusion imposée d’autorité.
Conclusion
En terminant, une dernière précision, je ne suis pas contre le développement des nouvelles technologies, par contre, je suis farouchement opposé à la seule primauté de la raison instrumentale. Je crois que collectivement, nous devons cesser de confondre quantité et qualité et qu’il est impératif d’investir davantage pour soutenir les auteurs au lieu de miser sur la seule technologie. À moins d’un sévère coup de barre et ce, à très court terme, il est à craindre que la seule doctrine qui puisse survivre au Québec soit comme l’alimentation rapide, c’est-à-dire, sans aucun goût, odeur ni couleur.
[1] CHARLES TAYLOR, Grandeur et misère de la modernité, Montréal, Bellarmin, 1992, p. 17.