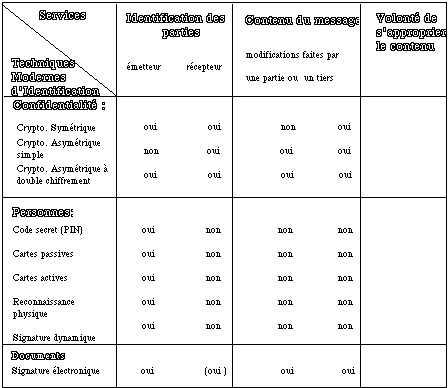

Quelques réflexions[*] de droit continental européen
Montréal
1. "Verba volent, scripta manent" : l'euphorie
D'un ordinateur à l'autre, télécommunication aidant, les données électroniques volent ... en toute sécurité direz-vous ! et je vous crois volontiers ... des logiciels dits de cryptographie, des logiciels de contrôle enferment mieux qu'un coffre bancaire les messages d'ordinateur. Imiter une signature manuscrite n'est-il pas plus facile qu'imiter une signature électronique ?
A l'argument de la sécurité technique s'ajoutent les impératifs de la gestion économique des entreprises et des administrations : le papier circule lentement, sa conservation est coûteuse ... Pourquoi se priver des avantages qu'apportent les capacités de nos ordinateurs et de nos réseaux ?
Enfin, la rareté voire l'inexistence du contentieux permet de conclure à l'excellence de notre système juridique et de ses juges, à la parfaite adaptation du droit aux réalités technologiques nouvelles.
Existe-t-il dès lors aujourd'hui une question à résoudre ? Ne suffit-il pas pour achever de s'en convaincre d'entamer l'hymne à la liberté en l'occurrence contractuelle pour déclarer close la question [1] ?
2. Les raisons d'un désenchantement
Tout d'abord, la survie de quelques juges irrévérencieux pour le dieu ordinateur fait craindre aux fournisseurs de services N.T.I.C. que le vide juridique ne soit en ce domaine synonyme non d'absence, mais d'ignorance et d'imprévisibilité [2].
Ensuite, la convention a mauvaise presse devant les prescrits comptables, fiscaux ou de sécurité sociale, que rappellent volontiers les administrations dans leurs relations avec les administrés [3].
On ajoutera que la multiplication des réseaux ouverts dans la mesure où ils permettent la conclusion de transactions entre des personnes en relation d'affaires occasionnelle, rend impraticable le système d'aménagement conventionnel du droit de la preuve et empêche dès lors d'y voir une solution universelle et suffisante.
Enfin et surtout au moment où les législations reconnaissant la prééminence de l'écrit libéralisent le droit de la preuve en matière de transactions portant sur de petits montants [4], les mêmes législateurs dans le cadre de dispositions protectrices des consommateurs [5] interdisent l'utilisation de clauses relatives à la preuve [6] et illustrent la formule de Lacordaire : "C'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui libère".
3. Les déséquilibres nouveaux
Que reproche-t-on en définitive à l'ordinateur ou plus largement aux N.T.I.C. ? Rien si ce n'est que leur utilisation provoque de nouveaux déséquilibres que Madame GALLOUEDEE- GENUYS [7] résume comme suit : "En bref, les déséquilibres du fait des nouvelles technologies de l'information, de leur "nature", de leur utilisation et de leur appropriation apparaissent :
- du fait de la médiatisation de la relation des parties et du passage obligé par un intermédiaire technique (machine, fil, antenne, logiciel ...), "la boîte noire";
- du fait que cette médiatisation impose des accès, des stockages, des traitements organisés et contrôlés par une seule des parties : celle qui possède ou dispose des outils technologiques; les cas d'égalité de partenariat ne sont pas visés ici;`
- du fait que cette partie est en position dominante, qu'elle impose sa volonté par des conventions préparées par elle-même, de véritables contrats d'adhésion le plus souvent, et qu'elle en tire bénéfice;
- du fait que ce recours à des moyens et modes relationnels nouveaux par des personnes extérieures au système, mais souvent soumises à forte pression pour s'en servir, n'est pas toujours bien compris, ni ses modes d'emplois, ses règles et ses conséquences;
- du fait que la simplicité de l'accès, l'absence d'interface humaine et la distanciation des rapports ne permettent pas toujours, ni à tous les utilisateurs finaux d'apprécier exactement les situations dans lesquelles ils interviennent ...".
Dès lors, cette conclusion du monde économique et financier, consignée par l'observatoire juridique français des Technologies de l'Information : "On sait les raisons de ceux qui ne font pas confiance au juge et veulent voir lever par des prescriptions rigides l'incertitude sur la qualité probante de preuves issues des nouvelles technologies. Ils refusent l'insécurité de la souplesse par peur du juge mais aussi d'eux mêmes et de leur libre choix : ils renoncent à faire la "loi des parties" pour demander au "grand législateur" d'intervenir".
"Ce qu'on doit faire, on le fera, mais qu'on nous le dise".
I. LES CONCEPTS DE BASE
4. Ecrit - Signature - Copie fidèle : trois concepts clés
Il est banal de rappeler que le droit de la preuve organise la protection -certes partielle- de celui vis-à-vis duquel on se prétend créancier. Face à son créancier, le prétendu débiteur opposera l'absence ou le défaut de qualité du "support" fondant une telle réclamation; il se prévaudra de l'absence d'une adhésion au contenu de ce support ou enfin établira la fidélité insuffisante réelle ou respectée du mode de conservation du support à l'original.
En d'autres termes, trois concepts organisent en deux temps le droit de la preuve : les notions de "support" ou "d'écrit", d'une part, d'"adhésion" ou "signature", d'autre part, éclairent la preuve de la conclusion d'un contrat; celle de copie fidèle, sa conservation.
Le premier propos est donc d'examiner si ces concepts supportent le qualificatif "électronique".
5. La signature électronique existe-t-elle ?
Le vocable de "signature électronique" est fréquemment utilisé, est-il acceptable juridiquement ? Certes, la jurisprudence de nombreux pays (Belgique, Danemark, Portugal, Allemagne) maintient l'exigence d'une signature manuscrite.marque par laquelle une personne révèle sa personnalité aux tiers. Une conception plus fonctionnelle de la signature s'écarte d'une vision aussi étriquée. Il s'agit, d'une part, d'identifier l'auteur du document et, d'autre part, d'indiquer la volonté de cette personne d'adhérer au contenu de l'acte auquel la signature se réfère et sur lequel elle a été opposée, certains procédés d'identification et d'authentification électroniques doivent être reconnus comme de véritables signatures [8].
La signature électronique consiste en une série de caractères apposée à la fin d'un document. Elle est élaborée selon des procédés mathématiques (cryptographiques) et reprend un résumé codé du message, des informations relatives à la date et à l'heure d'envoi du message, à l'identité de l'expéditeur et du récepteur, ... Si le message envoyé arrive donc chez une tierce personne, celle-ci ne pourra en prendre connaissance dans la mesure où elle ne dispose pas du code permettant de le déchiffrer. De même, si une modification a été effectuée postérieurement à l'envoi par une personne non autorisée, il sera possible de la détecter dans la mesure où une discordance existera entre la signature électronique et le document envoyé.
6. L'écrit électronique ?
La seule définition légale de l'écrit est celle du code de procédure allemand [9]; le terme "écrit" recouvre toutes "les formes d'expression directement lisibles" [10], qu'elles soient sur support papier, optique, magnétique, etc. Une telle définition confirmée par d'autres jurisprudences [11] répond au souci de rencontrer les multiples et variés procédés de stockage et transmission de données. En d'autres termes, il est important de reconnaître comme écrit, "tout document reproduisant la volonté d'une personne par des signes susceptibles d'être lus, grâce à un procédé approprié" et non seulement l'apposition sur papier de signes.
7. La nécessité de la reconnaissance légale de la notion de "copie fidèle"
La distinction "original-copie" répond non seulement aux besoins soulevés par l'archivage, c'est-à-dire la conservation à plus long terme des données mais également à l'exigence de tenir compte de l'intrinsèque volatilité des documents électroniques transcrits instantanément d'une mémoire à l'autre pour les besoins de la transaction voire par les seules nécessités du système. En d'autres termes, en matière de document électronique, il est difficile de distinguer l'original de sa copie et l'opprobre lancée par quelques législations sur les copies soulèvent difficultés [12]. La nécessité de reconnaître à la copie "fidèle" [13] la même force probante que l'original répond à cette inquiétude exprimée par les entreprises dans leurs relations tant avec leurs clients et leur fournisseurs qu'avec les administrations.
La notion de copie se trouve donc à préciser : "constitue une copie, le document reproduit sur support d'information provenant de l'enregistrement d'un écrit sous signature privée" et le qualificatif "fidèle" de même. Une copie est réputée fidèle lorsque les originaux ont été enregistrés selon des critères de sécurité [14] fixés par l'autorité, c'est-à-dire des critères d'intégrité et le cas échéant de durée et de confidentialité.
8. L'équivalence de principe
Redécouvrant le sens de deux notions : la signature et l'écrit, appelant de nos voeux, la reconnaissance de la notion de copie fidèle, notre propos poursuit le double but suivant.
Négativement, il s'agit de démonter la non étrangeté des documents électroniques aux concepts traditionnels du droit de la preuve. En d'autres termes, point n'est besoin de législations aux concepts nouveaux mais plutôt d'approfondir les prescrits traditionnels dans le respect de leurs finalités;
Positivement, est proclamée l'équivalence de principe entre les nouveaux modes de preuve et ceux traditionnels, équivalence de principe qui exclut tout rejet a priori par le juge du document électronique.
Il nous apparaît donc que vis-à-vis de ce dernier, n'est en aucune manière justifiée la position du Conseil de l'Europe [15] qui pour ouvrir à la preuve électronique le chemin des tribunaux, recommande la suppression dans tous les pays de l'exigence d'un écrit. Au contraire, la suite de notre propos tend à démontrer l'intérêt de l'utilisation des concepts traditionnels du droit de la preuve : cette utilisation conduit à poser quelques exigences ou "critères" de recevabilité du document électronique comme écrit signé ou comme copie fidèle.
Notre critique vise également les réformes luxembourgeoise et française. Ces deux réformes visent essentiellement à préciser les types d'impossibilité auxquelles l'article 1348 du Code civil fait référence. Faut-il le rappeler, l'article 1348 a pour effet de libérer le juge de la contrainte que constitue l'article 1341 du Code civil lorsqu'il y a eu impossibilité pour les parties de constituer un écrit. Comme c'est encore le cas en Belgique, le texte original de l'article 1348 des Codes civils luxembourgeois et français ne précisait pas si l'impossibilité de se procurer la preuve écrite d'une obligation était matérielle ou morale. C'est aujourd'hui chose faite et la distinction opérée permet de dissiper tout doute à ce sujet. L'absence de preuve écrite découlant de l'usage de nouveaux modes de transfert de données peut constituer une impossibilité matérielle et dès lors tomber sous le champ d'application de l'article 1348
Cette réforme de l'article 1348 du Code civil nous paraît regrettable à plusieurs égards. Il est tout d'abord dommage que l'adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies ait été réalisée par le biais de cette exception qui dispense de toute preuve écrite. Il est à craindre maintenant que l'extension apportée à l'article 1348 ait pour effet de vider l'article 1341 du Code civil de son contenu et qu'un régime de liberté probatoire, semblable à celui que nous connaissons en matière commerciale, soit ainsi instauré.
Il nous paraît ensuite inacceptable de dire que l'usage des nouvelles technologies entraîne l'absence de preuve écrite. Lorsqu'il y a échange de données, même informatisé, il y a écrit ou du moins, il y a possibilité de se constituer un écrit, non pas un écrit appréhendé au sens restrictif du terme, mais bien un écrit dans une perspective évolutive.
Enfin, il y a une contradiction logique à admettre que l'utilisation de l'informatique constitue un cas d'impossibilité de se procurer un écrit. En l'occurrence, l'impossibilité n'existe pas, c'est volontairement que les acteurs ont décidé de ne point recourir à l'écrit papier.
II. DE L'EQUIVALENCE DE PRINCIPE A LA FIXATION DE CERTAINS CRITERES DE SECURITE
9. De l'assertion à la réalité
L'équivalence de principe ne conduit à une équivalence réelle que si les modes d'élaboration ou de conservation des documents électroniques répondent dans les faits aux exigences déduites de la fonctionnalité même des concepts traditionnels du droit de la preuve. Ainsi, l'écrit, avons nous dit, est un support directement lisible. En d'autres termes, son contenu doit être accessible à la compréhension humaine et pouvoir être porté à la connaissance de celui à qui on l'oppose ! Tout document électronique ne répond pas à cette exigence. Ainsi, se conçoit que seuls certains documents répondant aux exigences fonctionnelles de l'écrit seront des écrits. Le même raisonnement vaut pour la signature et la copie fidèle.
Le Conseil de l'Europe dans la recommandation déjà évoquée définit très strictement les conditions par lesquelles une copie pourra être dite fidèle. Les travaux de Madame ANTOINE et de Monsieur ELOY ont permis également de mieux cerner les qualités requises de l'écrit électronique et de la signature électronique. Nous reprendrons en grande partie les conclusions de leurs travaux.
10. Du document électronique à l'écrit [16]
S'il paraît nécessaire d'étendre les notions d'écrit et de signature, il semble tout aussi indispensable de prévoir la possibilité d'arrêter des critères de sécurité ayant trait à la notion de document. Ces critères supposent la disponibilité du document sur support informatique ou papier et préviennent les risques au niveau de la fiabilité et de l'intégrité.
- "Le document doit être inaltérable
Parler d'inaltérabilité d'un document, c'est également parler de la fraude. Alors que sur les supports papier, celle-ci est assez facile mais très rapidement remarquée ("gratter" et/ou recopier une information laisse des traces), la fraude sur un support informatique passe souvent inaperçue et ne peut presque jamais être détectée a posteriori.
Préserver le caractère inaltérable d'un document nécessite de conserver celui-ci inchangé à la fois dans son contenu ainsi que dans sa forme.
Pour assurer l'inaltérabilité du document dans son contenu (c'est-à-dire pour préserver le sens et le caractère authentique du document original), il faut que l'émetteur et/ou le récepteur ne puissent modifier le contenu du document à l'insu de l'autre partie (ainsi, la modification d'un texte n'entraînerait-elle pas modification de la signature). De plus, il faut qu'un tiers ne puisse pas interférer dans les relations émetteur-récepteur en modifiant le contenu du document à l'insu des parties.
L'on fait référence ici aux différentes techniques d'authentification des documents permettant de garantir d'un point de vue logique l'intégrité des données.
- Le document doit toujours demeurer lisible grâce à un procédé approprié
Les documents sur papier remplissent directement cette condition par le simple fait qu'ils sont rédigés dans un langage (vocabulaire et grammaire) et dans une symbolique graphique (écriture) accessible à la compréhension humaine. Tel n'est plus le cas des informations reprises sur support informatique : elles y sont codées et se trouvent donc sous une forme illisible. Il est par conséquent nécessaire d'avoir recours à un intermédiaire "approprié" qui présentera les données stockées sous une forme c compréhensible par l'homme. Cette nouvelle phase suppose différentes manipulations des informations et présente donc un danger pour la sécurité.
De plus, il est nécessaire de se poser la question de l'évolution de la technique informatique en matière de stockage de données. Pourra-t-on garantir qu'un support utilisé actuellement sera toujours lisible ultérieurement (compte tenu de l'évolution technique) et comment peut-on, au surplus, assurer le suivi de cette évolution au sein d'une implantation informatique particulière ?
- Le document doit être bien identifié en lieu (nom et adresse des correspondants) et en temps (date de rédaction, d'envoi, de réception,...).
L'informatique permet un contrôle précis des date et heure de rédaction, d'envoi ou de lecture d'un texte. De même, certaines techniques d'identification et de signature électronique permettent de "lier" de façon indissociable un texte à son auteur. Ce critère de sécurité permet de garantir qu'un document n'a été écrit que par la personne qui se prétend en être l'auteur, au moment indiqué. Une telle garantie prévient les fraudes liées à l'usurpation de nom et aux retards de courrier".
11. De la signature électronique à la signature
"Les différents critères de sécurité portant sur la signature présentés ici sont valables pour des méthodes tant manuelles qu'informatiques.
- La signature doit permettre l'identification du signataire [17]
La relation "signature - signataire" doit être unique et absolue : à une signature donnée, on ne pourra associer qu'un et un seul signataire.
Toutefois, en ce qui concerne les documents informatiques, la vérification et l'adhéquation entre la signature et le signataire ne peut plus être réalisée de façon visuelle comme c'est le cas pour la signature manuscrite. La vérification de la correspondance 'texte-signature" est donc réalisée, non plus par une personne humaine, mais par des moyens informatiques appropriés (programmes, ...)...
- La signature ne peut être "générée" que par l'émetteur du document. Elle doit être infalsifiable et inimitable
La signature manuscrite est "générée" par le signataire de telle sorte qu'elle soit infalsifiable et inimitable. En pratique, la possibilité de fraude est assez importante pour les signatures sur support papier. D'autres types de signature présentent un plus haut degré de sécurité. Prenons le cas de la signature électronique.
Une signature électronique sera établie en fonction du contenu du document, d'informations secrètes uniques et propres à l'émetteur, ainsi que des informations communes à l'émetteur et au destinataire pouvant être publiques (par exemple : algorithme de signature utilisé, paramètres éventuels, ...).
A. Les informations permettant de "générer" une signature électronique doivent être suffisantes pour pouvoir la valider mais insuffisantes pour pouvoir la falsifier. La méthode de signature et d'authentification doit par conséquent être robuste, de telle façon qu'il soit pratiquement impossible de trouver le moyen de signer à la place de quelqu'un d'autre.
B. La "notarisation" des signatures (ou encore le dépôt des méthodes de signatures chez un "notaire électronique") améliore la sécurité du système dans la mesure où elle assure aux entités (émetteur et récepteur), grâce à un tiers auquel elles se fient, l'intégrité, l'origine, la date et la destination des documents. Le tiers doit acquérir les informations nécessaires par des communications protégées et les conserver, ceci sans toutefois avoir accès au contenu des communications. De plus, la signature doit être négociable entre les parties sans qu'il soit nécessaire d'impliquer un tiers (même en cas de "notarisation", le tiers ne devrait pas pouvoir avoir accès au secret).
- L'apposition de la signature doit être significative et se faire sur le document même auquel la signature se réfère. La signature doit y rester attachée de façon permanente et indissociable pendant le transport du document.
Il faut tout d'abord que l'acte de signature soit significatif. Cela revient à dire que le document doit être lisible et compréhensible et que la signature doit exiger une démarche volontaire de la part du signataire. Cette condition n'est pas nouvelle et est assez facilement réalisable tant au niveau du document papier "classique" qu'au niveau du document "informatique".
Par ailleurs, la signature doit se faire sur le document auquel elle se réfère. Cette condition ne pose aucune difficulté pour les documents de type papier. En effet, la signature apposée sur le papier n'est valable qu'au regard du contenu de celui-ci et n'est pas effaçable. Pour respecter la condition selon laquelle l'apposition de la signature doit être faite sur le document même, il faut que, physiquement, le document et sa signature ne fassent qu'une seule unité de stockage sur le support informatique. Or tel n'est pas toujours le cas. En effet, il se pourrait que pour des raisons de calcul, de gestion ou de sécurité, les signatures aient besoin d'un niveau de privilège supérieur à celui donné aux documents (un privilège dans le cadre d'un système informatique est un moyen de protection des données qui représente le droit pour une personne à connaître des informations contenues dans ce système). Par conséquent, leur stockage aurait lieu sur différents supports et ce, malgré les liens logiques les unissant.
Peut-on en conclure que la signature électronique n'est pas liée au document signé;? La réponse est négative et ce pour deux raisons. La signature électronique, par exemple, est par définition "accolée au document" auquel elle se réfère et elle est "établie en fonction du contenu du document". Par conséquent, et bien qu'elle puisse en être distincte physiquement, la signature demeure dépendante logiquement du document.
Pour adapter la condition d'attachement permanent et indissociable de la signature, aux "documents informatiques", il faut utiliser des méthodes permettant de garantir l'inaltérabilité des documents. Dès lors, l'ajout, la modification ou la suppression d'une signature demeurera impossible.
- Il ne doit y avoir aucun délai de temps ni de lieu entre l'acceptation du contenu du texte par le signataire et l'apposition réelle de sa signature.
Cette condition a essentiellement trait à l'établissement de la signature. La personne signataire ne peut signer valablement un document que s'il se trouve en sa possession et que l'apposition de sa signature est significative.
Une telle exigence empêche par conséquent la signature de type automatisé et/ou programmé et impose la présence et l'intervention d'une personne humaine dans tout acte de signature. Cette condition interdit donc la présence de tout intermédiaire (humain ou autre) entre le signataire et le document à signer Ceci n'empêche nullement la signature au sein d'un réseau télématique. En effet, lorsqu'une personne décide par exemple de conclure un contrat d'achat par voie télématique, le contrat parvient chez l'acheteur via le réseau depuis le centre serveur du vendeur. De par la définition de la signature, il est impossible pour le serveur, l'acheteur, le vendeur ou pour quiconque se trouvant sur le réseau de modifier le document signé. Cela confirme l'idée que la condition de présence du signataire et du document signé n'a besoin que d'être vérifiée à un seul moment du traitement du document : l'acte de signature.
12. La "copie fidèle" électronique
Analyser le caractère "fidèle" de la copie d'un document, c'est aussi faire attention aux problèmes relatifs aux méthodes de rajeunissement des supports, aux moyens de prolongation de la durée de vie d'un support, aux défauts et qualités des supports papier ou informatiques.
Notre propos sur ce point se bornera à paraphraser les principes même de la recommandation du Conseil de l'Europe.
Les documents conservés sur support d'information doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être l'enregistrement fidèle et durable du document original à l'origine de l'enregistrement par encodage ou par reproduction; par enregistrement via reproduction, on entend la conservation d'un document original à la fois dans sa forme graphique et dans son contenu. Par enregistrement via encodage, on entend la conservation d'un document original uniquement dans son contenu. Est réputée durable toute représentation indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. Celle-ci est d'ordre physique lorsqu'elle est effectuée au niveau du support physique du document informatique ou logique lorsqu'elle a lieu au niveau des méthodes informatiques utilisées pour représenter le document.
b) être effectués de façon systématique et sans lacune;
c) être effectués selon des instructions de travail conservées aussi longtemps que les reproductions ou enregistrements;
d) être conservés avec soin, dans un ordre systématique, et être protégés contre toute altération.
Les règles suivantes doivent être respectées lors de l'enregistrement du document original :
a) les travaux doivent être surveillés par le détenteur ou le dépositaire du document ou par une personne désignée comme responsable de l'opération; celle-ci peut être appelée à témoigner de la façon dont les enregistrements ont été effectués;
b) l'enregistrement doit permettre de déterminer l'ordre de reproduction et/ou d'encodage;
c) les diverses phases de l'enregistrement doivent s'opérer strictement selon le schéma arrêté aux instructions de travail visées au 1deg.c;
d) l'enregistrement doit faire l'objet d'un procès-verbal conservé avec l'enregistrement. Il doit reprendre les indications suivantes :
- identité de l'opérateur responsable;
- nature et sujet des documents;
- lieu et date de l'opération;
- défaut éventuels constatés pendant l'enregistrement;
- déclaration, signée par l'opérateur responsable, que les documents ont été enregistrés de façon complète, régulière et sans altération; cette déclaration peut faire l'objet d'un enregistrement à la suite des documents enregistrés;
e) l'enregistrement doit être parfaitement lisible par un moyen approprié et techniquement satisfaisant; la fidélité de la reproduction et/ou de l'encodage doit être vérifiée avant la destruction de l'original;
f) l'enregistrement doit être toujours disponible pour consultation par les personnes légalement habilitées à avoir accès aux données qui en ont fait l'objet.
Les règles suivantes s'appliquent aux systèmes de traitement de documents informatiques :
a) les systèmes doivent comporter les sécurités nécessaires pour éviter une altération des enregistrements;
b) les systèmes doivent permettre de restituer à tout instant les informations enregistrées sous une forme directement lisibles.
Les règles suivantes s'appliquent aux programmes de traitement de documents informatiques :
a) la documentation de programme, les descriptions de fichiers et les instructions de programme doivent être directement lisibles et tenues soigneusement à jour sous la responsabilité de la personne qui en a la garde;
b) les documents définis à l'alinéa a) ci-dessus doivent être conservés sous une forme communicable aussi longtemps que les enregistrements auxquels il se réfèrent.
Si pour une raison quelconque, les données enregistrées sont transférées d'un support informatique à un autre, la personne responsable doit démontrer leur concordance.
CONCLUSION
13. Le lecteur qui a bien voulu nous suivre jusqu'ici tirera avec nous les conséquences d'une démarche qui "colle au droit de la preuve, à ses principes, à ses finalités" [18]. Pour ma part et sans prétendre être exhaustif, j'en vois six :
- La démarche prend en compte le déséquilibre fondamental qui existe entre les deux parties à une transaction électronique du fait qu'une seule des deux parties organise et contrôle les accès, les stockages, les traitements nécessaires à la constitution ou à la conservation des parties. En effet, il est fondamental que celui qui se prévaut d'un document électronique comme preuve d'une transaction soit tenu de prouver la sécurité du système, c'est-à-dire la fiabilité, l'intégrité et la disponibilité de celui-ci.
- A la preuve de la qualité du système, s'ajoute dans les relations entre commerçants et consommateurs pour que l'opération puisse être considérée comme l'émanation de la volonté de celui qui l'utilise, l'obligation à charge du maître du système que l'utilisateur soit parfaitement informé des conséquences de l'utilisation du système et des risques qu'il encourt du fait de cette utilisation. Certes à la responsabilité du maître du système d'informer l'utilisateur, répond l'obligation de ce dernier de s'informer des conséquences de la participation au système.
- L'exécution par le responsable du système de ces obligations doit amener le juge qui devra sans doute s'entourer d'experts à reconnaître, le cas échéant, comme écrit signé les documents produits par les N.T.I.C. et à leur accorder la recevabilité et la force probante que la loi assigne à cet écrit signé, ni plus ni moins.
- Ce faisant, la démarche proposée n'introduit pas de réglementation de la preuve particulière à l'informatique. Elle suppose simplement que les notions d'écrit et de signature soient définies indépendamment d'un support matériel et par seule référence à leurs fonctionnalités.
- L'approche par des prescrits légaux généraux de préférence à une loi technologique particulière permet de ne pas figer à un état de la technique la recevabilité des documents électroniques.
- En matière d'archivage, se prévaloir de la conservation sur un support électronique oblige à démontrer que l'opération s'est faite conformément aux exigences de fidélité, de durabilité et d'irréversibilité. Responsabilité lourde, preuve difficile à rapporter quand on connaît les dangers de fraude et d'atteinte à l'intégrité des documents lors d'un archivage, d'un transfert de support, etc. Ici également, des normes réglementaires prises en exécution de la loi permettent à cette dernière de garder son caractère général et aux entreprises de bénéficier par ces normes de la sécurité juridique.
Qu'ajouter encore ?
Le débat : "Droit de la Preuve et N.T.I.C." ne fait que commencer : hier, phénomène isolé, les transactions par ordinateur deviendront demain le lot quotidien, tant dans les relations entre professionnels, que dans les conventions entre particuliers, entre particuliers et professionnels, particuliers, professionnels et administrations. Demain, on enverra sa déclaration fiscale par ordinateur, on réservera par ordinateur sa place au restaurant et son billet d'avion.
La solution du débat ne peut être la consécration du fait technologique. Elle appelle chacun à prendre ses responsabilités :
- les utilisateurs de tels services à prendre conscience de la portée de leurs engagements et à respecter les normes de sécurité raisonnables, qui leur sont proposées (p. ex. avertir sans tarder en cas de perte de la carte d'accès);
- les entreprises à informer les utilisateurs des risques liés à l'utilisation des systèmes et à offrir des systèmes de qualité tant pour la production que pour la conservation de documents électroniques;
- les administrations à définir entre elles mais également avec les entreprises et les citoyens de nouveaux modes de dialogue;
- les organes de normalisation à proposer des normes de sécurité soit sectorielles, soit générales en ayant égard aux intérêts de chacun;
- les juges à se forger, experts aidant, leur intime conviction.
Dans ce débat, l'Université avait également à prendre ses responsabilité. Merci de nous avoir aidé à le faire.
- M. ANTOINE, M. ELOY, J.F. BRAKELAND, Le droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information, Cahiers du CRID ndeg. 7, 1991, Ed. Story-Scientia.
- I. de LAMBERTERIE, La valeur probatoire des documents informatiques, Probat, Rapport établi pour la Commission européenne, Sept. 1990 (document non publié)
- X. LINAUT de BELLEFONDS, Informatique et droit de la preuve, Travaux de l'AFDI, Ed. des Parques, 1987.
- TEDIS, Situation juridique des Etats membres au regard du transfert électronique de données, Rapport établi par le cabinet Lodomez-Crouquet, 1989.
- F. GALLOUEDEE-GENUYS (sous la direction de ...), Une société sans papier, nouvelles technologies de l'information et droit de la preuve, Paris, La documentation française, 1990.
[1] Le principe de la liberté contractuelle en matière de preuve et du caractère non contraignant des dispositions légales en la matière semble être accepté par la plupart des pays (à cet égard, M. ANTOINE et alii, p. 50 et s.. Cf. toutefois, les discussions en Grèce) : "En principe, les règles sur la prééminence de la preuve écrite n'intéressent pas l'ordre public. Les parties peuvent renoncer à l'invoquer; elles peuvent conclure à ce sujet toutes conventions" (P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, RCJB, 1975, ndeg. 122, p. 170).
[2] On connaît l'attendu de la célèbre décision du tribunal de Sète (9 mai 1984, D.S. 1985, II, 359) cassée par la suite : "Que la preuve de l'obligation de rembourser ne peut résulter que de la signature (...) qui émane non de celle à qui ou l'oppose, mais d'une machine dont la demanderesse a libre et entière disposition".
Toujours en France, la décision du tribunal administratif de Rennes du 28 février 1990 qui estime que "l'inscription d'un candidat à un concours de recrutement par le moyen de Minitel ne peut être regardée que comme une intention qui nécessite de se voir confirmée par une manifestation non équivoque de volonté".
[3] "Certes en ce domaine, certains Etats membres ont soit fait preuve de tolérances administratives (Belgique), soit revu leur législation de façon à admettre la tenue d'une comptabilité exclusivement par informatique ainsi que la conservation des documents ou informations servant de support à cette comptabilité ou à la déclaration fiscale sur des supports informatiques (Luxembourg, Allemagne), soit admis l'une ou l'autre de ces possibilités au terme d'accords passés avec l'Administration (Italie)" (TEDIS, op.cit., p. 254).
[4] Ainsi au Luxembourg, en Belgique, en France. On notera que les régimes où domine le système de la preuve libre (ainsi, les systèmes néerlandais et italiens, celui de "Augenschein" en Allemagne ou le système de la preuve morale au Danemark ou dans les trois pays cités en droit commercial) ne constituent pas une solution adéquate puisque si la preuve par document sorti d'ordinateur est comme tout autre document recevable, c'est au juge, en toute liberté, à en déterminer la force probante. Ainsi, on note une décision de la cour de cassation néerlandaise de 1987 (16/10/1987) par laquelle les juges considèrent que dans le cadre de l'évaluation de la force probante d'enregistrements magnétiques, il faut tenir compte du fait que les données qui y sont consignées peuvent être facilement manipulées.
[5] Ainsi, les lois de protection des consommateurs néerlandaise, française et belge. A noter également, le cas portugais (art. 345 du code civil) qui interdit les conventions excluant les moyens de preuve légaux.
[6] Cf. la clause fréquente dans les conventions relatives aux cartes électroniques bancaires : "l'enregistrement conservé par la Banque constitue un procédé de preuve contraignant et suffisant".
[7] Op.cit., p. 64 et 65.
[8] Cf. le tableau élaboré par M. ANTOINE et M.
ELOY, in M. ANTOINE et Alii, op.cit., p. 63.
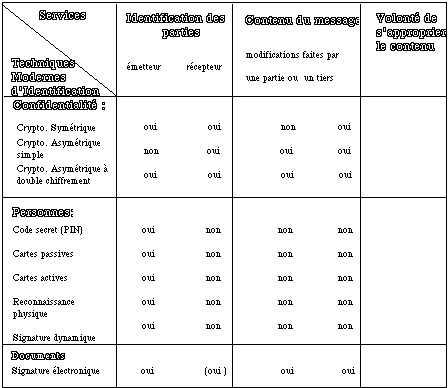
[9] Z.P.O. sect. 415 F.
[10] Par "directement lisibles", on entend que le système soit capable de reproduire l'information quasi instantanément et dans une forme directement lisible.
[11] Ainsi, en particulier la jurisprudence française déjà ancienne sur l'article 1347 du code Napoléon qui à propos du commencement de preuve par écrit, admet l'enregistrement sonore, la photographie, etc... Cf. dans le même sens, les doctrines et jurisprudences néerlandaise, luxembourgeoise, portugaise et irlandaise (cf. TEDIS,op.cit., et I. de LAMBERTERIE (éd.), rapport cité, p. 57).
[12] Ainsi, en Espagne, en Grèce et au Portugal où les copies doivent authentifier, aux Pays-Bas et en Belgique où elles doivent certifiées.
[13] C'est le qualificatif utilisé par les législations française et luxembourgeoise, lorsqu'elles ont souhaité répondre au souci auquel il vient d'être fait référence.
[14] A titre d'exemple, M. ELOY (in M. ANTOINE et alii, op.cit., p. 141) propose le tableau suivant : Pour évaluer le niveau de sécurité global offert par les différents moyens de conservation de données, nous avons calculé la formule suivante sur base des chiffres découverts précédemment (sect.2, sect.3 et sect.4) ajustés à l'intervalle [0,;100];:
SECURITE = CONFIDENTIALITE + DUREE + INTEGRITE
Nous pouvons définir le support d'information idéal au niveau sécurité comme un support possédant une confidentialité maximale, une durée de conservation illimitée et une intégrité parfaite.
Après calcul, les supports se répartissent selon le graphe
suivant;:
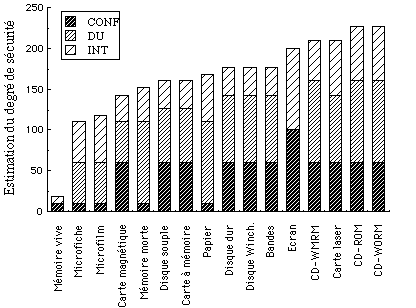
[15] Recommandation ndeg. R(81) 20 relative à l'harmonisation de législations en matière d'exigence d'un écrit et en matière d'admissibilité des reproductions de documents et des enregistrements informatiques. La première recommandation porte sur la suppression dans un maximum de cas d'un écrit comme moyen de preuve ...
[16] La démonstration du respect des critères repris ci-dessus permet au document électronique d'être reçu comme un écrit et de recevoir dans les législations où cela est prévu la force probante reconnue à l'écrit. Cette force probante peut ne pas suffire. Ainsi, selon le code civil Napoléon, l'article 1325 exige le caractère contradictoire de la preuve, c'est-à-dire la rédaction en autant d'originaux qu'il n'y a de parties intéressées à l'acte. Cette exigence a pour but d'assurer l'égalité entre tous les contractants, chacun étant à la fois créancier et débiteur. En détenant chacune un original, les parties sont en mesure d'apporter la preuve des droits dont elles sont titulaires. Les systèmes actuels permettent rarement de générer des documents électroniques originaux dans le chef des deux parties. Aussi est-ce logiquement que l'écrit électronique sera considéré aux yeux du code civil Napoléon comme un "commencement de preuve par écrit", au sens de l'article 1347 du code civil.
[17] La reconnaissance de la signature électronique comme signature doit permettre de lui appliquer les autres dispositions relatives à la signature. Ainsi, dans le droit belge, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement sa signature (ou son écriture). En cas de désaveu, la vérification en est ordonnée en justice (article 1324 du Code civil), conformément à l'article 883 et suivants du Code judiciaire.
[18] C'est le voeu de Madame GALLOUEDEE-GENUYS, op.cit., p.
59.
![[AQDIJ]](/img/aqdij.gif)
![[Table des matièes]](/fr/equipes/technologie/conferences/aqdij/img/up.gif)