
L'accès au droit dans les pays émergents - Le projet de connectivité en matière d'entraide juridique pénale auprès des pays membres de l'Organisation des États américains Pierre-Gilles Bélanger[1] [1] Le Canada redécouvre les Amériques au moment même où les technologies de l'information et de la communication (TIC) font tomber les frontières entre les pays. Simultanément, la Justice canadienne prend conscience du rôle qu'elle peut jouer dans les dossiers touchant la coopération internationale en matière de justice. [2] Le 3e Sommet des Amériques, qui eut lieu à Québec en avril 2001, a permis au ministère de la Justice du Canada de formuler un projet innovateur sur la connectivité en matière d'entraide judiciaire. Dans la déclaration finale, les présidents et premiers ministres des Amériques ont justement souligné l'importance de la connectivité pour le développement équitable de la région.
[3] N'eût été du dynamisme et de la clairvoyance de quelques juristes et autres praticiens du droit, cette déclaration serait passée inaperçue pour le droit. En effet, la justice, exception faite des droits de la personne, est trop peu considérée comme élément clé du développement à l'ère de l'information. Le projet[4] Lors de la 3e réunion des ministres de la Justice des Amériques, qui s'est tenue au Costa Rica en juin 2000, l'OEA (l'Organisation des États américains) a proposé aux pays membres de trouver de nouveaux instruments en vue d'améliorer l'échange de renseignements en matière de justice pénale. À cette occasion, le ministère de la Justice du Canada s'engagea, un peu vaguement faut-il l'avouer, à examiner la faisabilité d'un tel projet. [5] Un groupe de travail, coordonné par le ministère de la Justice du Canada et réunissant l'Argentine, les Bahamas, le Salvador et le Secrétariat de la coopération juridique de l'OEA, s'est rencontré à plusieurs reprises. Après de nombreux échanges et débats, nous avons présenté un projet pilote axé sur la création d'un réseau d'échange d'informations relatives à la justice pénale. [6] Sur le site du projet, on trouve, pour l'instant, un aperçu général des systèmes juridiques des quatre pays membres du Groupe de travail. On peut également y consulter les lois de ces pays et les ententes bilatérales et multilatérales en vigueur relativement à l'entraide en matière pénale. Ces renseignements sont fournis en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Les titres ont été traduits dans les quatre langues pour faciliter les recherches et les comparaisons[2]. [7] Depuis, ce projet a reçu l'appui des ministres de la Justice lors de la IVe rencontre des ministres de la Justice qui s'est tenue à Trinidad et Tobago en mars 2002 et celui des chefs d'État lors de l'Assemblée générale de l'OEA qui a eu lieu à la Barbade en juin 2002. Ils ont tous indiqué que ce site renfermait un potentiel inestimable pour le droit et la démocratie. Ces avantages sont réels et ce texte en soumet une synthèse. Par contre, ce projet rencontre aussi de nombreux obstacles qui parfois sont exclusifs à cette initiative et parfois s'inscrivent dans un contexte plus global. Nous avons donc cru opportun de prendre comme toile de fond le projet de connectivité en matière pénale dans les Amériques (MLA), afin de démontrer le parallèle entre les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'internationalisation du droit, tout en y montrant les défis qu'un tel projet comporte et les bénéfices que les pays émergents ou le Canada peuvent en retirer. Les bénéfices[8] Les avantages sont multiples, mais tout d'abord, il faut remettre le projet dans son contexte. [9] Les démocraties émergentes[3] exigent des États plus développés qu'ils appuient leurs efforts. De plus, plusieurs expériences du passé, renforcées un peu par les événements du 11 septembre 2001, nous démontrent que l'aide technique doit se faire dans un contexte d'entraide, contexte qui est mieux servi dans une relation multilatérale. [10] Le droit, dans ce contexte, doit obligatoirement se développer dans un contexte d'échange multilatéral. Une évidence : un cerveau, qu'il vienne de Montréal, de Bogota, de Port-au-Prince ou de Washington possède la même valeur! À ce chapitre, pour une très grande majorité des intervenants, le néocolonialisme est, du moins en théorie, mort. À bien des points de vue, les événements du 11 septembre ont permis de revoir notre approche des relations internationales. Le sherpa canadien du Sommet des Amériques, Monsieur Marc Lortie, soulignait, un an après le Sommet des Amériques de Québec et à la suite des évènements du 11 septembre 2001: « Soudain, les vieux ennemis sont devenus des amis; il a fallu reconsidérer ce qui était tenu pris pour acquis; les principales priorités ont été remises au lendemain, ne revêtant plus qu'une importance secondaire[4]. » Aujourd'hui, plusieurs États, sous l'égide d'une institution multilatérale font eux-mêmes appel aux mécanismes d'observation du droit (l'audit en matière de corruption dans la convention contre la corruption de l'OEA en est un bon exemple[5].). On voit émerger des types de droits, plus ou moins valorisés par le passé; celui de la protection des données, de l'accès à l'information, du droit criminel par ses ententes anticorruption, antiterroriste, par les notions de la transparence de l'État, de la propriété intellectuelle, de la protection à la vie privée. Bénéfice pour la démocratie[11] Un forum multilatéral, comme le site réalisé, permet à toutes les démocraties de suggérer et d'être consultées. Il s'agit d'un levier politique considérable où tous les documents, comme les ententes bilatérales, tous les courriers électroniques y sont reconnus à leur valeur et ils ont leur place. Ils font partie de l'émergence démocratique et Internet joue ce rôle de grand démocrate. [12] Dans ce contexte, le projet MLA arrive à point nommé, puisqu'il est plus qu'un lieu d'affichage de documents. Il offre la possibilité aux juristes des Amériques de savoir ce qui se fait ailleurs et permet de négocier des ententes en toute connaissance de cause. Ce projet MLA dépasse la notion d'énoncé du droit. Il transmet en réalité une concrétude de ce qu'est le droit chez chacun des membres. Le droit affiché est mis en commun par sujet avec notes explicatives, traités correspondants et doctrines, annotations et règles de procédures ainsi que formulaires donnant la marche à suivre et la preuve acceptable sur la question ciblée de l'entraide juridique en matière pénale. Cela permet au droit de chaque État d'être connu, d'une part, mais aussi, d'autre part, d'être comparé et, ultimement, influencé ou critiqué de façon presque instantanée. Il est mis en parallèle et permet aux démocraties des Amériques de faire connaître leur réalité juridique, donnant aux plus petits pays, du moment qu'ils sont présents et actifs, la possibilité de faire des suggestions. Grâce à Internet et aux nouvelles technologies de communication, une « révolution tranquille » se produit au niveau du droit. [13] De plus, participer à une telle structure apporte des dividendes, ne serait-ce que par l'établissement de la structure, du gabarit des pages sur la Toile et du type d'information désirée. Nous établissons ensemble les limites de la toile, la destination de l'information privilégiée ou le type d'informations à partager et avec qui: entre les autorités policières, les universitaires? Il en irait de même s'il fallait étendre le champ des sujets! Devrons-nous l'étendre au trafic de drogue et à l'extradition des trafiquants? La Toile permet à un groupe d'influer sur l'entraide en matière criminelle dans les Amériques. Nous semblons minimiser cette réalité, mais pourtant, si ce site devient entièrement fonctionnel, comme nous l'espérons et le croyons, il offrira au groupe de travail la possibilité d'influer sur le droit des Amériques. À titre d'exemple, la ressource pourrait permettre d'éliminer certaines étapes consultatives dans la procédure et, de ce fait, le groupe pourrait ouvrir la route à une reformulation de cette dernière. Même si l'entraide mutuelle est à la base une structure d'échange de l'information, il se peut que l'efficacité exige de laisser tomber certaines étapes ou demandes afin que la procédure s'active, car le temps est souvent garant du succès pour capturer des criminels. Les bénéfices pour le Canada - Justice Canada dans un nouveau rôle[14] Longtemps, le droit international a été laissé aux diplomates sans que les rôles des juristes soient clairement définis. Il y a désormais une nouvelle génération de diplomates au Canada, un peu comme ceux d'Angleterre et d'Allemagne, qui désirent donner une place importante aux ministères dits techniques ou spécialisés, afin que ceux-ci jouent un rôle dans les prises de décision et d'élaboration de projets internationaux. C'est une révolution qui n'est pas encore achevée et généralisée, mais que plusieurs diplomates canadiens de haut niveau appellent de leurs voeux. [15] Le MDJ canadien demeure encore, essentiellement, un ministère de contenu, de substance comme on aime bien l'appeler, en excellant à répondre aux besoins juridiques des autres ministères. Ces dernières années, des avocats du ministère ont joué un rôle actif dans la négociation d'accords commerciaux (OMC/ALÉNA), d'accords en matière de propriété intellectuelle (ADPIC), d'accords en matière de droits de la personne (Convention relative aux droits de l'enfant), d'ententes relatives au CEDAW (Protocole sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes), d'accords internationaux en matière de droit pénal (cybercriminalité, trafic des stupéfiants, trafic de personnes), d'accords en matière d'environnement (Protocole de Kyoto, Convention sur la biosécurité) ainsi que de divers accords de droit international privé (par l'entremise de la CNUDCI, d'UNIDROIT et de la Conférence de La Haye). Mais cette forme de dossier international est gérée par l'intermédiaire du ministère-client. Les ententes environnementales se font grâce au ministère de l'Environnement, le commerce international grâce au ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et ainsi de suite. Bien entendu, il y a moult exceptions et on a vu, dans les dernières années, l'ACDI (Agence canadienne de développement international) appuyer, subventionner et évaluer des projets avec le MDJ. [16] Le sujet des droits de la personne et du droit criminel tombe clairement sous la responsabilité du MDJ. Certains affirmeront que le MDJ a été très actif dans ce domaine, d'autres soutiendront le contraire. Ce n'est pas à moi d'en juger. Toutefois, selon notre évaluation, et surtout selon le nouveau contexte d'inter-nation, il nous semble maintenant inévitable que les ministères experts participent directement au développement international de façon parallèle et en continuité avec les questions relevant de leur expertise en l'insérant non pas dans un contexte simple de développement mais d'élaboration du droit. En fait, le droit ne s'élabore plus uniquement à l'intérieur des frontières, et ne se traduit plus seulement en développement. Internet nous ouvre cette nouvelle possibilité de traduire nos connaissances en une structure universelle et multilatérale et qui fait donc appel encore plus à l'expertise des ministères. [17] Nos créneaux, par exemple le droit criminel et les droits de la personne, adaptés et influencés par le droit international, n'ont que très rarement servi la structure du droit international et donc au développement du monde juridique international. C'est que nous n'avons pas vu qu'en participant à un réseau de distribution, nous participons à l'élaboration du droit en effervescence, à la démocratie en devenir avant même parfois de définir notre propre droit. [18] Les nations en sont rendues là et le Web nous permet d'y penser sérieusement. [19] Les démocraties veulent et démontrent leur désir d'adapter leur système à un reality check juridique et démocratique, d'adapter leur gouvernance à un système plus démocratique. Avant-hier nous énoncions de grands principes, hier nous diffusions de l'information et aujourd'hui il y a croisement du droit diffusé et de son élaboration. Difficultés rencontréesAccès aux technologies[20] Le sondage que nous avons distribué, avant la IVe rencontre des ministres de la Justice a Trinidad et Tobago, nous a éveillés au fait que pour certains pays il y a loin de la coupe aux lèvres et que certains se battent même encore pour obtenir un accès à Internet. Bien que ce projet s'adresse d'abord a une population ciblée, i.e. les experts travaillant dans le domaine de l'entraide criminelle, diminuant ainsi la difficulté de la diffusion et de l'interaction, il est évident, et nous l'avons senti lors de notre présentation devant les 34 ministres de la Justice en mars 2002 et devant l'assemblée de l'OEA en juin 2002, que l'aspect de l'accessibilité du droit sur Internet, pour toute la population des Amériques dans les quatre langues officielles, dépasse de beaucoup l'ampleur du réseau d'échange entre les experts juristes MLA. Un projet parallèle devra s'attarder aux besoins d'infrastructure de certains des groupes ciblés par ce projet[6]. Les défis de la collecte de données[21] Pour de nombreux États des Amériques, la seule collecte des données représente un défi considérable. Il s'agit là d'un problème qui se pose parfois même dans un pays économiquement développé. Certains pays, il faut le reconnaître, n'ont pas ou peu bénéficié de la révolution des technologies de l'information. Pour eux, les textes juridiques ne sont le plus souvent qu'accessible sur papier et les copies, maintes fois reproduites, sont de piètre qualité. Il faut donc envisager la reconstruction d'un fonds du droit à l'échelle du continent. Le projet MLA a été confronté à de telles difficultés. Ce que notre expérience a montré c'est que nos collègues des pays moins bien dotés au plan des technologies de l'information, pour autant que nous leur en donnions l'occasion, feront les plus grands efforts pour rassembler les textes nécessaires. À partir de là, la numérisation est possible et elle permettra un accès multiplié au patrimoine juridique que partagent les pays des Amériques. Défi de la culture professionnelle[22] Le défi de la collecte, c'est aussi travailler avec des avocats de culture traditionnelle, peu habitués aux changements rapides - prenons l'exemple des précédents, qui sont à la base du common law - ou encore qui sont de la culture du secret, donc peu enclins à divulguer l'information - prenons l'exemple du secret professionnel de l'avocat - ou qui ne jurent que par le papier, en raison de l'authenticité des documents écrits. Toute cette culture forme en soi de très grandes qualités professionnelles, mais doit être adaptée à la réalité de la Toile et évoluer avec les développements technologiques. C'est que pour certains, et je dirais chez certains avocats, le papier demeure l'unique outil de travail et l'échange de document est synonyme d'un supplément de travail. Alors le besoin de retrouver une copie numérisée n'est pas une priorité et, dans certains pays, relève de corporations ou d'institutions étrangères. Surtout dans les pays de droit commun, cela soulève un autre défi, celui des droits d'auteur. [23] Le défi fut donc parfois de convaincre nos collègues de l'avantage d'un tel mécanisme de communication pour le droit et de démontrer qu'une fois l'entente internationale ou le traité bilatéral négociés et signés, la copie, même sur support papier, ne sera plus enfermée dans une voûte dans une certaine section d'un ministère étranger et que seule copie détenue par le ministère de la Justice sera accessible en tout temps. La Toile aura aussi cette vertu, qui n'est pas particulière à la diffusion du droit, de permettre à tous de se procurer la ou les copies officielles, dans l'une des langues officielles, à l'heure et à l'endroit désiré. Le défi de l'OEA[24] L'OEA doit jouer un rôle de leadership et rappeler constamment le défi des États de l'efficacité versus le respect des démocraties et celui du rythme de chacun. L'OEA doit rappeler aux États qu'un tel outil aura du succès seulement s'il est le résultat du travail de l'ensemble des États des Amériques. L'OEA a également le défi de la pérennité. Le défi de la pérennité du projet[25] La pérennité du projet soulève des questions. Outre les problèmes de technologie que nous pouvons rencontrer, il est certain qu'un tel projet devrait être en mesure de vivre par lui-même. Dans ce contexte, il y a lieu de se demander si le projet survivra à sa mise en place? Même si le besoin est présent, il y faut une volonté de l'animer. Une solution pourrait prendre la forme de la mise en place d'un secrétariat virtuel qui, chaque année ou tous les deux ans, se chargerait de mettre à jour les contenus. Un peu comme le font les services de la présidence du Conseil de l'Europe. Ce comité serait responsable d'animer et de coordonner les activités sur le Web. Le défi de la démocratisation[26] Après un succès passablement retentissant qu'a connu le projet auprès des ministres et des représentants des pays, il est facile et aisé de s'asseoir sur nos lauriers et de ne pas tenter d'améliorer ce mécanisme d'échange. Tous s'accorderont sur un point: un site afin qu'il soit vivant, efficace et utilisé, doit être adapté aux besoins de son public cible. L'autre danger est de voir certains l'utiliser à leurs propres fins. Ainsi, certains pourraient l'utiliser pour obtenir une fenêtre sur les Amériques, récolter des informations privilégiées, sans rien donner en retour. On sait, et nous l'avons dit précédemment, que le succès de ce projet est lié à l'image du Web, soit la démocratie du médium. Tous, dans la mesure où ils y croient et qu'ils y participent, y ont un impact. Les pays en émergence doivent participer activement à la mise en place de ce projet et les pays démocratiques doivent, de leur côté, faire preuve d'humilité. Tous sont égaux et tendent vers le même but: combattre le crime. Le Web nous le permet. Conclusion[27] À un moment où le monde est menacé par la criminalité transnationale, notamment par la menace de terrorisme, un moyen sécurisé qui permettrait aux pays d'échanger des renseignements en toute confidentialité et en temps opportun est plus que jamais utile. La criminalité transfrontalière est en pleine expansion. Les criminels ont accès à des moyens sophistiqués de transport et de communication qui leur permettent de rester anonymes, d'échapper aux poursuites et de dissimuler la preuve et les produits qu'ils tirent du crime. À mesure que les criminels perfectionnent leurs techniques et qu'ils profitent des frontières nationales pour se dérober à la justice, les autorités responsables de l'application de la loi doivent à tout prix s'unir pour lutter contre cette menace. Les Amériques n'en sont pas exemptes. En d'autres mots, il ne s'agit pas d'un vague projet, mais plutôt d'adapter la technologie à une situation existante. Grâce à Internet, certains États revoient leurs capacités d'intervention et d'autres découvrent la nécessité réelle de signer des ententes bilatérales, multilatérales, de participer à des forums d'échanges, de nommer des personnes compétentes en poste afin de répondre aux problèmes du droit de l'entraide. Finalement, Internet permet de penser à la diffusion du droit pour tous et d'expliquer leur droit respectif dans et pour la communauté des juristes des Amériques. Il ne s'agit pas simplement de diffuser de l'information juridique. Il s'agit d'édifier une communauté vivante, de communiquer plus rapidement et plus efficacement afin de contrer le crime... [28] Nous comprenons maintenant que la connectivité ne consiste pas seulement à brancher les citoyens à Internet ou à combler le fossé numérique. C'est beaucoup plus. C'est une transformation fondamentale de la manière d'agir des gouvernements envers leurs citoyens et aussi des États les uns envers les autres. C'est une mutation profonde qui aplanit les structures et permet l'émergence d'un nouveau modèle de gouvernance, en harmonie avec, espérons-le, une nouvelle stratégie de la Justice. [1] Les propos tenus dans ce texte ne représentent pas nécessairement ceux du ministère de la Justice et relèvent uniquement de l'auteur. [2] On peut le consulter à l'adresse www.oea.org- voir en annexe. [3] Le terme « nouvelles démocraties » ou « démocraties émergentes » est un peu galvaudé et utilisé en apparence avec beaucoup de paternalisme. Il est clair que nous aurions beaucoup de difficultés de parler de la Grèce ou des États-Unis comme étant de nouvelles démocraties, bien que le phénomène des élections américaines comportait certes des éléments de nouvelles démocraties. La définition provient de la science économique. De Jacques LAROSIERE, « Les pays émergents: chances et défis » , Conjoncture, mars 2002. Elle est celle des pays en développement qui pratiquent tant bien que mal l'économie de marché et par ce fait accèdent aux financements internationaux. Bien entendu, cela s'insère dans le courant de la mondialisation. Pour nous, il s'agira de ces nations qui quittent une dictature, une oligarchie gouvernante, ou de parti unique et de gouvernement fantôche vers un gouvernement élu par le peuple [de façon la plus juste selon les circonstances]. L'émergence est en grande partie liée à ce principe d'élection, de la possibilité de débattre des questions et de s'opposer sans représailles et dans les limites de l'État de droit. [4] « Résultats et leçons du Sommet de Québec » Marc Lortie, Sous-ministre adjoint (Amériques) ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Ottawa à la Conférence de Wilton Park 660 Le commerce et l'intégration économique dans les Amériques : Incidences pour l'hémisphère, l'Europe et l'Asie. [5]Aussi, tous les pays des Amériques doivent respecter les droits de la personne, et ce, particulièrement depuis la venue de charte démocratique -Sommet de Québec. « La Charte démocratique interaméricaine est un nouveau bouclier politique conçu pour contrer les assauts contre la démocratie. » Elle est invoquée, pour la première fois, le 13 avril 2002, durant la crise constitutionnelle au Venezuela. La Charte vise à compléter la « clause démocratique » de la Déclaration de Québec en vertu de laquelle « toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État de l'hémisphère constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de cet État au processus du Sommet des Amériques » . La définition provient de la science économique. [6] Lors du Sommet des Amériques de Québec, le premier ministre Chrétien a annoncé une initiative canadienne: la création de l'Institut pour la connectivité dans les Amériques (ICA), et a accordé une subvention de 20 millions de dollars à cette fin. Cet Institut est conçu pour devenir le forum pour l'innovation hémisphérique dans l'application des technologies de l'information et des communications (TIC), afin de renforcer la démocratie, de créer la prospérité, et de réaliser le potentiel humain. Il s'appuiera sur le succès et l'expérience de la Stratégie Branchons les Canadiens, et des programmes de développement international et de TIC du Canada. 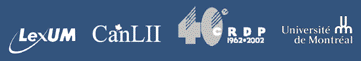 |