|
[1] Rapporteur : la tâche ne s'impose pas; mais quel est donc ce statut bâtard pour une fonction qu'il est loin d'être systématique à chaque conférence. La meilleure preuve de son étrangeté est qu'elle ne semble pas se traduire en anglais si ce n'est pas un terme français, et ce, en dépit du pragmatisme associé à cette première langue. Un rôle qui ne s'impose pas non plus du fait des difficultés associées à l'exercice de résumer en 20 minutes ce que des experts ont dit en plus de 6 heures. Néanmoins, il existe plusieurs éléments qui permettent de justifier que j'ai accepté ce rôle lors de cette conférence. [2] Un point conjoncturel tout d'abord, relié au fait que les juges ont légitimement éprouvé le besoin depuis plusieurs mois, plusieurs années, et c'est tout à leur honneur, de s'interroger sur l'influence des technologies sur leur profession[2]. Il importait donc d'organiser 4 séances qui présentaient les problématiques et les solutions et que tout puisse se faire en toute « indépendance » , en famille. Eu égard à ce besoin d'isolement, certes, mais tout cela sans manquer de transparence, il est, je crois, important de tenter de résumer ce qui s'est dit, pensé peut-être; du moins de tenter de le faire. Or, cette tâche fut passionnante. [3] Un point plus substantiel aussi. La profession judiciaire, centrale dans notre système de droit, subit assurément une influence majeure de la part de la technologie qui est susceptible de faire évoluer grandement la façon de procéder. En tant que juriste, il est donc capital de s'informer sur l'influence que le « juge branché » aura sur la façon de dire le droit; sur la substance même du droit. [4] Un point purement personnel enfin. Vous me voyez honoré de me permettre d'accomplir cette tâche fort prestigieuse qui m'a permis de surcroît de travailler avec des personnes délicieuses, charmantes, aimant leur profession et aimant le droit. À toutes ces personnes qui m'ont aidé dans ce rôle de coordination, merci pour votre collaboration. [5] C'est donc en toute humilité que je me plie au jeu; en toute humilité mais pas en toute dangerosité, ne me permettant pas de reproduire de façon linéaire ce qui a été dit mais plutôt en me permettant une synthèse sur plusieurs idées phares qui je crois ont été récurrentes dans les quatre panels de la journée d'hier. [5] Mais avant toute chose, quels étaient-ils ces quatre panels :
[6] Ces idées phares, quelles sont-elles? J'en identifierai cinq, qui tournent autour du mot « changement » .
[7] N'en déplaise à mes habitudes de plan en deux parties, il s'agira de les traiter successivement, l'une à la suite de l'autre. Le constat de changements majeurs opérés par la technologie[8] Les exemples pleuvent pour signifier l'ampleur du constat d'évolution. Les quatre thèmes traités illustrent ce changement. [9] En matière de sécurité en premier lieu, il est apparu évident que l'utilisation de technologies ne peut passer que par la reconnaissance d'un certain contrôle, d'un « monitoring » , et ce, en dépit de l'indépendance des juges, eu égard
[10] Rester sur une base conservatrice, un statu quo constatant que s'il en va différemment, ce serait reconnaître une dépréciation des prérogatives des juges, est une attitude qui apparaît inconciliable avec le changement. [11] En matière d'accès à l'information, il est fascinant de constater, d'abord, qu'il faut prendre en compte certains adaptations pour reproduire ce qui se faisait avec des modes traditionnels comme le papier, par exemple adapter une écriture papier avec une écriture écran. Ensuite, que les potentialités technologiques ouvrent des horizons nouveaux
[12] En matière de vie privée, il a été montré que les risques de recoupements d'information qui pourraient être fait par le fait d'une recherche extensive dans différentes banques de données qui n'auraient ni mis en place une politique d'anonymisation ni introduit des restrictions pour la recherche. (par exemple un employeur qui chercherait quels sont les jugements à la charge d'un employé pressenti) sont considérables. [13] Autre exemple, citons l'affaire du juge néo-zélandais qui aurait surfé sur des sites compromettants, mais pas illégaux, et dont les journaux se sont réjouis à diffuser la nouvelle. [14] En matière de système intégré de justice enfin, il est fascinant de constater certaines expériences de décisions automatisées qui peuvent être rendues notamment dans des domaines plus systématiques; moins compliqués. [15] Ainsi, on a eu l'occasion d'apercevoir des interfaces, généralement conviviales qui, dès lors que les habitudes seront consacrées (j'ai cru comprendre que sauf exception il importait de parler encore au futur), dès lors que la technologie est appréhendée, permettront à des juges de prendre des décisions avec un potentiel de gain de temps qui nous est apparu considérable. [16] En bref, il est possible de dire que ces changements tournent autour de plusieurs concepts nouveaux; j'en identifierai un qui m'apparaît être revenu tout le temps : le concept de processus. [17] Par exemple,
[18] En effet, et permettait-moi cette explication personnelle, c'est que face à la difficulté d'identifier la substance même du droit, face à la complexification de la matière à réguler, on préfère se limiter à la façon de procéder plutôt qu'à la substance même. Le théoricien Lenoble disait à cet égard dans Droit et communication : la transformation du droit contemporain qu'il fallait « veiller à ce que les décisions prises par les acteurs individuels ou collectifs aient été prises au terme de procédures qui traduisent le respect, dans un contexte donné, des contraintes estimées à une justification rationnelle » [4]. [19] Internet en particulier et les technologies de l'information en général offrent donc le bon comme le mauvais, un nouveau bon et un nouveau mauvais. Cette émergence de la nouveauté est la plus évidente : c'est la raison d'être de la présente conférence. Ces changements ne sont pas neutres juridiquement[20] Mais ces changements, qu'ils soient positifs ou négatifs, actifs (en se protégeant pour gagner de la sécurité) ou passifs (en ne se protégeant pas pour gagner de la sécurité), qu'il soit des actes ou des omissions, des problèmes ou leurs solutions qui sont présentées pour faire face à une nouvelle réalité, tous ces éléments ont des conséquences juridiques. [21] Par exemple, déterminer ce qu'est un document intègre, confidentiel, non répudié, disponible ou authentifié, pour reprendre les fonctions essentielles que les spécialistes en gestion documentaire associent habituellement à un document, est un jugement de valeur juridiquement chargé. [22] Par exemple, déterminer comme en France selon la CNIL que les banques payantes de jurisprudence ne sont pas assujetties à un processus d'anonymisation (ou un processus minimal), alors que les banques gratuites le sont (à cause du fait que les premières seraient moins facilement indexables), c'est une solution technologique qui est profondément chargée sur le plan normatif, et ce, en dépit de l'absence de jugement de valeur de ma part à ce sujet, sujet qui néanmoins ne semblait pas recueillir l'unanimité. [23] Par exemple, déterminer, qu'une version anonymisée pour sa mise en ligne est la version officielle ou au contraire la non-officielle, question à laquelle aucune réponse n'a été à ma connaissance apportée, est une réponse technologique encore une fois juridiquement chargée. [24] Par exemple, les problèmes constitutionnels associés à la question « QUI doit mettre en place un système intégré de justice » , avec des risques de voir le partage des compétences modifié. La liste de ces illustrations de non-neutralité juridique de solutions ou de situations technologiques aurait pu être très longue. [25] Aussi, ces changements manifestent des nouvelles frontières encore à définir, comme par exemple :
[26] En bref, l'intégration des technologies dans le contexte judiciaire me fait penser à une notion qui a déjà été développée en théorie du droit qui est celle de « droit frontière » ; un droit qui vise à protéger une catégorie d'intérêts et qui se trouve confronté, pour la première fois, à une autre catégorie d'intérêts. Quoi de plus juridique que cette situation? Cela fait quasiment référence à certains tests de proportionnalité que l'on trouve notamment en droit public. Ces changements apparaissent dans un cadre pluridisciplinaire où persistent des différences culturelles[27] Ces différences culturelles peuvent se manifester à plusieurs point de vue : Point de vue de la sécurité[28] L'une des difficultés c'est que pour vérifier si par exemple, un système est sécuritaire, il faut comprendre les terminologies employées, il faut comprendre ce que je qualifierai comme étant « la catégorisation des solutions en fonction des fonctions à respecter » . Or, cette appréciation, technique, les juges, en bien des cas, et c'est normal, ne la comprenne pas, ne l'évalue pas. Si ce n'est par le truchement d'experts. [29] Il est d'ailleurs symptomatique de mesurer la distance entre la technologie et les juges. Un exemple à cet égard, qui avait d'ailleurs été soulevé par un intervenant lors d'un téléphone conférence préparatif, sans prendre le soin de le répéter lors de la conférence, est que les juges qui se trouvent confrontés aux systèmes intégrés de justice sont souvent fort déstabilisés face aux technologies. Et si le problème dans l'intégration des technologies n'était-il pas, tout simplement, le juge lui-même qui peine à appréhender des documents technologiques? [30] Ainsi, pour mettre à terre ces différences culturelles, il va falloir cultiver les communautés qui ont l'obligation de collaborer. Entendons par-là, qu'il y a sans doute un besoin de rendre plus transparent les modalités techniques, les rendre moins indigestes. D'un autre côté, il est important de lutter contre la « technophobie » qui est, je crois, présente chez les juristes en général, les juges en particulier. Point de vue internationale ou inter-provinciale (point de vue géographique)[31] Mais quand on parle de différences de culture, il ne s'agit pas seulement d'identifier la différence entre juriste et technologue. Il y aura aussi (le futur semble encore devoir s'imposer dans la mesure où cela ne semble pas encore fait), une harmonisation à faire entre des façons de procéder dans plusieurs pays ou provinces. Point de vue commercial versus secteur public[32] En effet, il importe aussi que des organismes de publication privés s'harmonisent sur le plan des pratiques, afin de ne pas assurer une sorte de course à la compétitivité, bassement mercantile, qui irait à l'encontre des intérêts tant des individus que de la justice. En bref, il importe de continuer d'échanger comme le fait magnifiquement ce colloque, de façon interdisciplinaire, de façon internationale, les solutions des autres étant souvent les solutions de demain, chez soi. des changements qui vont impliquer une implication massive des juges[33] Or, face à ces nouveautés, face à ces nouvelles réalités, face à ces nouvelles frontières à dessiner, il importe d'imaginer, de créer, des solutions qui vont se distinguer. Par leur qualité; c'est-à-dire leur mesure, leur équilibre, leur adéquation à la réalité. Par leur légitimité aussi. Excusez ce critère que les juges rechignent à utiliser du fait de son caractère subjectif. Or, en l'espèce, cette légitimité passe par une implication des juges qui vont décider, ensemble, par consensus, par l'établissement de comité sur les quatre aspects susmentionnés. « Involved yourself or pay the price! » , a t-on pu entendre, Presque sous la forme d'une menace. Par conséquent, on a vu apparaître toute une série de « normes informelles » , d'usages, d'une lex electronica des juges, pour reprendre un concept cher au CRDP, qui ont par exemple déterminé
[34] En bref, je noterai que ces exigences que l'on demande aux juges de suivre, tel que s'impliquer, comprendre, s'adapter, à plusieurs reprises, m'ont fait réagir de la façon suivante : « diantre qu'on leur demande beaucoup de choses! » . La tâche est en effet lourde. Peut-être que la capacité à supporter ce poids de l'adaptation est la clé de l'avenir? Une transition toute trouvée avec le dernier et cinquième point. J'ajouterai que ce travail de collaboration doit se faire comme mentionné plus tôt avec d'autres corps de métiers, d'autres professions, que ce soit des technologues, des commerciaux. Et je quitte la forme affirmative, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, ces changements sont-ils irrémédiables?[35] Posé différemment, est-ce que ces projets d'intégration des technologies arrivent trop tôt? Faut-il aller en arrière, et n'y a-t-il pas un risque de voir s'installer une complexité à la place d'une autre? La réponse qui a été généralement produite est assurément qu'il faut continuer à aller de l'avant, qu'il faut continuer à réfléchir à ces questions
[36] Ceci n'est pas mon caractère « technocentré » qui parle, ayant personnellement tendance à montrer que les nouvelles technologies sont en certains cas difficilement transposables à des méthodes traditionnelles. Je pense en revanche avoir été convaincu par les panélistes
Conclusion[37] Voici donc une présentation très humble qui m'a été suscité par des interventions souvent brillantes, toujours passionnantes, que je me suis encore une fois permis d'analyser à travers le prisme personnel de ma compréhension. Une présentation personnelle qui pourrait me permettre de conclure avec les points suivants :
[38] Merci de votre attention. [1] Professeur, Faculté de droit, Université de Montréal. Codirecteur de la maîtrise pluridisciplinaire en commerce électronique. Courrier électronique : vincent.gautrais@umontreal.ca. Site Internet : http://www.droit.umontreal.ca/cours/Ecommerce/accueil.htm. [2] Voir par exemple Actualités informatiques pour la magistrature, disponible à http://www.cjc-ccm.gc.ca/francais/aim/CJC32F.pdf. [4] Jacques LENOBLE, Droit et communication : la transformation du droit contemporain, Paris, Éditions du Cerf, Humanités, 1994, p. 18. 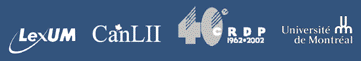 |
