|
[1] L'éventualité de la numérisation des audiences, des dossiers et des procédures judiciaires ouvre-t-elle la voie à une revendication de droits d'auteur ? Si oui, par qui? Où et comment trouver un nouvel équilibre? [2] L'accessibilité aux informations juridiques a considérablement évolué au cours des dernières années. Le « droit d'auteur de la Couronne » , il n'y a pas si longtemps, était considéré comme l'un des obstacles à la libre diffusion du droit sur l'Internet (lois et jugements). Les États ont cependant assoupli l'application de cette prérogative, dans une volonté de rendre ces « règles de droit » le plus largement accessibles et ce, gratuitement. [3] Face au développement de l'enregistrement numérique des audiences, il est possible qu'une pression s'exerce en faveur d'une accessibilité à celles-ci par l'Internet. Cet exposé propose une analyse de cette question sous l'angle des droits d'auteur. En effet, le droit d'auteur est l'un des enjeux de la diffusion d'informations sur les nouveaux réseaux d'information. Mais qui pourrait revendiquer des droits d'auteur sur les audiences ou les dossiers judiciaires ? Ces droits auraient-ils pour effet d'empêcher la publication ou la communication au public de celles-ci ? [4] La doctrine de l'utilisation équitable, appliquée aux documents juridiques, permet de favoriser la création d'oeuvres nouvelles (doctrine, lois annotées, banques de données). Quel est le rôle des intermédiaires à cet égard ? Une éthique de l'information permettrait-elle de concilier la diffusion des audiences, le respect des parties et l'assurance d'une justice équitable ? PlanL'énoncé du droit est-il protégé par un droit d'auteur La nature du droit d'auteur est-elle adaptée à l'ère numérique L'accès aux informations juridiques et judiciaires Le caractère public des audiences L'utilisation équitable des documents juridiques et judiciaires ConclusionL'énoncé du droit est-il protégé par un droit d'auteur ?[5] À première vue, il peut paraître étonnant de rattacher à l'énoncé du droit, destiné à s'appliquer à l'ensemble de la société et à régir les comportements, une forme de droit d'auteur (exclusivité). [6] La Convention de Berne sur les droits d'auteur[2] reconnaît aux États une grande marge de manoeuvre quant à la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes (art. 2(4)). Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur maintient ce principe[3]. [7] Certains États reconnaissent généralement que les lois et les décisions judiciaires appartiennent au « domaine public » [4]. D'autres, comme le Canada et le Royaume-Uni, contrôlent la publication de ces oeuvres par le « droit d'auteur de la Couronne » [5]. [8] Au cours des dernières années, des recours judiciaires ont été entrepris par des éditeurs privés souhaitant casser le monopole de l'État dans la publication du droit[6] ou à tout le moins, stimuler sa diffusion sur l'Internet[7]. [9] Dans l'affaire Wilson & Lafleur[8], cet éditeur privé contestait les obstacles administratifs et statutaires l'empêchant d'avoir accès à l'ensemble des décisions judiciaires (coût exorbitant), dont une directive qui accordait gratuitement à la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)[9], un mandataire de la Couronne, l'accès à toutes ces décisions. La Cour d'appel a déclaré nulle cette directive et déclaré que l'éditeur privé avait droit à un « accès réel » à l'ensemble des décisions des tribunaux québécois. [10] Depuis peu, les décisions des tribunaux québécois sont accessibles gratuitement à partir du site : www.jugements.qc.ca[10]. Conséquemment, chaque citoyen, du Québec ou d'ailleurs, peut maintenant avoir accès aux mêmes conditions (gratuitement et sur l'Internet) aux décisions motivées des tribunaux québécois. Cet accès à l'ensemble des jugements, sans commentaires ou appréciation, n'offre toutefois pas en soi un guide suffisant pour déterminer l'état du droit... et aider à réguler la conduite[11]. [11] Le rôle d'information juridique, par le tri, la sélection, le résumé et l'analyse des jugements, est ainsi dévolu à l'ensemble de la presse juridique et aux auteurs de doctrine, pour la création de nouvelles oeuvres[12]. [12] La politique de gestion et de négociation des droits d'auteur appartenant à l'État a également été assouplie, favorisant la réutilisation et l'exploitation de des oeuvres de l'État, à certaines conditions, à partir d'un guichet central. Au Québec, ce guichet central est l'Éditeur officiel[13], qui assure aussi la publication sur l'Internet des lois, règlements et projets de loi. La concurrence ou la valeur-ajoutée dans le marché de la législation en-ligne semble actuellement se jouer sur le plan de la mise à jour des lois et incidemment, de leur fiabilité. [13] Au Royaume-Uni, la reproduction des oeuvres protégées par le Parliamentary Copyright[14] est administrée par un mandataire de la Couronne[15], qui rend également accessible la législation[16]. [14] Au niveau fédéral, la diffusion gratuite des lois est assurée par le ministère de la Justice du Canada[17]. Un Décret sur la reproduction de la législation fédérale[18] prévoit en outre que : [15] Toute personne peut, sans frais ni demande d'autorisation, reproduire des textes législatifs du gouvernement du Canada et des codifications de ceux-ci, ainsi que des décisions et des motifs de décision de cours et de tribunaux administratifs établis par le gouvernement du Canada, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée pour veiller à ce que les documents reproduits soient exacts et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle. [16] En France, où la diffusion du droit était principalement assurée par Légifrance, une nouvelle directive reconnaît désormais un régime de licences qui permet aux professionnels de l'édition juridique d'accéder aux données juridiques détenues par l'État au seul coût de leur mise à disposition[19]. [17] Considérant la maxime que nul n'est censé ignorer la loi[20], il n'est pas étonnant que l'accès aux principales sources de droit (loi et jurisprudence) soit devenu l'un des vecteurs de revendication d'une plus grande accessibilité, par l'Internet, aux oeuvres de l'État. L'engagement démocratique d'un État envers la société civile peut en effet être reflété par les relations de communications qu'il met en oeuvre. On peut également suggérer que la circulation, la plus large possible, des règles de droit au sein du public et de la société civile contribue à sa connaissance par le public et ainsi, à la primauté du droit. [18] Ainsi, une poussée nette en faveur de la démocratisation de l'information juridique anime la plupart des sociétés démocratiques ces dernières années[21]. Les oeuvres de l'État que sont les lois et les jugements sont accessibles par l'Internet et ce, gratuitement[22]. [19] Cependant, cette ouverture dans l'accès au droit va-t-elle jusqu'à permettre l'accessibilité et la diffusion des transcriptions des audiences et des dossiers judiciaires? Le droit d'auteur y occupe-t-il une place? La nature du droit d'auteur est-elle adaptée à l'ère numérique ?[20] Le droit d'auteur est l'un des volets couverts par la notion plus large de « propriété intellectuelle » . Le droit d'auteur crée une forme de « droit de propriété » [23] reliant le créateur à son oeuvre. [21] Les idées et les faits sont de libre parcours, seule la forme de leur expression est protégée. Pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, il suffit que l'oeuvre soit « originale » [24]. L'originalité d'une oeuvre tient d'abord au fait qu'elle ne constitue pas une copie d'une oeuvre préexistante et qu'elle est le fruit de la création ou de l'effort intellectuel autonome de son auteur[25]. [22] Le droit d'auteur a deux composantes, un aspect économique, qui tient à l'importance d'assurer une juste rémunération de l'auteur dans l'exploitation de son oeuvre, afin de le stimuler ou l'encourager à la création d'oeuvres nouvelles et un aspect moral, portant davantage sur la reconnaissance de la paternité de l'oeuvre et au respect de son intégrité[26]. [23] La protection d'une oeuvre par le droit d'auteur crée, en faveur de l'auteur ou du titulaire de droits, le pouvoir exclusif de poser certains actes à l'égard de l'oeuvre, ainsi que le pouvoir exclusif d'autoriser de tels actes. [24] Essentiellement, en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, il s'agit du droit de « publication » de l'oeuvre; du droit de « reproduction » de la totalité ou d'une « partie importante » de l'oeuvre[27]; du droit de produire, reproduire ou publier une « traduction » [28]; du droit de confectionner un enregistrement sonore ou la mise sur un autre support qui en permettrait la reproduction[29]; du droit de communiquer au public par télécommunication l'oeuvre littéraire ou dramatique[30]. [25] La violation du droit d'auteur est la réalisation d'un acte exclusif à l'auteur, sans son consentement[31]. [26] Dans le contexte numérique, certains de ces droits exclusifs se confondent. En effet, la reproduction d'une oeuvre, qui est le noyau dur du droit d'auteur (copyright / right to copy), apparaît désormais comme une étape nécessaire[32], sinon incidente à la communication sur les réseaux d'information. [27] Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur reconnaît deux droits essentiels à la diffusion d'une oeuvre sur les réseaux d'information : le « droit de distribution » et le « droit de communication au public » . [28] S'agissant du droit de distribution, la définition s'apparente à la « publication » de la L.d.a.[33], i.e. le droit exclusif des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques d'autoriser « la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs oeuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. » (art. 6(1) du Traité de l'OMPI). [29] La publication d'une oeuvre porte donc sur la décision de mettre à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre. La diffusion sur Internet constitue une telle publication. En effet, bien que la présentation d'une oeuvre sur un site Web n'exige pas de la part de l'auteur (ou de l'éditeur) l'opération spécifique de reproduction de l'oeuvre pour sa distribution, chaque usager qui accède à l'oeuvre peut choisir, sous réserve de moyens techniques mis en place, de reproduire l'oeuvre de façon permanente sur son propre disque dur[34]. Il peut aussi choisir de l'imprimer, s'agissant des oeuvres littéraires, ou simplement de la consulter[35]à l'écran. [30] Mettre une oeuvre sur un site Web constitue donc une « publication » , si elle n'a pas déjà été autrement mise à la disposition du public, et à ce titre, doit être autorisée par l'auteur ou le titulaire de droits. Si l'oeuvre est déjà publiée, ou déjà accessible sur le réseau, la création d'un lien hypertexte vers la source officielle de diffusion apparaît comme un moyen de limiter l'atteinte au droit de l'auteur. Diffuser des oeuvres sur l'Internet, sans le consentement du titulaire, est donc susceptible d'engager la responsabilité du fournisseur de contenus. L'auteur pourrait réclamer, par la voie d'un recours judiciaire, soit le retrait de l'oeuvre, soit le paiement de redevances ou des dommages-intérêts, lorsque cette diffusion a été préjudiciable à son auteur. [31] S'agissant du droit de communication au public d'une oeuvre, le Traité de l'OMPI définit celui-ci comme incluant « la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée » (art. 8). [32] Ce droit semble assez bien adapté à la réalité de la diffusion d'une oeuvre sur Internet. Ce droit, reconnu à l'art. 3(1)f) de la L.d.a. (communication au public par télécommunication) semble s'appliquer également à la transmission par courrier électronique. Il importe alors de s'interroger à savoir s'il s'agit d'une communication privée ou individualisée ou d'une véritable communication « au public » [36]. [33] Pour qu'il y ait une communication au public, la communication doit être destinée à plus d'une personne. Lorsque la communication de l'oeuvre vise un groupe de personnes, faisant partie du public, la prudence inviterait sans doute à obtenir le consentement de l'auteur ou du titulaire de droits. [34] C'est ainsi sous l'angle du droit d'autoriser la diffusion sur le Web de dossiers judiciaires à caractère public, que la problématique du droit d'auteur est ici examinée. En effet, l'enregistrement numérique des audiences facilitera considérablement la diffusion de celles-ci sur l'Internet (sous forme sonore ou écrite). Un droit d'auteur pourrait-il être revendiqué? Si oui, par qui ? [35] Des droits d'auteur sur les procédures judiciaires pourraient émaner de plusieurs entités. À ce titre, voici quelques hypothèses :
[36] Évidemment, je n'ai pas la prétention d'apporter réponse à ces différentes questions, mais plutôt à amorcer la réflexion, à éveiller cette préoccupation de l'accessibilité et de la diffusion sur l'Internet des informations judiciaires. [37] La diffusion sur l'Internet est-elle devenue à tous égards le prolongement du droit d'accès? Le libre accès au droit devrait-il être étendu aux dossiers judiciaires ? Bien que les procédures judiciaires ne constituent pas toujours en soi un énoncé du droit, elles participent certainement au processus menant à cet énoncé. [38] Le droit d'auteur nous force à faire la distinction entre l'accès à un document présumé à caractère public, et sa diffusion ou « publication » sur le Web. En effet, l'accessibilité sur l'Internet constitue un acte de diffusion. À ce titre, s'il existe un droit d'auteur sur ces documents, leur mise à la disposition du public par le biais des réseaux devrait être autorisé par l'auteur ou le titulaire de droits. De plus, ce titulaire, s'il en est, pourrait mettre en place des mécanismes de contrôle de l'accès ou à tout le moins, exiger des frais pour celui-ci. Tout cela, à moins que des exceptions liées à l'intérêt du public à prendre connaissance de ces informations ne soient reconnues. L'accès aux informations juridiques et judiciaires[39] L'énoncé du droit par les lois et les jugements, on l'a vu, fait l'objet d'un libre accès sur l'Internet. Le droit d'accès aux règles de droit s'est ainsi traduit, dans notre société démocratique, par une accessibilité gratuite sur les réseaux. Par cela, l'État n'a cependant pas renoncé à l'exercice de ses droits d'auteur. Il a mis en place des mécanismes de contrôle visant à assurer l'intégrité de ces informations, laissant ainsi supposer que le secteur privé, en créant des services à valeur ajoutée, pourra à son tour se voir reconnaître des droits d'auteur. [40] La mise sous forme numérique des informations à caractère judiciaire pourrait susciter l'intérêt pour une diffusion sur l'Internet. L'enregistrement numérique des audiences, permettant une transcription automatisée, et le dépôt de pièces et d'actes de procédures sous forme numérique sont déjà à l'essai dans différents États américains. [41] Dans cette lignée, la disponibilité des informations judiciaires sous forme numérique a récemment mené, aux États-Unis, à l'énoncé de lignes directrices pour le développement d'une politique sur l'accès du public aux dossiers judiciaires[37]. La numérisation donne en effet la possibilité que ces informations soient diffusées sur le Web, qu'elles soient compilées, reproduites et distribuées. Cette nouvelle réalité invite donc à un réexamen attentif des règles relatives à l'accès aux dossiers judiciaires. Les lignes directrices proposées viennent rappeler le rôle des tribunaux dans la régulation de la publicité de leurs procédures et implicitement, semblent reconnaître l'existence d'un droit analogue au droit d'auteur (droit de propriété ou de contrôle) sur celles-ci. [42] Les tribunaux judiciaires ne sont pas assujettis à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels [38]. Ils ne constituent pas en effet des « organismes publics » au sens de cette loi [39]. La Commission d'accès à l'information (C.A.I.)[40]n'a donc pas compétence à l'égard des documents détenus par les tribunaux[41]. [43] Les règles d'accès aux dossiers judiciaires apparaissent plutôt dans les lois spécifiques aux matières de la compétence du tribunal, dans le Code criminel, dans le Code de procédure civile, dans les règlements (ou règles de pratique) de la cour concernée et dans la jurisprudence. [44] Les greffiers sont les gardiens des archives des tribunaux[42]. Le statut de cour d'archives[43] dénote une responsabilité dans la conservation et la gestion des dossiers judiciaires. Actuellement, la consultation des dossiers judiciaires se fait au greffe du tribunal concerné. La personne, dont l'identification peut être demandée, peut obtenir une copie des pièces du dossier, moyennant le paiement des frais fixés par le Tarif[44]. Les audiences des tribunaux (à l'exception de la Cour d'appel) font l'objet d'un enregistrement audio qui se substitue pour l'essentiel à la prise de notes sténographiques[45]. Le cadre juridique applicable à ces enregistrements (droit d'auteur, conditions d'accès, droit de copie et de diffusion) reste ambigu[46]. Les règles de pratique des tribunaux peuvent y pourvoir. Cependant, en principe, une transcription des audiences publiques ou d'extraits de celles-ci, moyennant paiement[47], peut être obtenue. [45] La conservation des témoignages sert d'abord aux fins d'un appel, mais peut aussi être utile pour les tiers concernés (tierce opposition), ainsi que pour le public ou la presse, dans son rôle de chien de garde des institutions publiques. [46] Cet accès par le public (plutôt que par les seules personnes directement concernées) n'a cependant pas pour effet de reconnaître un droit de reproduction, de diffusion ou d'utilisation inappropriée ou impropre de ces informations. Le droit de commenter, d'analyser et de critiquer ces informations, qui émanent du processus de création de l'État, apparaît néanmoins comme l'une des facettes de la liberté d'expression. Le caractère public des audiences[47] Le caractère public des audiences, considéré comme une composante d'un procès équitable[48], est consacré à l'article 13 du Code de procédure civile[49](C.p.c.), à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[50] et à l'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés[51]. Ces articles reconnaissent déjà certaines exceptions au libre accès des personnes à la salle d'audiences. [48] Le huis clos, en matière familiale et en protection de la jeunesse[52], vise à préserver l'intimité de la vie familiale. En matière criminelle, les étapes préliminaires au procès (mandats), sont souvent tenues ex parte ou à huis clos, pour des motifs liés à la protection de la présomption d'innocence, et à l'importance, pour une bonne administration de la justice, de prévenir la destruction de la preuve. Cependant, s'agissant de l'accès postérieur aux documents, la question demeure encore nébuleuse. La démonstration d'un intérêt à l'égard de cette information est parfois conditionnelle à l'accès[53]. Au cours du procès, une ordonnance de huis clos « pour la bonne administration de la justice » peut être prononcée si la présence du public est susceptible de créer un « préjudice indu » sur les victimes ou sur l'accusé (présomption d'innocence)[54]. [49] Les audiences tenues à huis clos échappent donc à la règle de la publicité, du moins au cours de leur déroulement. Si l'ordonnance de huis clos a été prononcée erronément, le public ou la presse peuvent, en guise de mesure remédiatrice, se voir reconnaître l'accès aux transcriptions des débats tenus à huis clos[55]. [50] En matière civile, les documents non admis ou non déposés en preuve échappent aussi, en principe à la règle de la publicité. Dans l'arrêt Lac d'Amiante[56],la Cour suprême du Canada a précisé que la « règle implicite de confidentialité » s'applique aux interrogatoires préalables[57]tenus en vertu du C.p.c. Comme ces interrogatoires ont un caractère exploratoire, qu'ils se déroulent généralement hors la présence du juge et qu'il appartient aux parties de décider si elles soumettent ou non en preuve les documents ou les informations obtenus à cette occasion, la Cour conclut que ceux-ci ne constituent pas une « audience » et échappent donc à la règle de la publicité. [51] C'est également en ce sens que la Commission de réforme du droit des Nouvelles Galles du Sud a conclu[58]. À moins qu'un document n'ait été lu, admis ou déposé en preuve, dans le cadre d'une audience publique[59], ou qu'il constitue la base d'une action[60], le public et les médias ne bénéficient pas d'un droit général d'accès. L'accès aux autres documents serait donc en principe réservé aux personnes directement intéressées (parties, tiers touché, avocats, etc.) [52] De plus, les juges, dans certaines circonstances exceptionnelles, peuvent prononcer des ordonnances de non-publication[61]. Celles-ci doivent être justifiées par un intérêt prépondérant, compte tenu de l'importance de la transparence du processus judiciaire, de l'équité des procédures et du droit du public de pouvoir prendre connaissance des affaires judiciaires. Ces ordonnances doivent être aussi limitées que possible pour assurer la protection des intérêts de la personne qui le requiert. Elles peuvent être spécifiques et n'empêcher que la publication de l'identité d'une victime ou d'un témoin, par exemple[62]. [53] Dans le cas des mineurs, la loi reconnaît la confidentialité du dossier[63] ou l'obligation de préserver l'identité des mineurs impliqués dans la procédure[64]et ce, dans le but de protéger la vie privée et de la vie familiale des enfants et adolescents et de favoriser leur réintégration sociale dans la communauté. Malgré la confidentialité de principe, l'accès aux dossiers en protection de la jeunesse peut être autorisé par le juge, sur requête écrite, à des fins d'études, d'enseignement et de recherches, à la condition que soit respecté l'anonymat de l'enfant et de ses parents[65]. [54] Cela démontre que la finalité poursuivie par l'accès est un des aspects pertinents à l'autorisation de celui-ci, reconnaissant ainsi une forme de droit à l'utilisation équitable de ces dossiers, à des fins d'éducation et d'information. [55] Bien que les conditions ou règles d'accès aux « dossiers judiciaires » ne soient pas établies par la Loi sur l'accès, certaines des exceptions qu'il contient pourraient, par analogie[66], être transposées en matière d'accès aux dossiers judiciaires. Au premier chef, ce droit d'accès s'exerce sous réserve de la protection des renseignements personnels concernant une personne. Ce droit d'accès s'exerce aussi sous réserve des droits d'auteur[67]. [56] Cela suggère que dans le cas d'oeuvres protégées, la personne qui demande l'accès peut être assujettie à des conditions l'empêchant de reproduire, de diffuser ou d'exploiter commercialement cette oeuvre, sauf avec le consentement de l'auteur ou du titulaire de droits. [57] De même, il serait possible de reconnaître un droit d'auteur sur les pièces mises en preuve dans une procédure judiciaire[68]. [58] Outre le droit d'auteur pouvant découler d'une participation à une instance judiciaire, il est aussi important de reconnaître qu'une partie qui s'engage dans un débat judiciaire, particulièrement si elle y est contrainte, ne perd pas nécessairement toute expectative de vie privée[69]. L'utilisation équitable des documents juridiques et judiciaires[59] Une fois l'oeuvre mise à la disposition du public sur l'Internet, avec l'autorisation du titulaire de droits, la reproduction et la réutilisation de celle-ci ne constituera pas une violation du droit d'auteur si elle tombe sous l'exception de l'utilisation équitable. [60] Cette notion vise à assurer l'équilibre entre les intérêts des auteurs à protéger leurs droits et l'intérêt du public à en prendre connaissance, à les commenter, à contribuer, par leur analyse, à l'information plus large du public. [61] En vertu de la L.d.a., l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins d'étude privée ou de recherche[70] ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Également, l'utilisation équitable aux fins de critique ou de compte-rendu[71] ou encore à des fins de communication de nouvelles[72] ne constitue pas une violation du droit d'auteur s'il y a mention de la source et du nom de l'auteur. D'autres exceptions s'appliquent aussi aux établissements d'enseignement[73], aux bibliothèques, musées et services d'archives[74]. [62] L'utilisation équitable d'une oeuvre commande donc généralement la mention de la source et de l'auteur et l'utilisation de celle-ci de façon à ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur (économiques et moraux). [63] D'autre part, la citation d'extraits d'une oeuvre littéraire ne constitue pas une violation du droit d'auteur[75], dans la mesure où la reproduction ne porte pas sur une partie importante de l'oeuvre[76]. [64] De même, la reproduction réalisée pour les fins d'une procédure judiciaire est reconnue dans la législation de certains États[77]. [65] Les droits d'auteur attachés à la confection de résumés, au choix des mots-clés, à l'intitulé, à l'index, à la réalisation d'un recueil ou d'une compilation[78] d'oeuvres peut également donner lieu à une protection indépendante, si elle rencontre l'exigence d'originalité[79]. Les oeuvres incluses dans la compilation ne perdent toutefois pas leur protection[80] à l'égard d'une reproduction subséquente. [66] Ainsi, un fournisseur de contenus qui souhaite se lancer dans la diffusion des informations juridiques sur l'Internet devrait prendre les mesures nécessaires pour obtenir le consentement de l'auteur ou du titulaire de droits. Il devrait aussi fournir un effort créatif dans la réutilisation de ces informations, afin de bénéficier de la protection du droit d'auteur[81]. [67] S'agissant de procédures ou de dossiers judiciaires, une autre considération importance pourrait devoir s'appliquer :
[68] Pour les responsables de la gestion de ces informations, une procédure spécifique d'accès, de rectification et de retrait pourrait être mise en place. En effet, dans certains cas, les personnes ayant été l'objet de procédures judiciaires pourraient réclamer le droit à l'oubli (personnes innocentées ou pardonnées). CONCLUSION[69] Bien que les lois et les jugements soient aujourd'hui accessibles gratuitement sur l'Internet, il semble difficile de transposer ce libre accès aux dossiers et aux procédures judiciaires. [70] Une clarification des règles applicables apparaît néanmoins souhaitable pour faire à cette nouvelle ou éventuelle réalité. Le législateur, les tribunaux, les juges, les parties et les témoins à une instance judiciaire, de même que la communauté juridique, les auteurs, la presse et le public sont tous interpellés. [71] L'accessibilité à l'information juridique est essentielle à la connaissance du droit. Et cette connaissance contribue intimement à la participation du public à la vie démocratique. [72] En outre, de façon à réduire les risques d'une diffusion désordonnée ou préjudiciable de l'information, les fournisseurs de contenu et les intermédiaires devraient pouvoir offrir des garanties de fiabilité, de compétence et de professionnalisme dans la diffusion et dans l'utilisation de ces informations. [73] De nouveaux mécanismes de contrôle de l'accès, compatibles avec les exigences de publicité, devront se développer. [74] C'est donc à la détermination de ce nouvel équilibre que nous sommes aujourd'hui, et dans les mois, sinon années à venir, conviés... [1] Sophie Hein, LL.M., est avocate, à l'emploi du Ministère de la Justice du Québec comme agente de recherche en droit (shein@justice.gouv.qc.ca). Les opinions émises ici n'engagent cependant que la responsabilité de l'auteure. Son mémoire de maîtrise, réalisé au Centre de recherche en droit public (C.R.D.P.), Université de Montréal, a été publié sous le titre L'information gouvernementale : vers un droit d'accès sur l'inforoute?, Montréal, Éditions Thémis, 1997, 308 p. [2] Voir sur le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le texte de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques : http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo001fr.htm [3] Art. 3 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté à Genève en 1996, appliquant les articles 2 à 6 de la Convention de Berne : http://www.wipo.org/treaties/ip/wct/index-fr.html Le Canada a signé ce Traité en décembre 1997, mais avant sa ratification, le ministre responsable a souhaité procéder à une révision de la loi. En vertu de l'art. 92 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C., c. C-42, un rapport sur l'application de la loi doit etre présenté à l'automne 2002, faisant suite à la révision de 1997 accordant des droits voisins (artistes-interprètes, copie privée et utilisation équitable), L.C. 1997, c. 24 (projet de loi C-32). Sur le processus de révision de la loi, voir : http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rp01100f.html [4] La France, la plupart des États européens et les États-Unis, notamment. Voir André Françon, « Le modèle français, les pays continentaux et la Convention de Berne » (1996) 30 Revue juridique Thémis 194-203, 198. Aux États-Unis, dans Wheaton v. Peters, 33 U.S. 591 (1834), la Cour suprême avait conclu qu'un « reporter » ne peut prétendre à aucun « copyright » sur les décisions judiciaires et incidemment, qu'un juge n'a pas à accorder un tel droit au « reporter » . Dans une décision subséquente, il a cependant été décidé qu'un « reporter » qui ajoutait à la décision pouvait lui bénéficier d'un droit d'auteur pour ces ajouts : Callaghan v. Myers, 128 U.S. 617 (1888), voir aussi Brian R. Price, « Copyright in Government Publications : Historical Background, Judicial Interpretation, and Legislative Clarification » , (1976) 74 Military Law Review 19-65, 21 et suiv. [5] Art. 12 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C., c. C-42 : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/; « 12. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre. » Voir aussi les textes de la conférence organisée par le Centre de recherche en droit public (C.R.D.P.) et la Faculté de droit de l'Université de Montréal, le 12 mai 1995, consacrée à cette question « Le droit d'auteur de la Couronne à l'heure de l'autoroute de l'information » , publiés dans (1996) 30 Revue juridique Thémis 151-319. [6] Voir Lawpost v. New Brunswick, (2000) 182 D.L.R. (4th) 167 (N.B.C.A.), rejetant l'appel contre la décision du juge Russell, Cour du Banc de la Reine, division de première instance, [1999] A.N.B. no 216 (QL), et déclarant l'absence de cause d'action contre les tribunaux judiciaires et l'Assemblée législative pour le refus d'autoriser à un éditeur privé l'accès aux lois, aux décisions judiciaires et aux transcriptions, afin d'agir comme intermédiaire dans la diffusion du droit. Requête pour permission d'en appeler en Cour suprême rejetée le 17 août 2000; voir aussi Wilson & Lafleur c. SOQUIJ, [2000] R.J.Q. 1086 (C.A.), J.E. 2000-856, Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-09-007235-989, 17 avril 2000. [7] Tolmie c. Canada (Procureur général), [1997] 3 C.F. 893, requérant un exemplaire des lois révisées du Canada sous forme de fichier informatique, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C., c. A-1. Cet accès lui a été refusé au motif que, depuis sa demande initiale, une version informatique de ces lois avait été mise à la disposition du public (art. 68a) de la Loi sur l'accès), soit au motif que les documents demandés étaient déjà publiés ou mis en vente dans le public. [8] Wilson & Lafleur c. SOQUIJ, [2000] R.J.Q. 1086 (C.A.), J.E. 2000-856, Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-09-007235-989, 17 avril 2000, juges Vallerand, Fish et Philippon, cet arrêt est aussi accessible à : www.barreau.qc.ca/varia/500-09-007235-989.pdf La Cour d'appel a ainsi infirmé le jugement de première instance (C.S., Montréal, 500-05-030378-978, 1998-09-21, [1998] R.J.Q. 2489 (C.S.) (J.E. 98-1880), juge Jean-Jacques Croteau). [9] On reprochait aussi à la SOQUIJ, sa sélection des jugements publiés, selon les règles énoncées dans le Règlement sur la cueillette et la sélection des décisions judiciaires, (1986) 118 G.O. II 786, laissant sous silence un certain nombre de jugements. Voir aussi Loi sur la Société québécoise d'information juridique, L.R.Q., c. S-20. [10] Géré par SOQUIJ et les Publications du Québec (l'Éditeur officiel). [11] De plus, on peut suggérer que la présentation actuelle, par cour ou tribunal, par mois et par date, sans engin de recherche, soulève certaines préoccupations. L'invitation à consulter chaque décision rendue n'a-t-elle pas pour effet d'ouvrir la voie et de faciliter les atteintes aux droits de la personnalité des parties ou des témoins à l'instance ? [12] Sur la valeur ajoutée ou la protection indépendante accordée aux oeuvres de doctrine, voir CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2002] F.C.J. No 690, 2002 FCA 187; demande de permission d'en appeler devant la Cour suprême du Canada, déposée le 27 août 2002 (no 29320), voir : http://www.scc-csc.gc.ca/information/index_f.html [13] http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca. Voir Normes en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion des droits d'auteur des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement, parues Gazette officielle du Québec (Partie II, No 43, 25 octobre 2000), voir http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fr/droitauteur/html/gestion.dbml, entrées en vigueur le 1er novembre 2000. [14] L'article 165 de la loi (Copyright, Designs and Patents Act 1988) reconnaît au Parlement un copyright, le « Parliamentary Copyright » ; voir aussi http://www.parliament.uk/site_information/parliamentary_copyright.cfm [15] Il s'agit du HMSO (Her Majesty's Stationery Office) dont l'octroi de licences fait l'objet d'une politique assez détaillée. Cette approche est le fruit de consultation et réflexions menées dans le cadre du Livre vert Crown Copyright in the Information Age, janvier 1998 : http://www.hmso.gov.uk/document/cfcont.htm; et du Livre blanc intitulé The Future Management of Crown Copyright, mars 1999 : http://www.hmso.gov.uk/document/copywp.htm. [18] Décret sur la reproduction de la législation fédérale, C.P. 1996-1995 19 décembre 1996 : http://canada.justice.gc.ca/loireg/crown_fr.html [19] Voir http://www.legifrance.gouv.fr/html/accueil.htm; aussi Décret n ° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de diffusion du droit par l'Internet, paru au Journal officiel, Numéro 185 du 9 Août 2002, page 13655 (entré en vigueur le 15 septembre 2002), créant un « service public de diffusion du droit par l'Internet » ayant pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence. Le Décret prévoit que des licences de réutilisation des données peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent en faire usage. Une convention précise les conditions d'utilisation, dont notamment l'engagement du bénéficiaire à assurer la fiabilité de ces données. Voir http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_jo.html [20] Voir, entre autres, Nicolas SAPP, « Le droit d'auteur de la Couronne à l'ère des nouvelles technologies de l'information » , dans Actes de la XIVe Conférence des juristes de l'État, 1999, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 165-192. [21] Voir Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur public, Bruxelles, le 5 juin 2002, COM(2002) 207 final : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/reg/fr_register_132060.html ; Règlement (CE) n ° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, paru au Journal officiel n ° L 145 du 31/05/2001 p. 0043 - 0048 : voir http://europa.eu.int/eur-lex/fr/news/20020117_01.html, ainsi que la Directive 2001/29/EC du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [22] Lexum : http://www.lexum.umontreal.ca/ ; CanLII ou Institut canadien de l'information juridique (IIJCan) : http://www.canlii.org/index_fr.html ; et AustLII (Australian Legal Information Institute) : http://www.austlii.edu.au/ ont aussi grandement contribué à cette évolution. [23] Voir art. 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=fr « droit de propriété » : 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée. [24] Art. 5(1) de la Loi sur le droit d'auteur. [25] Voir CCH Canadian Ltd. V. Law Society of Upper Canada, [2002] F.C.J. No 690, 2002 FCA 187, par. 221. [26] Art. 14.1 et 14.2 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C., c. C-42 : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/ , qui incluent le droit de paternité et le droit à l'intégrité de l'oeuvre. Sur la violation des droits moraux, voir art. 28.1 et 28.2 de la L.d.a. Selon l'article 28.2(1), « [i]l n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution » . [27] Art. 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur. [28] Art. 3(1) a) L.d.a. [29] Art. 3(1) d) L.d.a. [30] Art. 3(1) f) L.d.a. [31] Art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur. [32] Voir Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) c. Association canadienne des fournisseurs Internet, [2002] A.C.F. no 691, où le juge minoritaire (j. Sharlow) se distingue de la majorité en étant d'avis que la reproduction par mise en antémémoire d'une oeuvre musicale est « nécessaire » à la communication des oeuvres sur l'Internet et en ce sens, que les intermédiaires, comme les fournisseurs d'accès à l'Internet, devraient pouvoir bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.4(1)b) de la Loi sur le droit d'auteur. [33] Selon l'art. 2.2(1) L.d.a., la « publication » d'une oeuvre est définie comme « la mise à la disposition du public d'exemplaires d'une oeuvre » [34] Selon le format sur lequel l'information est numérisée (.doc, .html, .pdf), les risques d'altération, de modification ou de reproduction de l'oeuvre varient. [35] Dans les deux cas, il y a techniquement « reproduction » de l'oeuvre, même si c'est de façon temporaire. [36] Voir le jugement de la Cour d'appel fédérale dans CCH, précité, où la transmission par télécopieur d'une photocopie d'une oeuvre protégée n'a pas été retenue comme une violation du droit d'auteur, compte tenu de l'insuffisance de preuve sur le caractère répétitif de la transmission, pouvant équivaloir à une communication « au public » plutôt qu'à une seule personne déterminée, par. 100-101. [37] Voir Public Access to Court Records : Guidelines for Policy Development by State Courts, 16 juillet 2002 : http://www.courtaccess.org/modelpolicy/ [38] Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 [39] Art. 3 (3 ° ) de la Loi sur l'accès québécoise, L.R.Q., c. A-2.1 : « Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). » [40] Voir sur le site de la Commission d'accès à l'information : http://www.cai.gouv.qc.ca/fra/biblio_fr/bib_loi_fr.htm [41] Cette règle a été étendue au Conseil de la magistrature, dans l'exercice de ses fonctions d'examen des plaintes; voir Conseil de la magistrature du Québec c. Commission d'accès à l'information, [2000] R.J.Q. 638 (C.A.), J.E. 2000-549, 24 février 2000, A.I.E. 2000AC-19, aussi sub nom Robert c. Québec (Conseil de la magistrature), [2000] J.Q. N ° 470 (QL), parce que le Conseil de la magistrature constitue un « forum judiciaire » (par. 92, j. Baudouin pour la Cour). Dans une affaire portant sur l'accès aux notes prises par des commissaires du Conseil canadien du travail, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Privacy Act), L.R.C., c. P-21, art. 12(1)b) : Canada (Privacy Commissioner) v. Canada (Labour Relations Board), [1996] F.C.J. No 1076 (Cour fédérale); confirmée en appel, [2000] F.C.J. No 617 (F.C.A.), il a été décidé que ces notes ne font pas partie du dossier officiel du Conseil, ni ne sont sous le contrôle de celui-ci; les notes sont celles des décideurs. Aucune loi n'oblige à la prise de notes. La Cour rappelle que la loi constitutive du Conseil lui reconnaît le droit d'adopter des règles concernant l'accès aux dossiers. [42] Voir notamment art. 62(6 ° ) de la Loi sur les cours municipales, L.R.Q., c. C-72.01 et art. 141 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16. [43] Voir art. 27 de la Loi sur les cours municipales, L.R.Q., c. C-72.01 et art. 84 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16. Voir aussi sur la notion de cours d'archives : Karim BENYEKLHEF, « La notion de cour d'archives et les tribunaux » (1988) 22 R.J.T. 61; aussi Pierre E. AUDET, « La publicité des procès et l'accessibilité aux archives judiciaires » (1984) Cahiers de l'Institut québécois de l'administration judiciaire 26. [44] Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, (1995) 127 G.O.Q. II. No 11, 15 mars 1995, p. 1234. [45] Voir à ce sujet Association professionnelle des sténographes officiels du Québec c. Québec (Procureur général), [1999] J.Q. no 1850 (C.A.Qué.), Montréal, 500-09-006686-984, 11 juin 1999, juges Mailhot, Brossard et Delisle; Règlement sur l'utilisation d'appareils d'enregistrement du son pour l'enregistrement des dépositions des témoins, R.R.Q. 1981, c. C-25, r.10; Loi sur les sténographes, L.R.Q., c. S-33 [46] La Convention de Berne sur les droits d'auteur reconnaît aux États la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires (art.2bis(1)). Cet article reconnaît aussi aux États la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public ou faire l'objet de communications publiques, lorsqu'une telle utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre (art. 2bis(2)). L'auteur jouit toutefois du droit exclusif de réunir en recueil de telles oeuvres (art. 2bis(3)). Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur ne touche pas à ces principes (art. 3 du Traité de l'OMPI). [47] Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, R.R.Q., c. S-33, r.2, art. 12 et 13. [48] Voir art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » [49] Art. 13 du Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25.1 : 13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu'elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n'ordonne dans l'intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l'instance. Le présent alinéa s'applique malgré l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12). Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l'application du huis clos à l'égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1). [50] Art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 : 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Adoptée le 27 juin 1975, le texte de la Charte québécoise est notamment accessible sur le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : http://www.cdpdj.qc.ca/htmfr/htm/4_4.htm [51] Art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982 : http://laws.justice.gc.ca/en/charter/const_fr.html : 11. Tout inculpé a le droit : (...) d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; [52] Voir art. 82 de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1. Un journaliste peut néanmoins se voir accorder l'accès à la salle d'audience, à moins que sa présence ne cause un préjudice à l'enfant. [53] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175 : pour la majorité, une fois qu'un mandat de perquisition a été exécuté et que les objets ont été présentés devant un juge de paix, le public et les personnes directement concernées ont le droit de consulter le mandat et la dénonciation qui s'y rapporte. Pour les juges dissidents, ces procédures, préliminaires au procès, ne se déroulant pas en audience publique, l'accès à ces documents devrait être restreint aux personnes qui peuvent démontrer qu'elles sont concernées de façon directe et réelle. [54] Art. 486(1) du Code criminel, L.R.C., c. C-46 : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/ [55] voir Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480 : http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1996/vol3/html/1996rcs3_0480.html [56] Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743 : http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/2001/vol2/html/2001rcs2_0743.html : pour le jugement de la Cour d'appel : [1999] R.J.Q. 970 (C.A.) [57] Art. 398 et suiv. C.p.c. [58] Law Reform Commission of New South Wales, Discussion Paper 43 (2000) - Contempt by Publication, 11. Access to and reporting on court documents : http://www.lawlink.nsw.gov.au/lrc.nsf/pages/dp43chp11 [59] Smith v. Harris, [1996] 2 VR 335 [60] R. v. Clerk of Petty Sessions; Ex Parte Davies Brothers Ltd (Tasmania, Supreme Court, 19 novembre 1998) [61] Voir art. 486(3) du Code criminel, L.R.C., c. C-46; dans l'arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743 , par. 43, la Cour mentionne : « Seuls des motifs qui resteront d'exception, comme par exemple l'intérêt d'une partie à la protection de secrets commerciaux ou des privilèges de confidentialité particuliers comme le secret professionnel ou le huis clos attaché à certains débats relatifs à l'état des personnes, conduiront le tribunal à maintenir un secret partiel ou complet sur certaines informations, pendant le procès et dans les dossiers judiciaires. » [62] Voir aussi R. v. O.N.F., 2001 CSC 77 et R. v. Mentuck, 2001 CSC 76, concernant une ordonnance de non-publication sur l'identité des policiers et les tactiques employées dans le cadre d'une procédure d'enquête policière. [63] Les dossiers en matière d'adoption sont confidentiels (art. 582 C.c.Q.), de même que les dossiers en protection de la jeunesse (art. 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1). Seules les personnes désignées par la loi peuvent avoir accès aux dossiers du mineur. La personne qui se voit reconnaître l'accès doit cependant s'assurer du respect de la confidentialité (art. 96.1 de la L.P.J.) [64] Art. 83 L.P.J. Voir aussi art. 38 et suiv. de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C., c. Y-1. Cette loi sera remplacée, à compter du 1er avril 2003 par la nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 (projet de loi C-7). Les règles d'accès aux dossiers des adolescents trouvés coupables d'infractions graves seront élargies : voir Partie VI de la loi, art. 110 et suiv. [65] Art. 97 L.P.J. [66] L'article 28 de la Loi sur l'accès crée aussi une exception à l'accès lorsque la divulgation des renseignements est susceptible d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne exerçant des fonctions judiciaires (par. 1 ° ); lorsqu'elle est susceptible de causer un préjudice à la personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet (par. 5 ° ); et lorsque cette divulgation est susceptible de porter atteinte au droit d'une personne à une présomption d'innocence (par. 9 ° ). [67] Art. 12 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1: « 12. Le droit d'accès à un document s'exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle. » [68] Voir aussi Commission de réforme du droit du Canada, Document de travail 56, L'accès du public et des médias au processus pénal, Ottawa, 1987, recommandation 20, sur l'accès aux pièces. Le tribunal pourrait rendre une ordonnance limitant le droit du public de tirer copie de certaines pièces pour protéger tout droit réel sur la pièce. [69] Et ce, bien que les propos de la Cour suprême dans Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743 , par. 42, semble nous inciter à la conclusion inverse « même si des dossiers ou des informations sont confidentiels ou relèvent de la vie privée, la partie qui engage un débat judiciaire renonce, à tout le moins en partie, à la protection de sa vie privée. » ; voir, soutenant la reconnaissance d'une expectative de vie privée dans le cadre d'une participation à une procédure judiciaire, Daniel J. SOLOVE, « Access and Aggregation : Public Records, Privacy, and the Constitution » , disponible à http://www.courtaccess.org/indexpage_x.htm [70] Art. 29 de la L.d.a. [71] Art. 29.1 de la L.d.a. Voir aussi art. 32.2 c) et e) L.d.a. à l'égard des compte-rendus de conférence faite en public ou d'une allocution de nature politique prononcée lors d'une assemblée publique. [72] Art. 29.2 de la L.d.a. [73] Art. 29.3 et suiv. L.d.a. [74] Art. 30.1 et suiv. L.d.a. [75] Voir art. 10(1) de la Convention de Berne l'article 10(1) de la Convention de Berne qui prévoit qu'est licite la citation tirée d'une oeuvre déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elle soit conforme aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre. La citation doit cependant faire mention de la source et de l'auteur (art. 10(3)). [76] Voir Pierre TRUDEL et al., Droit du cyberespace, Montréal, Éditions Thémis, 1997, pp. 16-88 et suiv. [77] Voir art. 45(1) du Copyright, Designs and Patents Act 1988 : « copyright is not infringed by anything done for the purposes of parliamentary or judicial proceedings » ; voir aussi art. 43(1) du Copyright Act 1968 des Nouvelles-Galles du Sud : « copyright (...) is not infringed by anything done for the purposes of judicial proceedings or of a report of a judicial proceedings » , cité dans Community Law Reform Program : Sound Recording of Proceedings of Courts and Commissions : The Media, Authors and Parties, Report 39 (1984) - Appendix A: http://www.lawlink.nsw.gov.au/lrc.nsf/pages/R39APPENDIXA Au Canada, cette question est examinée dans le cadre de la révision du droit d'auteur. [78] La compilation est définie à la L.d.a., comme étant des « oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. » Voir aussi art. 5 du Traité de l'OMPI : « Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation. » [79] Voir CCH, précité. [80] Concernant les droits des pigistes à consentir à l'inclusion subséquente de leurs articles (journal) dans une banque de données, voir Robertson v. Thomson Corp., (2001) O.J. No 3868 (Ont.Ct. J.) (QL); New York Times Co. v. Tasini, 121 S. Ct. 2381 (2001); Tasini c. New York Times Co., 206 F. 3d 161 (2nd Cir. 2000); Tasini c. New York Times Co., 971 F. Supp. 804 (SDNY 1997). [81] Voir CCH, précité. 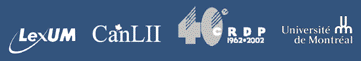 |
