
Les rapports des médias et de la magistrature : le choc de deux paradigmes Richard Langelier [1] Le présent atelier est convié à réfléchir et à échanger sur les rapports entre la diffusion d'informations juridiques et judiciaires sur Internet et la protection de la vie privée. [2] Sans aucun doute, il s'agit là d'un sujet d'une grande importance, car la protection des attentes légitimes en matière de vie privée, tout comme celle du droit du public à l'information, constituent des valeurs structurantes et fondamentales dans une société libre et démocratique. [3] Les normes juridiques internationales et canadiennes en la matière illustrent, réflètent et trahissent les valeurs sous-jacentes qui structurent ces éléments normatifs. Ces valeurs s'inscrivent donc au creux des normes juridiques et il est possible de dessiner une sorte de géographie des hiérarchies de valeurs présentes dans une société donnée à partir de l'articulation différenciée et spécifique que fait cette société des normes en la matière. [4] Il ne me sera pas possible de présenter rapidement la vaste étude que j'ai réalisée récemment sur la question, dans le cadre de ma thèse de doctorat en droit et de résumer succinctement un texte qui fait plus de 1600 pages. [5] Ainsi, je me contenterai d'attirer votre attention sur un certain nombre de points qui font en sorte que le dialogue et les rapports entre la constellation médiatique et celle du droit constitue un élément fondamental dans nos sociétés contemporaines et ce, qu'elles soient du Nord ou du Sud, même si les enjeux sont forcément différenciés dans des sociétés qui ne partagent pas entièrement les mêmes conditions matérielles et culturelles. [6] En effet, il ne saurait y avoir de démocratie véritable sans une magistrature indépendante et sans une presse libre. La structuration des rapports entre les deux protagonistes en cause constituera même un enjeu majeur pour assurer le développement et la survie de cette même démocratie. [7] Constituant les deux colonnes du temple de la démocratie, les médias et la magistrature doivent être suffisamment éloignés l'un de l'autre pour que la portée de l'édifice soit assurée. S'ils sont trop éloignés ou trop rapprochés, l'édifice menacera de s'effondrer. [8] Cette analogie, empruntée à un auteur célèbre, marque bien les contingences et limites qui structurent ces rapports et dont les normes juridiques rendent compte. [9] Mais qu'ont donc à s'apprendre ces deux continents de normativité que constituent l'information journalistique et l'énoncé des normes juridiques réalisé par le biais de la diffusion des jugements et arrêts de nos tribunaux ? [10] En fait, comme on le verra, le problème de la diffusion du droit pose celui plus général de l'information dans nos sociétés et les deux constellations en cause sont liées plus qu'on ne saurait l'imaginer par des rapports structurels de dépendance et de collaboration, même si les deux protagonistes s'efforcent de montrer le monde et de le construire selon des paramêtres où leurs intérêts spécifiques, leurs cultures, les contraintes technologiques qui marquent leurs univers trouvent aussi à s'exprimer. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme de paradigme pour qualifier les deux constellations en cause. [11] Pour établir les bases de l'analyse, il faut d'abord partir de la description des protagonistes en cause, saisir le droit et l'information dans toutes les dimensions de leur réalité phénoménologique comme à travers l'épaisseur historique des institutions qui les supportent. Il faut encore mettre en parallèles, dans un rapport critique et dialectique, la société, le droit et l'information et leurs supports humains et technologiques dans toutes les surfaces et les moments de leur interaction et comme expression différenciée et spécifique du conflit des intérêts des uns et des autres, comme moment historique de la conviction comme mode de régulation sociale, pour ensuite saisir ce rapport sous l'angle matériel de la division du travail, dans l'horizon concrétisé par l'émergence des juristes, des notables de la robe, pour reprendre la belle formule wébérienne, et des journalistes, pour finalement retrouver l'expression moderne de cette interaction comme discours formalisé, comme savoir ou comme logique communicationnelle. [12] Dans nos sociétés contemporaines, un rôle nouveau fut confié à la magistrature, celui de créer le droit, et non plus seulement celui de le dire. Ces changements marquent les évolutions des rapports de forces internes au sein de l'État, tout en posant des défis très importants au paradigme juridique devant légitimer son action dans la Cité, alors que ses liens avec la société civile n'ont pas toujours été le trait marquant ou distinctif de ce pouvoir. Comme tout pouvoir, la magistrature doit pouvoir diriger, si elle veut pouvoir imposer ses conceptions et convictions, si elle désire faire partager sa vision des rapports sociaux et des valeurs qu'elle considère cardinales. Or, pour diriger, il faut pouvoir convaincre, légitimer son action et ses conceptions, éduquer sur les enjeux qui se posent dans la société. [13] Par ailleurs, si nous tentons d'appréhender l'État dans sa matérialité institutionnelle et dans ses fonctions essentielles, il nous faut admettre qu'une structure étatique moderne inclut un vaste ensemble d'appareils et de fonctions idéologiques privées (dont les médias font partie), ce qui induit la présence de plusieurs variables de l'idéologie comme mode de normalisation. [14] Dans les sociétés modernes c'est la région juridico-politique qui domine, mais aussi décline. L'information, comme mode nouveau de normalisation des sociétés, devient de plus en plus importante et a connu des développements qualitatifs, qui découlent des rapports sociaux nouveaux ayant émergé dans la dernière période et des évolutions technologiques qui en sont le pendant. [15] Le point de contact où tente de s'exercer l'hégémonie d'un groupe ou d'un autre est donc l'opinion publique où se rencontrent la société civile et la société politique. D'où l'appel au public comme mode de légitimation qui marquera autant le paradigme juridique que celui de l'information. En pratique, l'opinion publique constitue le véritable tribunal de la Cité, comme l'avait déjà souligné Thomas Moore. Tocqueville avait aussi remarqué que ce qui permet la constitution d'une opinion commune et publique, c'est la petite propriété comme condition communément répandue. D'où le fait que le jury, dans la rhétorique juridique contemporaine, conserve une place de choix comme expression historiquement et socialement située de la conscience publique. [16] En fait, dans tous les types de sociétés humaines que nous avons analysés, nous pouvons dessiner une sorte de géographie de l'appel au public comme mode de normalisation de la société où les stratégies différenciées des groupes s'exposent avec une relative clarté. Le procès et l'exécution de la sentence constituent un archétype du pouvoir et des modes de légitimation qui sont alors mis à contribution. Ces modes, parfois pittoresques ou fort sophistiquées, touchent d'abord les pairs ou de larges segments de la population, prennent des formes religieuses ou laïques, utilisent d'abord la violence ou font plus largement appel à la conviction, etc. Mais c'est dans la mise en forme de ces caractéristiques, dans l'utilisation différenciée et singulière de ces modes de normalisation que se dessineront certains contours et certaines caractéristiques des sociétés humaines. [17] En ce sens, la tension entre le huis clos et la transparence illustre l'acuité de la lutte des protagonistes et révèle les valeurs cardinales de ces sociétés. Dans la société libérale et capitaliste qui s'érige dans le sillage de la Révolution française et de l'esprit des Lumières, l'ouverture devient cependant un standard et une caractéristique fondamentale et s'incarne autant par le développement et les luttes de la presse que par l'ouverture des procédures judiciaires. Un lien dialectique peut d'ailleurs être établi entre ces deux phénomènes, puisque les procès par journaux datent aussi de l'époque où les procès sont devenus publics... [18] Dans nos sociétés actuelles, il ne faudrait pas croire que les contradictions entre les médias et la magistrature sont sans importance, qu'il ne s'agit que d'une lutte corporatiste sans signification pour la majorité de la population. L'expérience des pays du « socialisme réel » a bien montré le contraire. Toutefois, il faut aller plus loin et comprendre les enjeux qui se cachent derrière les stratégies spécifiques des protagonistes. [19] Si, pour toutes les parties en cause, l'ouverture et la transparence sont des moyens de l'hégémonie, pour la magistrature il s'agit surtout d'éviter l'erreur judiciaire qui menace l'hégémonie acquise tout en acceptant, sa réalité institutionnelle et fonctionnelle l'exige, de jouer le côté obscur de la mission civilisatrice du droit, le côté répressif, qui exercé ouvertement et par sa théâtralité, implique la mise en oeuvre des mécanismes de la crainte. Mais pour pouvoir exercer cette fonction, une large ouverture constitue une nécessité impérieuse. D'où l'obligation pour la magistrature de se situer en partie sur le même plan ou le même terrain que celui des médias et des acteurs qui les possèdent, y travaillent ou les défendent. [20] Ces similitudes entre les outils des juristes et des journalistes sont encore augmentées quand nous prenons en compte les intérêts spécifiques des avocats, pour lesquels la maxime vir probus dicendi peritus[1] met en lumière une utilisation de procédés normatifs qui sont parents de ceux qu'utilisent les journalistes. Comme Karpik[2] l'a aussi montré, autant les avocats que les journalistes contribuent aux transformations qui marquent l'avènement de la démocratie libérale et qui s'expriment par une extension considérable de l'espace public et la transformation du public, du peuple, en peuple-souverain, même si les règles du marché viendront diviser, compartimenter, différencier ces groupes sociaux par la suite. [21] L'ouverture totale du procès, ce qui pour les juges et magistrats mènerait à une dérive certaine, constitue le point de cristallisation des intérêts de l'autre protagoniste qui refuse d'y voir une foire d'empoigne et un processus marchand, mais plutôt une façon moderne et nécessaire de normaliser la société. Cette rhétorique de la constellation médiatique néglige toutefois de mettre en lumière le fait que c'est dans le sillage du développement de la presse commerciale que nous avons vu naître la couverture extensive et moderne des procès. Cette couverture devient alors un plat de résistance important en termes de contenu des journaux (avec le feuilleton littéraire, à une certaine époque), et un élément essentiel de sa rentabilité commerciale et de son développement économique. Conjuguées aux transformations sociologiques des populations (à leur urbanisation et à leur scolarisation), ainsi qu'aux changements technologiques (qui modifieront radicalement les transports, la cueillette et la diffusion des informations, les procédés d'impression, etc.) ces modifications feront naître les médias que nous connaissons aujourd'hui et qui sont profondément marqués par des dérives sensationnalistes qui touchent aussi la façon de couvrir les activités judiciaires. [22] L'état du droit sur les questions afférentes aux rapports de la presse et de la magistrature, à une époque donnée, constitue donc un portrait du rapport de force présents dans une société. [23] La constitutionnalisation de la liberté d'expression, à laquelle nous avons assisté dans plusieurs pays récemment, et les conséquences juridiques qu'elle entraîne peuvent donc être vues comme une manifestation de cette confrontation et comme crise de ces instances de l'État, et peut-être même comme crise de l'État, crise qui touche autant les valeurs sous-jacentes que les moyens de légitimation mis de l'avant par les divers protagonistes et acteurs de cette société. [24] À la croisée de cette confrontation et comme incarnation spécifique de cet affrontement se situe la médiation des juristes et des journalistes comme groupes ou catégories sociales, comme parties des classes sociales qui s'affrontent, comme répondants aux fonctions sociales induites de la lutte de classes et du développement des rapports sociaux de production. Nous examinerons dans la prochaine section les formes et modes sous lesquels cette réalité s'est exprimée dans l'histoire du Québec. [25] Chaque région de l'idéologie produit donc ses propres intellectuels. Dans la région juridico-politique ce processus a pris historiquement une forme scientifique et rationnelle qui a pu donner une cohérence, une systématique et une autonomisation par rapport aux intérêts des groupes sociaux présents dans une société. [26] En ce sens, tant les magistrats et juristes que les journalistes et propriétaires de médias participent à la lutte pour le pouvoir. N'étant pas que de simples clercs, ils colorent le droit et la rhétorique politique qui y sert de pendant. Si le droit au procès équitable et le droit du public à l'information seront l'expression proprement juridique du conflit de ces catégories sociales, l'opposition des deux paradigmes prendra aussi la forme du conflit des normes juridiques et des règles déontologiques, des zones normées et celles relevant de « l'indifférence juridique » , pour utiliser les termes de la sociologie juridique. [27] Il est d'ailleurs remarquable que ces groupes sociaux se soient forgés et érigés dans la lutte même pour la démocratie. Il s'agit là d'un autre trait qui les rapproche significativement. Hors des grands centres urbains particulièrement, il ne fut pas rare de voir le même groupe social exercer les deux fonctions concurremment, et ce, durant une assez longue période historique. L'expérience européenne montre donc que les journalistes et les juristes sont des personnages clefs de l'ordre politique libéral, qu'ils partagent alors un même paradigme et qu'ils tentent tous deux de se légitimer en faisant appel au public. Partenaires /compétiteurs dans la normalisation nouvelle de la société, leurs parcours historiques empruntent les mêmes institutions, traduisent et trahissent les mêmes ambitions, utilisent les mêmes instruments. [28] C'est avec les développements récents que les intérêts vont petit à petit diverger et les chemins empruntés se détacher. [29] Finalement, une autre médiation interviendra dans la traduction ou la représentation du réel par le droit, et ce sera celle du langage juridique même (et journalistique à un autre égard), qui manifestera ou cachera la réalité à travers la désignation métaphorique qu'il en fera. La rhétorique des uns et des autres sera donc l'expression d'une vision spécifique du monde et de la société, comme elle résulte d'une stratégie différenciée de normalisation de la société. D'où le fait que le droit utilise des formes ésotériques et techniques de syllogismes qui révèlent qu'il est d'abord un discours de conviction et non un discours de vérité, malgré ses prétentions à l'effet contraire. Il s'inscrit encore dans une épaisseur institutionnelle qui, avec ses rites et ses symboles, agit également puissamment pour assurer la normalisation de la société. [30] Comme discours de conviction toutefois, le droit se heurte, comme toute forme de discours, aux réalités matérielles et aux intérêts spécifiques des acteurs sociaux. Qui plus est, il faut aller au-delà de la surface des discours juridiques pour en comprendre véritablement le sens latent, dans la mesure où le droit exprime les rapports sociaux tout en les dissimulant. Il est donc un véritable champ où se manifestent les intérêts contradictoires des acteurs sociaux. Cette réalité est mal saisie par les théories habermassienne et foucaldienne qui négligent fondamentalement de prendre en compte l'histoire et les groupes sociaux pris dans leurs interactions dynamiques et contradictoires. [31] Ainsi, le rapport du droit et de la morale, par exemple, est d'abord un rapport dialectique et contradictoire. Le droit vise à créer une morale nouvelle qui s'oppose à une morale ancienne, à développer un nouveau « conformisme » . Dans ce sens, le droit a nécessairement un contenu éthique et il doit être saisi dans cette dimension. Foucault avait donc raison quand il énonçait : « Qu'est-ce que notre morale, sinon ce qui n'a pas cessé d'être reconduit et reconfirmé par les sentences des tribunaux » [3]. Nous élargirions cependant son expression et dirions « ce qui a été dit et redit par le droit » . [32] Examiné du point de vue de ses rapports à la morale, c'est donc son opposition à la morale qui prend pour nous, dans sa dimension historique, la forme du conflit du droit et de la religion, et qui permet de le comprendre. À cet égard, autant le droit a dû s'exprimer dans des termes et par un appareillage, en partie religieux -car il a historiquement succédé à la religion comme mode dominant de normalisation- autant la religion et la théologie modernes ont été marquées par le développement de la société moderne dont le droit est l'idéologie principale, non seulement comme discours et langage, mais aussi comme éthique. Ainsi, Dieu a parfois été présenté comme le grand propriétaire du monde, après avoir inspiré le droit divin... Bossuet lui-même, au XVIIe siècle, a dû construire ses sermons en faisant appel aux catégories juridiques[4]. Mais comme Marx l'a remarqué à propos du passage des humains du féodalisme à ceux du capitalisme « [...] de croyant, il devient créancier ; de la religion, il tombe dans la jurisprudence » [5]. [33] Cette figure bicéphale de la religion et du droit, nous la verrons d'abord s'exprimer et s'incarner historiquement dans les personnages du prêtre et du bourreau. Mais ce n'était alors qu'une ébauche, presque une caricature. [34] Chose certaine, même dans les sociétés très anciennes, dites primitives, la corrélation entre le faible développement des échanges et celui des normes formelles est clairement quoique implicitement présente, alors que le rapport entre le droit et l'éthique sociale ou collective est manifeste et exprimé au grand jour. Dans les sociétés esclavagistes, on a aussi pu constater les rapports étroits entre le développement d'un surproduit et les institutions qui sont au coeur de la légitimité démocratique actuelle, comme celle du jury. Les sociétés féodales n'ont-elles pas vu le droit s'ériger comme nouvelle armature idéologique de la société alors que le développement économique l'exigeait ? Le droit est donc la traduction dans l'univers symbolique de ce rapport qui fonde maintenant la société. En ce sens, le droit constitue le reflet des conditions fondamentales d'une époque même si son expression est parfois tronquée ou détournée. [35] Cette surdétermination qui oblige une idéologie nouvelle à s'inscrire en creux dans une idéologie dominante mais en déclin, ne la voyons-nous pas encore en gestation dans la rhétorique du droit à l'information, comme expression du mode de normalisation nouveau qui émerge présentement, tout en devant encore se qualifier à partir des normes juridiques elles-mêmes ? En ce sens, les leçons issues du passé continuent d'être d'actualité dans la société moderne. [36] C'est pourquoi comprendre l'état du droit, l'évolution des normes juridiques qui expriment les rapports de la liberté d'expression et de l'administration de la justice, exige que nous confrontions non seulement leurs expressions symboliques, mais aussi les groupes sociaux dont ils sont l'incarnation. [37] Le premier niveau de l'analyse est donc celui de l'histoire elle-même où ces protagonistes émergent dans leur singularité propre. Ils s'allient d'abord pour créer les conditions du développement d'un nouveau mode de production, et en particulier l'armature idéologique qui, sur le plan culturel et idéologique, lui sert d'assises, puis commencent leur séparation graduelle. Au XXe siècle, les conditions économiques, les changements technologiques, la différenciation qu'ils entraînent au sein des deux groupes, vont graduellement amener une opposition d'abord larvée, puis de plus en plus ouverte entre les protagonistes. Mais le conflit n'est pas simple et la dialectique de la confrontation/collaboration demeurera toujours une composante essentielle des rapports des deux groupes. [38] La constellation du droit conserve le pôle dominant dans cette contradiction, durant une longue période, et cantonne le monde de l'information dans un rôle secondaire. L'existence de pogroms judiciaires, tant à l'Ouest que dans les pays du « socialisme réel » , illustre parfaitement l'état du rapport de force entre les protagonistes. Par ailleurs, ces dérives mêmes du droit montrent sa force et son importance. [39] Toutefois, l'unité des deux protagonistes constitue la pire des situations pour les populations concernées. En effet, dans ces procès « extraordinaires » ou politiques qui se sont déroulés dans les pays d'Europe de l'Est, tant la magistrature que la presse ont fait preuve de la même veulerie politique, ont adopté les mêmes arguments absurdes et se sont illustrés par leur même lâcheté. En ce sens, si la constellation médiatique et celle du droit sont les deux colonnes du temple démocratique, leur rapprochement comme leur éloignement caractérisé et indu met en cause la solidité de l'édifice et empêche les uns comme les autres de pouvoir se légitimer, comme nous l'exprimions précédemment [40] À l'évidence, depuis quelques années, le segment privé de l'État a pris son envol au détriment du segment public. Ce phénomène, pour être judicieusement compris, doit être correctement qualifié et situé. Dans les années 1970, en France particulièrement, on a parlé de la crise du droit, vue comme remise en cause globale d'un mode de légitimation basé sur les normes juridiques formelles [6]. Certes, cette crise du droit prend des dimensions et des formes particulières selon les États en cause. Des théories juridiques, comme le pluralisme, ont voulu essayer de résoudre cette crise, et les tenants de cette approche ont tenté de montrer que les juges peuvent aussi, dans leurs jugements, se faire les porte-parole et les reflets des nouveaux groupes sociaux en émergence. [41] Il faut remarquer toutefois que ce n'est pas l'inclusion des intérêts des groupes minoritaires dans les normes juridiques qui est l'objet ou l'occasion de cette crise, ni qu'elle permet de comprendre comment le marché des lois commence à être remplacé par les lois du marché. [42] Paraphrasant Jacques Godbout, nous dirions que pour que le segment privé ait la main haute sur la société, avec tous les éléments qui constituent cette constellation pour diacres, il faut qu'il neutralise d'abord les représentants du secteur public de l'État[7]. C'est alors que nous passerions de l'autorité de la chose jugée, à l'autorité de la chose médiatisée... [43] Par ailleurs, notre perspective est relativement restreinte puisqu'elle n'étudie que l'opposition du monde des médias et des journalistes à celui des juristes. Pour pouvoir construire une théorie de la société contemporaine, il faudrait prendre en compte l'action et les revendications d'autres groupes sociaux importants (les médecins, les technocrates, les économistes, les comptables, etc.) ou celle de sous-groupes à l'intérieur de ces « familles » plus larges. [44] Certes, d'autres auteurs ont identifié différemment les protagonistes de cet affrontement. Françoise Deroy-Pineau, par exemple[8], tente de montrer que ces luttes opposent l'État, les puissances économiques, les journalistes et le public, vus comme les quatre éléments centraux dans cette dialectique. [45] Adoptant une autre approche, pour comprendre l'articulation particulière du champ social de l'information au Québec, nous avons choisi de poser ces affrontements dans le cadre même de l'État, pris dans son acception la plus large. Ce faisant, notre démarche prend son sens et sa dimension dans la lutte entre segments et « branches » de l'État. [46] Il est d'ailleurs assez étonnant de constater que des auteurs, qui font de la sociologie la science pivot pour comprendre la grande énigme du monde, acceptent, comme prémisses de base, les définitions juridiques et les raccourcis que prend parfois le droit pour reconstruire la réalité, alors que, comme juriste, nous rejetons cette approche, par trop positiviste. [47] Pour bien situer ce débat, nous devons tenir compte que les contradictions, qui opposent le monde de l'information et celui du droit, s'exercent à divers niveaux, qui sont autant d'occasions, de lieux et de moments où ces deux segments de l'État, le public et le privé, celui soumis à la réglementation étatique directe et celui qui jouit d'une plus vaste marge de manoeuvre, s'affrontent. Les normes juridiques qui en découlent en portent d'ailleurs des traces évidentes par leur hétérogénéité même. Au Canada, la réglementation du CRTC sur la radiophonie et la télévision est une illustration saisissante de ce phénomène. [48] Il faut encore situer adéquatement la nature de la contradiction qui oppose le monde de l'information à celui du droit. Y a-t-il, de la part des médias, une guerre ouverte, une « chasse aux juges » , une volonté de discréditer pour mieux s'affirmer ? Ne s'agit-il pas plutôt de l'affrontement de deux univers culturels différents, reposant sur deux paradigmes en partie seulement contradictoires ? [49] En effet, comme Daniel Becourt le montre, le droit et l'information conservent, sur le plan épistémologique, de nombreuses ressemblances dans leurs finalités et leurs procédures[9]. [50] Il ne faut pas perdre de vue non plus que cette contradiction étant dialectique, cela implique que les rapports des deux paradigmes ne sont pas mécaniques ni unilatéraux, qu'il y a plusieurs aspects dans cette contradiction. S'ils sont en rivalité, ces groupes sociaux ont également besoin l'un de l'autre. Par ailleurs, une partie de la culture commune de ces groupes est répandue par les médias eux-mêmes qui la colorent forcément de leur empreinte. De même, ces groupes peuvent aussi se rencontrer et se combiner dans « l'injustice » par rapport à d'autres groupes. Cela n'empêche pas la presse de vouloir être le véritable tribunal populaire, et les médias de vouloir se substituer parfois au pouvoir judiciaire[10]. [51] Il faut aussi situer le phénomène avec précision, si l'on veut éviter d'amplifier incorrectement l'influence que peuvent avoir les médias sur le déroulement d'un procès. En effet, si le développement des technologies de l'information entraîne une transformation des pratiques psychosociales [11], cela veut surtout dire que le média est, en ce sens, le message lui-même. [52] C'est d'ailleurs plus à ce niveau, que par son contenu même, que le média peut influencer le procès. Bien souvent, il n'y a plus personne dans les salles d'audience sinon le journaliste qui rapporte. Pour le procès public, l'effet est celui de l'amplification quantitative, non de la perception qualitative, à une différence près : cette action est amplifiée souvent antérieurement au procès. Mais de la même manière que dans le passé sur le parvis de l'église, au magasin général ou au salon de quilles, on discutait ferme avant le procès et la sélection des jurés, aujourd'hui c'est la couverture des médias qui assure cette normalisation. Mais comme il manque de « relais » , au sens des théories de Jean Cazeneuve, comme cela s'inscrit dans une trame urbaine dépersonnalisée, anonyme, l'effet n'est sans doute pas plus important. Il faut d'ailleurs se souvenir qu'à l'origine du jury, on souhaitait pouvoir trouver 12 personnes qui étaient au courant des faits, avec tout ce que cela implique de perception subjective. Et le jury, comme institution où se lit l'évidence de la démocratie, n'implique-t-il pas l'existence d'une information de base, pour que l'exercice démocratique ait un sens[12]. [53] Si le média peut influencer le jury, comme on le laisse souvent entendre dans le monde des juristes, il faut bien voir que ce sont souvent des juristes eux-mêmes qui tentent d'utiliser les médias dans leurs stratégies à l'occasion d'un procès. L'avocat a autant besoin des journalistes pour assurer sa publicité que les journalistes ont besoin de lui pour trouver la nouvelle. Mais, comme un criminaliste célèbre le rappelle avec pertinence, les jurés peuvent généralement déjouer les journalistes[13]. [54] Un autre célèbre avocat d'assises français, Me René Floriot, dans un livre percutant consacré aux erreurs judiciaires, a montré qu'une large couverture médiatique constitue « une précieuse garantie pour l'accusé » , et non un obstacle à l'éclatement de la vérité judiciaire[14]. [55] Il faut encore rappeler que la culture commune à une société, le partage de valeurs dominantes par de très larges strates de la population, sont des éléments beaucoup plus importants pour entraîner la prise d'une décision que les seules informations transmises par les médias sur une affaire donnée[15]. [56] En fait, si un danger existe qu'un procès puisse être biaisé à cause de l'influence des médias, c'est surtout que les médias, par leur partage de valeurs communes avec celles des juges et juristes, peuvent amplifier le conservatisme social et l'injustice même de règles et de normes devenues obsolètes[16]. [57] Dans ce sens, nous sommes alors renvoyés, non pas à l'opposition de deux mondes, mais à la confrontation de deux modes ou de deux logiques de normalisation visant le même objet, mais par deux voies différenciées. À la culture médiatique, forte de transparence, d'ouverture, de communication, mais aussi de simplification, de rapidité et de fugacité, répond celle du droit basée sur la fermeture, le secret, le respect des textes et la réflexion. [58] Certes, la culture des médias modernes est aussi imprégnée d'une volonté d'abord de frapper, émouvoir ou indigner plutôt que d'expliquer, raisonner ou faire véritablement comprendre les faits en cause. Dans ce sens, des dérapages sont toujours possibles, comme conséquence du « matraquage cathodique » . [59] En effet, plusieurs auteurs qui font l'analyse critique du fait médiatique, comme instance et instrument de normalisation de nos sociétés modernes, mettent l'accent sur les tares de cet organe ou instrument de régulation sociale et insistent sur les « nouvelles maladies » qui en résultent :
[60] En même temps, la légitimité de tout pouvoir ne peut reposer que sur la connaissance des faits pris en compte dans la décision en cause. Là se situe le rôle central des médias dont le droit pourrait difficilement se passer[18]. [61] En définitive, c'est donc sur le terrain de la légitimité que se situe la dialectique de la presse et de la magistrature dans nos sociétés modernes. À cet égard, les tenants de la nébuleuse de l'information vont insister sur le fait que la diffusion, et surtout celle des médias électroniques, réalise « à une grande échelle, les conditions en partie semblables à celles qui caractérisaient le forum antique » [19]. [62] Necker ne disait-il pas de la presse, dès le XVIIIe siècle, qu'elle était « une puissance invisible, qui, sans trésor, sans garde et sans armée, donne des lois à la ville, à la cour et jusque dans le palais des rois » [20]. [63] Toutefois, les analystes de cette même nébuleuse ont été forcés d'admettre que son effet social était, au niveau du contenu ou du message même des médias, assez faible. Le fait de répéter ou d'amplifier la nouvelle ne conduit pas nécessairement à en admettre la véracité. [64] Ils rappellent encore que cette influence est profondément conditionnée par ce que les récepteurs en attendent ou en pensent déjà, et que d'autres relais jouent un rôle bien plus fondamental dans le façonnement de l'opinion. [65] Ils admettent enfin qu'un trop-plein d'information peut avoir un effet boomerang : les « [...] oreilles submergées de stimuli auditifs n'écoutent plus personne, et des yeux noyés de stimuli visuels ne regardent plus rien » [21]. Au « triomphe » technologique des médias répond donc leur « défaite » psychologique. Le procès de O.J. Simpson est d'ailleurs venu rappeler tristement cette réalité. [66] L'influence la plus considérable des médias est donc celle de contre-information sur le pouvoir judiciaire lui-même, plutôt que sur le résultat des procès. Cette désacralisation de la justice explique sans doute pourquoi, à défaut de contrer ouvertement le jeu des médias, celle-ci tente de l'instrumentaliser[22]. Les normes juridiques vont d'ailleurs traduire concrètement ce processus. [67] À l'opposé, les médias et leur nébuleuse proposent une vision tout aussi idéologique de la réalité, où ils tentent de s'insérer dans le jeu social pour le réguler en fonction de leurs intérêts marchands et de leur lutte pour le pouvoir au sein de l'État, pris dans son acception la plus large. [68] Comme Dominique Wolton le remarque :
[69] En ce sens, on peut opiner avec C. Wright Mills que les médias ont moins servi à enrichir l'espace démocratique qu'à transformer le citoyen en consommateur, par l'accentuation d'une sorte « d'analphabétisme psychologique » [24]. Pour les médias, seul l'espace public large a un sens, car c'est par lui que le marché se crée. D'autres auteurs encore montrent que si les médias ressuscitent le vieux rêve de la démocratie directe, sans intermédiaires procéduraux, ils nous placent fondamentalement « sous la juridiction des émotions » plutôt que celle du droit, ce qui constitue un recul et ouvre la porte de nouveau à une justice de lynchage, cette fois médiatique[25]. L'âge médiatique de la démocratie s'associe alors à celui du plus fort, du plus conforme aux préjugés dominants... [70] C'est donc par l'amplification de la rumeur que les médias s'insèrent dans l'espace social contemporain. Ils racontent les tensions sociales plutôt qu'ils ne les créent et ils leur offrent une voie de circulation, une mise en scène. Leur action est sans doute plus directe sur l'imaginaire collectif que sur la réalité sociale elle-même. En tout cas, comme Edgar Morin le remarque, l'information stimule l'imaginaire collectif tout autant qu'elle est stimulée par ce même imaginaire[26]. Avec la montée en force de l'image et de la télévision, la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus mince. Pour reprendre la belle image de Jacques Godbout, plusieurs ont sans doute l'impression que le monde disparaît quand l'écran s'éteint [27]. [71] Mais si l'on peut parfois regretter que le tumulte médiatique sur l'accessoire soit si étourdissant alors que le silence est si pesant sur l'essentiel, il faut se rendre à l'évidence : les médias ont un effet structurant sur les modes de légitimation des pouvoirs dans nos sociétés modernes. Et s'ils sont de nouveaux venus sur ce « marché » , les juges ont également à légitimer l'exercice des nouveaux pouvoirs qu'ils se sont vus attribués. Quis custodes custodier ?[28] [72] Comme le soulignait Christiane Restier-Melleray, à l'extrême, ces deux approches conduisent à des dérives certaines :
[73] Si les généralisations dont nous venons d'esquisser les figures nous ont servi à comprendre les rapports du droit et de l'information pris dans une perspective historique large, ce sont encore ces mêmes généralisations qui s'actualisent dans la réalité historique québécoise et canadienne. [74] D'abord, notre choix du paradigme juridique et de celui de l'information nous semble aller au coeur des luttes les plus importantes de notre société. L'affrontement de la constellation du droit et celle de l'information dans le cadre de l'État canadien sera donc riche d'enseignements. [75] Ainsi, dans l'histoire ancienne de notre pays, l'unité entre le monde du droit et celui de l'information nous semble le trait dominant, la caractéristique première de leurs rapports. Cette unité se réalise dans la lutte pour le gouvernement responsable et l'instauration du régime démocratique. Toutefois, cela n'empêche pas les sommets du monde du droit de s'associer aux vieux pouvoirs et de tenter de bloquer le développement des idées nouvelles. Au début du XIXe siècle, le monde du droit vivra une crise particulièrement aiguë, ce qui entraînera sa fraction radicale dans la tourmente révolutionnaire en 1837. Comme nous l'avons vu, malgré les péripéties et les reculs, ces luttes conduisent au gouvernement responsable. Or, le Barreau québécois naît en 1849, exactement au même moment que le gouvernement responsable. [76] Avec le développement du capitalisme libéral, le nombre des avocats augmentera encore et la différenciation interne s'accentuera aussi. C'est sans doute à ce moment que le monde du droit et celui de l'information vont commencer à s'éloigner et à s'affronter. La politique, le journalisme, le droit et la religion sont alors très intimement chevillés, ce qui ne va pas sans certaines contradictions. Le prône, l'assemblée et la presse jouent alors un rôle non négligeable dans la normalisation de la société. Les journaux sont alors ceux d'un parti, quand ils ne sont pas le fait d'un homme. Ils sont aussi fortement liés à l'État, par leur mode de financement et par les rapports complexes qu'ils entretiennent avec les groupes sociaux. Les groupes sociaux qui occupent maintenant le devant de la scène, ont besoin d'une presse qui corresponde aux fonctions nouvelles qui sont créées. Le journalisme constitue alors une école de la politique. Toutefois, le recours au droit, pour tenir la presse en laisse, fait partie d'une stratégie de règlement interne des conflits au sein de l'élite politico-financière. Une magistrature politisée, sinon partisane, éprouvera toutefois de nombreuses difficultés à mener à bien cette tâche. [77] Après la naissance du pays et avec le développement de l'économie moderne, au début du XXe siècle, une différenciation poussée s'opérera tant dans le monde du droit que dans celui de l'information. Toutefois, le monde du droit s'imposera comme ordre normatif dominant. Si l'avocature constitue alors la voie royale menant à la politique, la politique est aussi le chemin le plus court pour accéder à la magistrature, sinon la seule voie possible. La presse devra se contenter d'un rôle secondaire. Les conditions matérielles difficiles de la majorité des journalistes et le statut incertain dont ils disposent dans la société illustrent cette réalité. [78] Dans cette république des notables où les sommets de la profession juridique s'allient de plus en plus avec le grand capital (les corporate lawers), mais où, dans la grisaille des villes de province, l'avocature devient l'un des piliers essentiels du régime, la presse entretient une relation respectueuse avec la magistrature et ne remet nullement en cause son hégémonie normative. De toute façon, les sommets de la profession partagent plus largement avec le monde des juristes une culture, des intérêts et des valeurs communes. Le journaliste est alors un personnage falot, souvent corrompu, et occupant une place limitée au sein de l'État. Les journalistes, comme groupe social, n'ont donc pas, à cette époque, une homogénéité leur permettant de mener à bien les offensives devant assurer une défense cohérente et conséquente de leurs intérêts. Toutefois, les transformations, qui touchent la presse et donnent au fait divers, y inclus le fait divers judiciaire, une place si importante avec la naissance du sensationnalisme et de la presse commerciale, portent en germe les modifications des rapports de force entre les groupes au sein de l'État. [79] D'un point de vue historique, il est clair que l'organisation économique de la presse et des médias a pesé d'un grand poids dans la place et le rôle qu'ils ont pu jouer dans notre société. L'absence de grands groupes industriels puissants, durant une longue période, explique en partie les difficultés des médias à s'imposer comme ordre normatif dans la société québécoise. L'absence de normalisation corporative ou professionnelle du groupe journalistique a sans doute aussi eu une grande influence. [80] Ce n'est qu'au début des années 1960 que se dessinera graduellement une nouvelle géographie, une nouvelle architecture des pouvoirs dans notre société. Il faudra donc repenser la place de chacun au moment où la concentration économique modifiera tant le monde du droit que celui de l'information. Des luttes très intenses ponctueront ces transformations, particulièrement dans le monde de l'information et, à terme, permettront aux journalistes d'occuper une place nouvelle beaucoup plus importante. C'est l'époque où politique et journalisme deviennent des mondes proches, séparés par une frontière de plus en plus poreuse. Toutefois, cette évolution se fera au prix d'un écart grandissant entre les intérêts des journalistes et ceux de la population. La conglomération, qui s'enclenche dans les années 1960 et qui entraîne la dépolitisation de la presse, accentue alors l'approche commerciale où le fait divers occupe une place plus importante encore. [81] Les années 1980-2000 seront marquées par les progrès significatifs enregistrés par le paradigme informatif. Ces transformations montrent d'abord que la normalisation par l'économie marchande, dont les médias sont maintenant une composante essentielle, s'accentue. La conglomération est maintenant pour l'essentiel achevée et elle entraîne dans son sillage une interpénétration de plus en plus poussée des divers types de médias. La différenciation au sein du groupe des journalistes atteint un nouveau sommet qu'exprime le nombre grandissant des pigistes et des effectifs à statut précaire. Plus globalement peut-être, le monde journalistique lui-même est atteint par les transformations induites par le paradigme numérique où les postulats anthropologiques traditionnels du monde de l'information sont remis en cause et en quelque sorte subsumés par le monde communicationnel. Comme ces évolutions sont encore à l'oeuvre présentement, il est difficile d'en mesurer toutes les conséquences et les implications pour l'avenir, surtout dans la définition des rapports du droit et de l'information. Elles impliquent toutefois que le paradigme informationnel devient un mode de régulation des sociétés modernes et que, en ce sens, il se place en situation de concurrence avec la normalisation juridique de la société. [82] Le monde du droit connaît aussi des transformations radicales. Le marché devenant le mode principal de régulation du groupe des avocats, le nombre de juristes explosera littéralement et la différenciation du groupe sera aussi la conséquence de l'oligopolisation qui touche l'organisation économique de la profession. La magistrature continue de son côté sa dépolitisation partisane, en même temps qu'elle gagne des pouvoirs normatifs considérables découlant du rôle nouveau qu'elle joue dans le contexte constitutionnel canadien. [83] L'hégémonie de l'ordre normatif issu du monde du droit sera cependant fortement ébranlée et la magistrature verra la critique sociale la rattraper grâce, entre autres, au travail des journalistes. D'où la méfiance et le combat d'une partie de la magistrature contre le monde des journalistes. [84] La rupture de certains intellectuels issus du monde du droit avec leur groupe d'origine et la théorisation des positions souhaitées par le monde des médias qu'ils ont réalisée (et qui fait du droit de l'information et de la communication un champ spécialisé du droit), marquant ainsi leur rupture avec le « vieux monde » du droit, pour se situer d'emblée dans le nouveau paradigme en émergence, illustre aussi la complexité des structures du paradigme juridique. [85] Cette réalité montre au moins que chaque segment d'une société créé ses intellectuels organiques, qui peuvent utiliser des rhétoriques et des approches associées au monde qu'ils combattent dans les faits. [86] Aux critiques des journalistes sur le comportement des juges et juristes, ceux-ci répondent par des petites phrases assassines. Telle le veut la logique de deux pouvoirs qui s'affrontent. Mais les juristes vont aussi développer une stratégie d'énonciation des normes, des stratagèmes, qui s'exprimeront par les normes juridiques elles-mêmes, par la rhétorique des juges et juristes, par l'action même du paradigme juridique. C'est ce que nous allons maintenant examiner, afin de tirer quelques leçons de notre examen des normes juridiques en cause. [87] Conflit de deux pouvoirs, mais aussi de deux morales, de deux visions du monde où l'expression des intérêts prend une expression éthique et symbolique. Cette expression prend aussi la forme de stratagèmes d'énonciation où se reflètent d'abord la culture et les valeurs des sociétés humaines et les luttes d'intérêts des protagonistes présents dans ces sociétés. [88] Comme nous croyons l'avoir montré dans notre examen de la norme juridique internationale, le droit comme expression symbolique et éthique peut tout de même être déchiffré et compris comme illustration des conflits qui structurent les sociétés humaines. Les normes juridiques actuelles sur les rapports de la presse et de la magistrature traduisent la capacité du droit de prendre en compte les intérêts des autres protagonistes et des autres ordres normatifs présents dans la société. [89] Certes, nos analyses des rapports du droit et de la société, de la liberté d'expression et de l'administration de la justice dans les sociétés occidentales sont à bien des égards insatisfaisantes. En fait, la mise en rapport de ces sociétés et des normes juridiques qui y prévalent implique un appareillage dont un juriste ne dispose pas. [90] Mais en ce qui concerne les normes juridiques elles-mêmes, et en particulier les normes onusiennes, nous pouvons constater que la période 1960-1980 est fort pauvre dans l'élaboration de normes spécifiques applicables aux rapports des médias et de la magistrature. Dans la période récente, nous voyons les médias marquer significativement des points, même si la dialectique de l'équité du procès constitue une valeur venant limiter de façon importante la liberté de la presse. On constate aussi que la rhétorique de l'influence indue de la publicité sur l'équité du procès ne sera pas admise d'emblée, en l'absence de preuve que l'équité du procès a été réellement compromise, malgré les mesures alternatives utilisées. [91] Les décisions de la Cour européenne se situent dans un registre semblable, même si les médias marqueront des points encore plus importants, surtout dans la dernière période. En effet, le lien entre l'équité du procès et la légitimité démocratique de la magistrature, grâce à l'action des médias, ressortira avec encore plus de vigueur devant cette instance juridictionnelle. On peut même dire que l'arrêt rendu dans l'affaire Sunday Times en 1979 marque la reconnaissance que la normalisation de la société ne saurait être l'oeuvre des seuls tribunaux et du droit dans le monde moderne. La douzaine d'affaires ayant examiné les rapports de la presse et de la magistrature dans la dernière période montrent que le droit de critiquer la magistrature doit pouvoir constituer une facette importante du travail des médias, que toute mesure, qui limite les droits de la presse d'accéder aux activités des tribunaux et d'en rendre compte, doit être équilibrée avec les fonctions essentielles de la presse dans une société démocratique et justifiée par les circonstances particulières de l'espèce. Cette nécessité sera difficilement démontrable si les informations sont accessibles par ailleurs. En fait, si les recours en diffamation sont encore possibles contre la presse, dans la mesure où les standards journalistiques sont strictement appliqués, les condamnations deviennent hautement improbables. L'acceptation des standards journalistiques comme composantes de l'ordre normatif pris en compte par le droit nous semble une avancée considérable pour les médias et les journalistes. [92] En ce qui concerne la protection des sources journalistiques, le droit européen est actuellement le seul ordre juridique ayant reconnu un privilège spécial à la presse, même si cette protection devra être précisée dans les différents contextes où elle peut être mise en cause. [93] Finalement, il faut remarquer le caractère hautement contradictoire des rhétoriques qui veulent assurer préventivement l'équité du procès, en limitant tout aussi préventivement les droits des médias, et celles appliquées quand il faut juger si une publicité intempestive a, dans les faits, porté atteinte à l'équité du procès. En fait, nous touchons sans doute ici aux limites du droit comme mode de régulation des conflits sociaux. [94] Le droit américain nous montre une articulation différenciée des rapports de la presse et de la magistrature. S'inscrivant dans une trame historique et politique très chargée, où les médias constituent un authentique pouvoir, plongeant leurs racines très profondément dans l'histoire et la réalité des luttes politiques de ce pays, adossés à des organisations très puissantes, bénéficiant peut-être de considérations tactiques de la part des juges du plus haut tribunal du pays, les médias jouissent d'une marge de manoeuvre, à l'égard de la magistrature, sans équivalent dans le monde. En contrepartie, les États-Unis sont aussi le seul pays où fut admis que, dans certains cas, la presse avait dépassé la mesure et où l'équité du procès n'avait pu être assurée. [95] Quant à la France, où la tradition du jacobinisme étatique demeure si vivante, il semble évident que si la magistrature peut encore imposer ses diktats à la presse, ces règles sont fortement remises en question par l'ordre juridique qui s'érige à l'échelle européenne. Il était temps que le brocard « le commentaire des décisions est libre » devienne une réalité, et non plus une simple, mais belle, fleur de rhétorique. Il était surtout temps que la norme et le fait se rencontrent davantage dans ce pays où la tradition libérale a constamment côtoyé les mesures de censure et la répression la plus sévère à l'encontre de la presse et des médias. [96] La situation canadienne illustrera aussi dans sa singularité propre que les rapports de la magistrature et de la presse donne encore la part belle à la magistrature. Mais, à cette étape de notre analyse, il faut surtout insister sur les stratégies d'énonciation de la norme juridique et sur son contenu comme expression de ce rapport de force. [97] À cet égard, il faut d'abord référer aux changements qu'ont apporté les réformes constitutionnelles de 1982. Modification de la place et du rôle des juges, d'une part, et transformation du statut de la liberté d'expression, d'autre part. [98] Commençons par ce dernier point. La constitutionnalisation de la liberté d'expression n'a pas entraîné les changements structuraux que d'aucuns souhaitaient. Si la liberté d'expression ne jouissait que d'un statut ambigu et de protections fort relatives avant l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, l'adoption de cet instrument constitutionnel n'a pas permis de faire faire le saut qualitatif qui aurait permis à cette liberté de véritablement structurer le droit. En fait, il fallut attendre près de 15 ans pour que cette liberté soit simplement considérée comme l'égal du droit au procès équitable dans les débats judiciaires canadiens. [99] Mais de façon plus fondamentale encore, ce sont les modifications au statut du juge dans l'ordre constitutionnel canadien qui attirent notre attention. Ces modifications surviennent au moment même où les médias se repositionnent dans la société canadienne. Ces repositionnements impliquent aussi une redéfinition des rapports du paradigme de l'information avec celui du droit, et plus spécifiquement un réalignement de ses rapports avec la magistrature. Les efforts, démarches, requêtes, interventions ou contestations des médias devant les tribunaux seront innombrables durant les vingt dernières années. Il y a ici un changement qualificatif qui s'explique par la conjugaison de divers facteurs, comme nous l'avons vu, mais qui traduit surtout une volonté de s'affirmer comme ordre normatif dans la société. [100] Cela oblige les juges à réagir et à élaborer des discours et à proposer des rationalisations qui prennent en compte les intérêts du paradigme médiatique, tout en évitant de lui accorder une place prépondérante au sein de la structure étatique canadienne. [101] Cette tâche ne rencontre pas toujours un réel succès. Les contradictions entre les justifications en faveur des limitations aux droits de la presse pour assurer l'équité du procès et celles pour accepter un changement de venue illustrent particulièrement les difficultés du monde du droit à élaborer des solutions réellement rationnelles et convaincantes. En droit administratif, l'abandon rapide des exigences d'abord posées pour rencontrer les standards de la Charte et le recours à des arguments de commodité pour limiter les droits de la presse marquent aussi les limites que rencontrent les médias pour s'imposer comme ordre normatif. Des valeurs comme le respect de la vie privée, dont l'importance grandissante peut aussi illustrer la frilosité et le conservatisme ambiant, viennent constituer des obstacles de plus en plus menaçants pour la liberté d'expression et les droits de la presse. [102] De même, les réticences injustifiées des juges à accepter l'ouverture de leurs procédures disciplinaires, les affirmations récentes, grosses de conséquences à notre point de vue, sur le statut unique des juges dans la société dans l'affaire Re Therrien, l'adoption d'une supposée mens rea objective dans les cas d'outrage au tribunal commis par des journalistes constituent autant d'exemples d'une rhétorique plus autojustificatrice que réellement convaincante. [103] Et les juges ne sont pas seuls en cause dans la mesure où les plus durs combats en faveur de la fermeture ont été menés par le Barreau lui-même. [104] Il ne faut faudrait pourtant pas conclure que le paradigme de l'information n'a pas marqué quelques progrès, n'a connu aucun avancé dans sa quête de pouvoir et de légitimité. La reconnaissance partielle et graduelle d'un quasi-privilège en matière de protection des sources, après les durs combats des années 1970-1980, montre que les positions respectives des uns et des autres ne sont pas entièrement statiques. Toutefois, si certains compromis ont pu illustrer la plasticité et la capacité du droit de s'adapter aux rapports de force nouveaux qui émergent dans le sillage des modifications des technologies de l'information, le maintien de l'essentiel, c'est à dire de privilèges interprétatifs permettant de donner aux juges le dernier mot, prétextant les faits particuliers de chaque espèce, illustre aussi que le monde du droit, à partir des positions traditionnelles qu'il occupe dans les dispositifs étatiques est encore en mesure de refuser aux nouveaux venus les « places » ou les « fonctions » auxquelles ils aspirent. [105] En contrepartie, il faut admettre que la constellation médiatique ne semble pas en mesure ni désireuse de mener de façon conséquente son combat, préférant, du moins à court terme, quelques déclarations ombrageuses et coups de gueules tonitruants à une attaque en règle des positions de l'adversaire. Cette guerre de tranchée, larvée et rampante, risque fort de durer pour une longue période encore. [106] En fait, il semble bien que les protagonistes préfèrent l'inconfort d'une situation ambiguë à la clarté d'une règle qui risquerait de priver l'un ou l'autre de ses avantages stratégiques. [107] Cela montre sans doute surtout que le droit et l'information sont les deux faces du Janus des sociétés modernes et quels que soient les velléités des protagonistes en cause, ils devront impérativement collaborer... [1] Un homme de bien qui sait parler... [2] KARPIK, Lucien, Les avocats, Paris, Gallimard, 1995. [3]FOUCAULT, Michel, « Sur la justice populaire. Débat avec les maos » , dans Dits et Écrits, t. 2, coll. Bibliothèque des sciences humaines, Paris, Gallimard, 340-369, p. 368. [4]EDELMAN, Bernard, « Naissance de la légalité bourgeoise - Deux policiers au XVIIe siècle » , (1977) 26 Communications 132. [5] MARX, Karl, « Critique de l'économie politique » , dans oeuvres I, Paris, coll. La Pléiade, Gallimard, 267-452, p. 400. [6]Voir à cet effet: SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, Justice sous influence, coll. Cahiers libres, Paris, François Maspero, 1981, 252 p.; CHARVET, Dominique, « Crise de la justice, crise de la loi, crise de l'État? » , dans POULANTZAS, Nicos (Dir), La crise de l'État, Paris, Presses Universitaires de France, 1976, 348 p., p. 261-292. [7]GODBOUT, Jacques, Le murmure marchand, coll. Papiers collés, Montréal, Boréal Express, 1984, 153 p., p. 41. [8]DEROY-PINEAU, Françoise, Les francs-tireurs de l'information, Montréal, Éditions Sciences et Culture Inc, 1981, 167 p., p. 60-95. [9] BECOURT, Daniel, « Droit et information » , Gazette du Palais, No. 270-272, 27-29 septembre 1998, p. 5-11. [10] TRUCHE, Pierre, « Le juge et la presse » , (1995) Esprit no. 210, mars-avril 1995, 5-12. [11]PORCHER, Louis, « Remarques interrogatives sur l'école et les médias » , dans BALLE, François (dir.), Le pouvoir des médias, mélanges offerts à Jean Cazeneuve, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, 183 p., p. 97-103. [12] LECLERC, Henri, « Faut-il en finir avec le jury populaire » , (1995) Esprit no. 210, mars-avril 1995, 34-48. [13]CORNEC, Jean, A quoi ca tient !, Paris, Robert Laffont, 1977, 289 p., p. 256-275; voir aussi ARNAUD, Georges et KAHANE, Roger, L'affaire Peiper, Paris, Atelier Marcel Jullian, 1978, 220 p., p. 53. [14]FLORIOT, René, Les erreurs judiciaires, Paris, Flammarion, 1968, 333 p., p. 246. [15]Voir sur cette question WATZLA WICK, Paul, La réalité de la réalité, confusion, désinformation, communication, Paris, Éditions du Seuil, 1978, 238 p., p. 91-105. [16]LANGLOIS, Denis, Les dossiers noirs de la justice française, coll. Combats, Paris, Éditions du Seuil, 1974, 222 p., p. 102. [17] GUILLEBAUD, Jean-Claude, « Les médias contre la démocratie » , (1993) Esprit no. 190, mars-avril 1993, 86-101, p. 99-100; LIPOVETSKY, Gilles, Métamorphoses de la culture libérale. Éthique, médias, entreprise, Montréal, Liber, 2002, p. 89-113. [18]Sur ces éléments de réflexion, consultez DE VIRIEU, François Henri, La médiacratie, Paris, Flammarion, 1990, 294 p., p. 181-191. [19]CAZENEUVE, Jean, Les pouvoirs de la télévision, coll. Idées NRF, Paris, Gallimard, 1970, 382 p., p. 109. [20]Cité dans BELLANGER, Claude, GODECHOT, Jacques, GUIRAL, Pierre et TERROU, Fernand (dir.), Histoire générale de la Presse Française, t. 1, Paris, Presses Universitaires de France, 1970, 633 p., p. 113. [21]HUISMAN, Denis, « La communication "pléthorique" » , dans BALLE, François (dir.), Le pouvoir des médias, mélanges offerts à Jean Cazeneuve, op. cit., note 11, p. 133-147, 145. [22]FERRO, Marc, L'information en uniforme, Paris, Ramsay, 1991, 125 p., p. 81. [23]WOLTON, Dominique, Éloge du grand public, une théorie critique de la télévision, Paris, Flammarion, 1990, 319 p., p. 257. [24]MILLS, C. Wright, L'élite du pouvoir, coll. Textes à l'appui, Paris, François Maspero, 1969, 380 p., p. 318. [25] GARAPON, Antoine, « Justice et médias : une alchimie douteuse » , (1995) Esprit, no. 210, mars-avril 1995, 13-33. [26]MORIN, Edgar, La rumeur d'Orléans, Paris, Éditions du Seuil, 1969, 256 p., p. 40. Sur la question de la rumeur, consultez aussi KAPFERER, Jean-Noël, Rumeurs, le plus vieux média du monde, Paris, Éditions du Seuil, 1987, 318 p. et la revue Le Genre humain no 5, Paris, Éditions complexe, 1982, 126 p. [27]GODBOUT, Jacques, Le murmure marchand, op. cit., note 7, p. 99. [28] Qui nous protégera contre ceux qui nous protègent... [29] RESTIER-MELLERAY, Christiane, « Opinion publique et démocratie. Les débats parlementaires et la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel » , (1991) Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger 1039-1078. 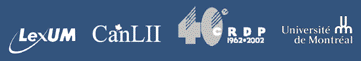 |