
Droit et Internet Michel A. Pinsonnault Introduction[1] Depuis l'introduction du Web en 1991, l'Internet a connu un essor considérable. En effet, non seulement les particuliers se sont mis à l'utiliser pour leurs fins personnelles, mais aussi les entreprises de tous les secteurs économiques ont commencé à y exercer leurs activités. Le droit n'a pas échappé à ce phénomène même s'il a tardé à y venir. [2] La première source primaire à avoir été rendue disponible sur le Web fut la jurisprudence vers 1993-19941.[1] Grâce à un partenariat entre la Cour suprême du Canada et le Centre de recherche en droit public (CRDP) de l'Université de Montréal, les jugements de cette Cour pouvaient être consultés sur le Web dans les minutes qui suivaient leur émission. (Poulin, p. 218). En 1995, ce fut au tour du ministère de la Justice du Canada de lancer son site Web. À cette occasion, il rendait accessible les textes fédéraux consolidés. (Poulin, p. 198) [3] En mai 1997, le Barreau du Québec lançait officiellement son site lors de son congrès annuel. À l'automne de la même année, il offrait à ses membres la possibilité de repérer en ligne les jugements québécois grâce à sa base de données connue sous le nom de Répertoire électronique de jurisprudence du Barreau du Québec (REJB). [4] À l'heure de l'examen de l'Internet au regard du droit, il nous faut nous demander, dans un premier temps, quelle est la pertinence des sources primaires du droit (lois, règlements et jurisprudence) et des sources secondaires qui s'y trouvent (la doctrine et les coutumes)? Quelle est la validité de cette information juridique? Et enfin, quelle est l'efficacité d'une recherche faite sur le Web (taux de bruit et de silence)? [5] Dans un deuxième temps, nous discuterons de la place du CAIJ dans cet univers internautique en examinant les objectifs qu'il s'est fixés, c'est-à-dire : (1) l'accessibilité et l'intégration de l'information par un portail unique conçu pour les praticiens, la magistrature et les étudiants du Barreau, (2) les services à valeur ajoutée et (3) la formation. Première partie - Examen du contenu juridique sur InternetPertinence des sources juridiques1. La législation
[6] Dans le respect de la démocratie, le gouvernement fédéral et la majorité des gouvernements provinciaux rendent maintenant accessibles gratuitement sur le Web, les lois et les règlements consolidés. Il en est de même pour les lois annuelles. Avant l'an 2000, les praticiens devaient visiter chacun des sites de ces gouvernements pour trouver les lois dont ils avaient besoin. Ils étaient confrontés à des pages Web qui avaient une présentation matérielle différente. Il en était de même des moteurs de recherche qui exigeaient un ré apprentissage de la démarche de recherche selon le site visité. [7] Depuis la création du portail CanLII en l'an 2000, il est possible d'avoir accès à ces sites par ce guichet unique qui les a intégrés dans une même page Web sous la juridiction à laquelle ils appartiennent. On y a aussi intégré un moteur de recherche qui permet de retrouver un mot ou une expression dans le titre ou dans le texte intégral d'une loi ou d'un règlement. Ce portail public et gratuit a donc facilité l'accès aux lois et aux règlements. [8] Cependant, sa mission n'a pas été de solutionner les problèmes de mise à jour des lois et des règlements. Ce portail demeure donc tributaire des sites des éditeurs officiels des différents parlements pour la mise à jour des textes législatifs. On constate donc une lenteur dans ce service qui devrait être une priorité des éditeurs pour l'obtention d'une information juridique complète. Il faudrait penser à augmenter les effectifs pour tenir à jour de façon quotidienne ces sources. Aujourd'hui encore, une recherche législative nécessite de consulter la documentation sur papier pour être complète et refléter la réalité juridique. [9] En effet, si on veut mettre à jour une loi québécoise, les Publications officielles du Québec - qui est la source de CanLII exemple, la LPC n'a pas subi de changements entre le 1er pour les lois et les règlements québécois - donnent une version à jour actuellement au 1er novembre 2001. Dans la version novembre 2001 et la date de la constitution du fichier. Par HTML de chaque loi, on ajoute dans l'entête de celle-ci, lors de la constitution du fichier, une date qui indique qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis la date de la mise en vigueur de la refonte au 1ernovembre 2001 et le 29 avril 2002 qui est la date la plus récente de constitution des fichiers. Cet état des choses est un irritant dans la pratique du droit qui pourrait bénéficier d'une procédure plus rapide de mise à jour grâce à l'Internet! [10] En ce qui a trait aux serveurs commerciaux juridiques, SOQUIJ n'a plus de banques de lois et de règlements. Il a abandonné ce service il y a quelques années. Quant à QUICKLAW, on ne retrouve que les lois fédérales en anglais. Toutefois, celles-ci sont mises à jour quotidiennement. 2. La jurisprudence
[11] Le site CanLII offre un accès gratuit à la jurisprudence des tribunaux fédéraux et des tribunaux provinciaux. Cependant, cet accès n'est pas exhaustif. Par exemple, pour les décisions de la Cour suprême du Canada, le site contient tous les jugements rendus depuis 1985. On y retrouve les décisions de la Cour d'appel du Québec rendues depuis le 1er janvier 2000. Pour savoir le contenu de chaque base, il faut consulter le paragraphe introductif qui indique la date du début de la collection. [12] SOQUIJ rend également accessible gratuitement sur son site une sélection de jugements québécois. On les obtient en tapant l'adresse URL suivante : www.jugements.qc.ca. Ce service est offert depuis l'an 2000 pour les décisions des tribunaux judiciaires québécois et de certains tribunaux administratifs. Dans un tableau, on indique la date de départ de chacune des collections visées. Il ne s'agit pas de tous les jugements rendus par les cours mais uniquement ceux qui sont motivés. Comme le site ne comporte pas de moteur de recherche, les praticiens doivent passer par CanLIi pour utiliser le moteur de recherche de ce site qui tire sa source en matière de jurisprudence du même site www.jugements.qc.ca. La recherche dans ces bases gratuites permet donc aux praticiens de faire une première vérification. Pour compléter leur recherche sur un point de droit, ils doivent cependant vérifier d'autres sources. [13] L'accessibilité des jugements par des sites gratuits comporte actuellement deux problèmes majeurs. Ils ne sont pas exhaustifs et la présentation matérielle ne facilite pas l'accès au contenu du jugement puisqu'elle est sensiblement comme celle des cours. Il n'y a pas de mots clés au début du jugement, ni de résumé pour guider les juristes dans leurs recherches. [14] Les sites commerciaux offrent ces dernières possibilités mais ils ne donnent pas accès à toute la jurisprudence. À titre d'exemple, la base AZIMUT de SOQUIJ contient les jugements des tribunaux judiciaires depuis 1975. Il ne s'agit pas de tous les jugements publiés à partir de cette date, mais seulement des jugements sélectionnés par SOQUIJ. Cet organisme retient 2500 jugements par an. Avec un outil comme Internet, la distinction entre les jugements rapportés et non rapportés ne devrait plus avoir cours. Idéalement, tous les jugements devraient être accessibles sur le Net et indexés au moyen de mots-clés pour un meilleur repérage. Un format de présentation uniforme, tel le pdf, devrait être choisi par tous les tribunaux lors de la rédaction des jugements pour les rendre directement accessibles sur le Web. [15] Pour l'instant, la réalité de la recherche jurisprudentielle impose d'utiliser les collections sur papier pour trouver des décisions moins récentes. Il faut aussi se rappeler que le recul dans le temps peut être assez long puisque le Code civil du Québec reprend en partie les règles du Code civil du Bas Canada. Plusieurs arrêts de principe demeurent donc encore applicables aujourd'hui. En vertu de la pratique de nos tribunaux de droit civil de suivre la jurisprudence constante sur un point de droit, on ne peut, dans certains dossiers, avoir une recherche complète sans recourir aux collections sur papier. [16] Sur ce dernier point, il est intéressant de constater qu'une recherche américaine, faite à partir des bases LexisNexis et WestLaw, a démontré que seulement 7% de toutes les sources juridiques américaines sur support papier avaient été transférées dans les bases de données de ces serveurs.[2] Il est fort à parier que la situation de la jurisprudence dans les sites canadiens et québécois est encore moins bonne puisque les banques américaines contiennent plus de documentation que les banques canadiennes. 3. La doctrine
[17] La doctrine n'est pas très présente sur Internet. On peut compter sur les doigts de la main les sites qui offrent l'accès gratuit à cette source secondaire du droit. Le site de la Bibliothèque virtuelle de la Fondation du Barreau du Québec permet notamment d'avoir accès à la documentation professionnelle et aux articles publiés dans la Revue du Barreau depuis 1999. On peut aussi retrouver des textes doctrinaux dans les sites personnels de certains professeurs d'université ou de cabinets juridiques. [18] SOQUIJ offre également de la doctrine gratuite dans sa partie du site dévolue au grand public. On y retrouve des capsules de vulgarisation qui touchent aux situations importantes de la vie courante classées par secteurs du droit : droit de la famille et des personnes, droit du logement, etc. SOQUIJ répertorie aussi des articles sur divers sujets de droit écrits par des professionnels sous la rubrique Bulletins juridiques du site. Ces articles sont classés selon les domaines du droit de A à Z. [19] L'éditeur SOQUIJ offre aussi des références bibliographiques à ses abonnés par sa base AZIMUT. Elles permettent de retracer plus rapidement la documentation en format papier. Malheureusement, on n'y retrouve pas d'articles ou de livres en ligne comme c'est le cas pour plusieurs banques de données scientifiques. [20] Tout est donc à faire en matière de doctrine sur le Web. Par ailleurs, il faut se rappeler qu'en droit privé québécois, la doctrine occupe une place importante dans l'explication et l'interprétation des principes juridiques. Elle a pour mission de faire la synthèse sur plusieurs sujets de droit en expliquant comment les tribunaux ont appliqué à une situation factuelle une règle de droit. Elle ramasse l'information en vrac : décisions judiciaires et législation pour l'exposer dans une structure logique. On sait que nos tribunaux y ont souvent recours pour rendre leurs décisions. Quant aux avocates et aux avocats, ils s'en servent régulièrement pour connaître rapidement l'état de la législation et la jurisprudence sur un point de droit précis ou l'interprétation de celles-ci. [21] L'apparition de répertoires doctrinaux sur le Web est attendue de même que la publication de livres. Tout comme les sources primaires, il serait important de conserver un accès gratuit à la doctrine, de prévoir des moteurs de recherche pour ces ouvrages avec un vocabulaire contrôlé (thésaurus) et de créer des portails d'accès efficace aux articles de revues. Par ailleurs, la création d'un site intégrant les divers accès électroniques aux articles de périodiques tel celui de la Bibliothèque Bora Laskin de l'Université de Toronto[3] serait un atout en droit québécois. Constatations
[22] Il est intéressant de constater que la mise en disponibilité sur le Web des sources du droit rend néanmoins l'utilisation du papier indispensable. En effet, le cerveau humain ne peut à l'heure actuelle lire un texte de plusieurs page à l'écran (prof Gervais UQAM, directeur d'un projet sur la lecture lente). L'internaute doit donc imprimer son texte pour pouvoir prendre le temps de le comprendre et de revenir en arrière quand bon lui semble. Ces opérations sont plus faciles dans ce format. L'Internet est un outil qui donne rapidement accès à l'information lorsqu'elle s'y trouve. Il permet la lecture rapide des informations mais pas l'étude de la documentation. [23] Autre constatation, la recherche de la meilleure documentation pour un dossier n'a rien à voir avec le support de l'information (papier ou électronique). C'est le contenu de cette information qui est important. Enfin, dernière constatation : la recherche juridique devra se réaliser sur les deux supports pour encore plusieurs années puisque nous sommes à une époque de transition. Validité de l'information[24] À l'heure actuelle, les sites québécois et canadiens qui reproduisent les lois et les règlements comportent généralement une mise en garde quant au contenu non officiel des textes. On y indique que les documents sont mis à la disposition pour être consultés à des fins personnelles seulement. On ne garantit pas l'exactitude du contenu. Au Québec, le site des Publications officielles ne mentionne pas que les lois et règlements en version électronique constituent des textes officiels. Par conséquent, seuls les textes québécois et fédéraux sur support papier ont une valeur officielle.[4] [25] À notre avis, une loi s'impose sur la question et on devrait déclarer certains sites comme détenteurs des versions officielles des lois et des règlements. Ainsi les praticiens ne seraient plus obligés de recourir à la version papier afin de la produire à la cour. En effet, nos tribunaux n'acceptent pas encore de façon formelle la version électronique des lois. [26] Par ailleurs, quant à la version électronique des jugements, une loi devrait indiquer une forme électronique officielle qui permettrait de résoudre les problèmes de pagination actuelle. En effet, certains juges préfèrent une version papier pour pouvoir référer à une pagination et ce, même si actuellement certains sites offrent des jugements contenant des paragraphes numérotés. Le législateur pourrait prévoir une version officielle des jugements. La version pdf pourrait être celle retenue et contenir le sceau de la cour afin de prouver le caractère officiel du texte. De plus, le législateur devrait prévoir un système qui empêcherait la modification des jugements. Dans le passé, une telle situation s'est produite, ce qui a amené les juges à demander aux parties de produire la version papier des jugements. Efficacité de la recherche[27] Dans ce maelström d'information juridique électronique, le professionnel du droit ne sait pas toujours où chercher et comment chercher. Il se demande souvent si telle banque électronique lui fournit toutes les informations nécessaires. Ce sentiment est justifié puisqu'il a le devoir d'avoir les connaissances nécessaires pour la pratique de sa profession. En Angleterre, la Cour d'appel en 2000 a même jugé que les avocats avaient une obligation de se tenir à jour.[5] [28] La recherche avec les moteurs de recherche populaires (Google, Alta Vista, etc.) n'est certainement pas précise pour le professionnel du droit. Il doit recourir à des sites spécialisés gratuits ou à des serveurs juridiques commerciaux. Plus les sites juridiques possèdent un moteur de recherche efficace et une indexation appropriée, plus la recherche est efficace. Dans le cas contraire, les résultats recherchés sont peu probants. Par ailleurs, le fait que les modes de recherche ne soient pas normalisés, affecte également l'efficacité de la recherche. [29] Nous envisageons avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir que les prochaines années seront cruciales pour l'évolution et surtout, la progression de la recherche juridique sur le WEB. Deuxième partie - Le rôle du CAIJ dans l'univers d'InternetAccessibilité et intégration de l'information[30] En décembre 2001, le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ) a été créé. Le CAIJ provient de la fusion des actifs des barreaux de Montréal, de Québec ainsi que du Réseau d'information juridique du Québec (RIJQ). Les 37 bibliothèques de Palais de justice font désormais partie d'un immense réseau qui a pour mission de « rendre accessible en priorité aux membres du Barreau du Québec et de la magistrature l'information juridique disponible » (plan d'affaire du CAIJ, p. ii). La responsabilité du CAIJ est donc cruciale : s'assurer que l'accès à l'information juridique soit identique pour tous et toutes, quel que soit l'emplacement géographique ou l'environnement de travail de l'avocate et de l'avocat. Pour bien remplir cette mission, le CAIJ compte devenir le courtier privilégié en information juridique (plan d'affaire, p. ii). [31] Pour atteindre son but, le CAIJ veut offrir aux membres du Barreau, un guichet unique pour l'information juridique. Avec la venue prochaine de son site Web, le CAIJ va offrir aux avocates et avocats, une porte d'entrée unique pour l'information juridique. Le site du CAIJ va en effet permettre, entre autres, l'intégration de tous les catalogues des 37 bibliothèques de Palais de justice. Il sera donc possible de connaître, en une seule étape, la disponibilité d'un ouvrage dans l'ensemble des bibliothèques du CAIJ. De plus, il sera également possible d'interroger plusieurs catalogues d'autres organismes, tels que l'Université McGill, Montréal, etc. [32] Le site Internet du CAIJ va également organiser et donner une structure aux différentes sources d'information juridique disponible. En effet, de plus en plus d'information juridique est disponible gratuitement sur Internet, mais le repérage de cette information n'est pas toujours simple, voilà pourquoi il est important de concevoir un répertoire de sites juridiques afin de répondre aux besoins spécifiques des avocats. Ces sites seront classés sous 30 grands domaines du droit. [33] La concentration du marché de l'édition juridique a mené à une hausse des coûts de l'accès à l'information juridique. De plus, la multiplication des produits électroniques disponibles complique de beaucoup la recherche pour plusieurs avocats qui se voient dans l'impossibilité de consulter ces nouvelles sources, par manque de ressources financières ou matérielles. Le CAIJ veut rendre disponible la même information juridique pour tous ces membres; pour ce faire, il va mettre à la disposition dans ses points de service de l'équipement informatique suffisamment performant pour supporter l'accès aux différents produits électroniques disponibles. De plus, le CAIJ a réussi à négocier avec les maisons d'édition des ententes concernant la consultation sans frais additionels, à partir de ses bibliothèques, de banques de données commerciales, telles Quicklaw et Azimut. Le CAIJ, en tant que réseau va augmenter la disponibilité de l'ensemble des collections papier et électronique à travers ses 37 bibliothèques. Finalement, le CAIJ peut assurer la mise à niveau de ses collections papier et ainsi supporter des champs de pratique en pleine expansion. Valeur ajoutée - Service de recherche[34] Le CAIJ, par l'entremise de son service de recherche, va bonifier l'information juridique. En effet, le service de recherche, composé de professionnels ayant une double compétence en droit et en recherche documentaire, va servir d'intermédiaire et agir à titre de consultant auprès des membres du Barreau du Québec. Le service de recherche a pour mandat de repérer l'ensemble de l'information juridique disponible sur un sujet. Les avocats pourront par la suite consulter cet ensemble d'information afin de rendre une opinion éclairée et à jour sur l'état du droit. Le service de recherche va servir d'intermédiaire aux avocats, dans le sens où il va fournir à ceux-ci les données nécessaires afin de permettre une analyse complète d'un dossier. Les membres du Barreau vont pouvoir consulter les professionnels du service de recherche via différents modes, lors de visites dans les bibliothèques, par téléphone, par télécopieur ou encore par courriel via le site du CAIJ. [35] La consultation du service de recherche permettra aux avocats de repérer le plus rapidement possible et au moindre coût l'information juridique disponible. En effet, les professionnels du service de recherche possèdent une connaissance technique du mode d'interrogation des différentes bases de données disponibles. De plus, ils ont une connaissance de l'information juridique disponible sur Internet. Finalement, ils connaissent les limites de l'information disponible sur un sujet de droit. À titre d'exemple, une décision de la Cour d'appel du Québec est présentement disponible via plusieurs sources, telles REJB, Azimut de Soquij, eCarswell, Quicklaw, le site Internet de Wilson Lafleur (abonnement) ou encore, gratuitement, sur Internet sur le site de CanLII. Toutes ces bases de données offrent une référence particulière; une même décision peut donc comporter jusqu'à six références différentes, toutes disponibles électroniquement. Le service de recherche est là pour guider le praticien et l'aider à repérer cette décision le plus rapidement possible et au moindre coût. [36] Les professionnels du service de recherche peuvent offrir un portrait de l'ensemble des possibilités de recherche disponible que ce soit sur papier, sur cédéroms, sur Internet ou encore sur une base de données commerciale. Ils peuvent établir un lien entre la recherche papier et électronique. Ils peuvent également démontrer les limites et avantages de ces deux médias d'information. Ils sont en mesure de repérer l'information recherchée rapidement et efficacement. Ces professionnels de l'information juridique sont constamment appelés à tenir à jour leurs connaissances afin d'être au fait des nouveautés disponibles en matière de recherche. [37] Le service de recherche offrira aux avocates et avocats la possibilité d'effectuer une recherche pour eux contre rémunération. Ce service offrira aux avocats qui n'ont pas le temps d'effectuer eux-même la recherche, l'assistance nécessaire pour repérer l'information disponible sur une question de droit. Formation[38] Le CAIJ souhaite apporter un support additionnel aux praticiens en répondant à leurs différents besoins de formation. L'arrivée constante de nouveaux produits électroniques et la multiplication des modes d'interrogation des banques de données posent de nombreux problèmes aux avocats lors de leurs recherches. De plus, la multiplication de l'information et particulièrement l'augmentation du coût des outils permettant de repérer celle-ci, augmentent encore les problèmes d'accès. [39] Le CAIJ offrira un programme de formation afin de répondre aux besoins de recherche des praticiens. Pour ce faire, il offrira la formation de base, la formation spécialisée pour des groupes et sur une base individuelle. Le programme de formation touchera les différents domaines de droit, les différents modes de recherche, telles la recherche dans les outils papier (ex. : Canadien Abridgment), les banques de données électroniques (ex. : REJB, Azimut, etc. ) ainsi que l'exploration des ressources juridiques disponibles gratuitement sur Internet. [40] Les besoins de formation sont importants particulièrement sur Internet, en raison principalement de la masse d'information disponible. En effet, une recherche sur Internet génère habituellement un nombre impressionnant de résultats. Le bruit lors de recherche effectuée sur Internet décourage bons nombres d'internautes; il est cependant possible de restreindre les résultats d'une recherche en utilisant des techniques de recherche efficaces ou en utilisant un moteur de recherche plus efficace. Une autre difficulté s'ajoute à la recherche sur Internet. En effet, il n'y a pas d'uniformisation des modes de recherches ce qui complique beaucoup les choses. Les formations permettent de faire connaître les meilleurs sites juridiques disponibles afin d'éviter de perdre son temps inutilement. Le programme de formation devra être constamment mis à jour afin de refléter les nouveautés qui ne cessent d'apparaître sur Internet. Conclusion[41] Le CAIJ est donc un organisme qui a pour mandat d'intégrer et de distribuer l'information juridique aux professionnels du droit par ses réseaux physique et virtuel. Grâce à son service de recherche, il assure à sa clientèle une information juridique pertinente quant à ses dossiers. Dans quelque temps, il verra à sa formation pour la rendre plus performante dans l'utilisation des outils électroniques. Le but du CAIJ est que son acronyme soit perçu non seulement comme un courtier en information mais aussi comme la clef d'accès à l'Internet pour les professionnels du droit. Cependant, son rôle s'arrête là. Le CAIJ a le rôle d'intermédiaire entre l'Internet et les praticiens. Ceux-ci devront cependant étudier l'information qui leur sera fournie, comprendre le processus législatif, l'importance d'une décision dans la place de la jurisprudence et suivre l'évolution des concepts juridiques. [42] Une question subsiste : l'intégration des ressources par le CAIJ et la tendance à la concentration de l'information juridique forceront-t-elles les fournisseurs à être plus rapide dans la mise en disponibilité de cette information? [1] Daniel POULIN, Frédérick PELLETIER et Bertrand SALVAS, « La diffusion du droit canadien sur Internet » , (2000) 102 R. du N. 189, 218. [2] Mae M. CLARK et Donna ALSBURY, « Back to the Future : Predicting Materials Costs by Analysing Past Expenditures » , (2000) 92 Law Lib. J. 147. [3] URL : www.law-lib.utoronto.ca/resources/locate/j4htm#m [4] D. POULIN, F. PELLETIER et B. SALVAS, loc. cit., note, 231. Voir art. 10 Loi de la refonte des lois et des règlements, L.R.Q., c. R-3 et art. 9 (4) Loi sur la révision des lois, L.R.C. (1985), c. S-20. [5] Copeland c. Smith, [2000] 1 All E.R. 457 (C.A.): "Where an advocate holds himself out to be competent in a particular field of law, he must bring and keep himself up to date with recent authority in that field". 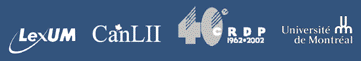 |