
La mise à niveau des infrastructures juridiques pour assurer la liberté des choix technologiques : l'expérience québécoises Jeanne Proulx [1] L'exposé a montré que pour assurer la sécurité juridique et la liberté des choix technologiques à tous les membres de la société québécoise, deux étapes s'imposaient. Tout d'abord, l'élaboration du cadre juridique québécois des technologies de l'information et, ensuite, la levée des obstacles à l'utilisation des technologies de l'information, qui peuvent encore subsister dans le corpus législatif, par la vérification de l'application, dans chacune des lois, des principes fondamentaux du cadre juridique québécois des technologies de l'information. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information[2] La première étape vers cette liberté de choix technologiques a été réalisée avec l'adoption de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q. 2001, c. 32) mise en vigueur le 1er novembre 2001. Cette loi, comme son titre l'indique, est un cadre juridique, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas créer un droit nouveau déconnecté de notre réalité juridique. Elle a plutôt pour objet et pour effet d'intégrer les technologies de l'information dans notre droit. En d'autres termes, elle encadre les technologies de l'information en leur permettant d'être régies par notre droit, de manière à continuer d'offrir aux citoyens les mêmes protections juridiques, quel que soit le support ou les technologies au moyen desquels ils choisissent de communiquer. [3] Comment a-t-on pu réaliser cette harmonisation juridique ? En s'appuyant sur les principes de l'équivalence fonctionnelle et de la neutralité technologique mis de l'avant, au niveau international, par la Commission des Nations Unis pour le droit commercial international. Combinés, ces deux principes conduisent en outre à la neutralité juridique. En effet, si l'utilisation de différents supports ou de technologies permet d'obtenir des résultats équivalents, à savoir des documents porteurs de la même information, les mêmes règles de droit devraient s'appliquer à l'égard de ces documents qu'ils soient technologiques ou papier. Ainsi, de l'application de ces principes fondamentaux de neutralité et d'équivalence découle l'interchangeabilité des supports des documents et la liberté des choix technologiques. [4] Dans un tel esprit, il ressort que la valeur juridique d'un document ne tient pas au fait qu'il soit porté par un support déterminé, mais qu'elle s'apprécie en regard du fait que le document présente la qualité que recherche le droit et qui fonde sa quête de vérité et de justice, à savoir la qualité d'intégrité. Ainsi, la loi précise que l'intégrité du document est assurée lorsqu'il est possible de vérifier que l'information du document n'est pas altérée, qu'elle est maintenue dans son intégralité, que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. [5] En conséquence, lorsque le document présente cette qualité d'intégrité, la loi lui reconnaît la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support. Cependant, si le support ou la technologie ne permettent pas d'affirmer ou de dénier que l'intégrité du document est assurée, ce qui peut être le cas lorsque le document est en quelque sorte « volatile » , le document se verra reconnaître une valeur juridique relative. La loi précise, à ce sujet, qu'un tel document technologique pourra être admis en preuve et servir de commencement de preuve. [6] En appliquant le principe d'équivalence, le législateur a pris acte des possibilités d'altération des documents qu'offrent les technologies de l'information. Si ces dernières apportent toute la souplesse nécessaire au traitement de l'information. En revanche, la qualité d'intégrité n'est pas nécessairement assurée au document et, même si elle l'était au moment de la réalisation du document, il ne peut plus être tenu pour acquis que le document la conservera. C'est pourquoi, la loi requiert que l'on puisse vérifier la présence de cette qualité d'intégrité durant tout le cycle de vie du document, de manière à pouvoir déterminer la valeur juridique du document tout au long de son cycle de vie, à savoir depuis sa création jusqu'à sa destruction, en incluant les phases de transfert de l'information ainsi que celles de consultation et de transmission. [7] La loi prévoit ensuite que deux documents dont l'intégrité est assurée et porteurs de la même information peuvent être utilisés aux mêmes fins, simultanément ou en alternance, dans la mesure, certes, où ils respectent les mêmes règles de droit. Concrètement, il s'ensuit, premièrement, que différentes personnes peuvent utiliser la même information sur des supports différents et les documents qui en résulteront pourront avoir la même valeur juridique. Deuxièmement, il est possible d'observer que la valeur juridique des documents est prévisible et que le législateur, en indiquant comment l'évaluer en fonction de la qualité d'intégrité, laisse les citoyens libres de choisir, en fonction de leurs besoins et de leurs moyens, le support ou la technologie qui convient le mieux pour porter l'information qu'ils veulent communiquer par le biais d'un document technologique. Troisièmement, avec cette législation, il devient clair que les supports des documents sont interchangeables, et que la loi atteint ainsi l'objectif d'assurer la liberté des choix technologiques. Finalement, un constat s'impose, la notion d'intégrité du document mise de l'avant par cette loi constitue un véritable « cadre » dans lequel s'insère le document et les autres règles de droit auxquelles il doit dorénavant répondre quel que soit son support. L'intégration des principes de neutralité et d'équivalence fonctionnelle dans la législation[8] La seconde étape vers la liberté de choix technologiques, celle actuellement en cours de réalisation, consiste d'abord à vérifier, dans le corpus législatif, si des textes législatifs requièrent l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifiques et, ensuite, à déterminer s'il convient d'en assurer la neutralité ou de créer une équivalence fonctionnelle avec les façons de faire traditionnelles. [9] L'application judicieuse des principes de neutralité et d'équivalence dans un texte législatif requiert également une réflexion sur un des impacts majeurs des technologies de l'information, à savoir la modification de nos rapports avec l'espace et le temps. Un constat s'impose : l'effort de contraction du temps et de l'espace s'inscrit dans une tendance amorcée depuis des siècles. En somme, s'il y a beaucoup de nouveaux instruments, les fonctions qu'ils doivent remplir sont sensiblement les mêmes que l'on veut remplir avec les instruments employés jusqu'à présent. Il convient de noter à cet égard que, depuis des millénaires, les recherches de nouvelles technologies répondent au même besoin de communiquer, que ce soit pour des fins commerciales, politiques ou personnelles, plus rapidement, avec plus de personnes, situées du plus près au plus loin, le tout en moins de temps et en allégeant la matière. Les technologies de l'information ne sont qu'une autre réponse à cette longue quête visant l'allégement de la matière et l'accélération de sa vitesse de transport pour en assurer la communication. Elles devraient donc prendre sa place avec les autres façons de faire existantes, comme l'envoi de lettres, rédigées sur de l'ardoise, du bois, de la cire, du papyrus, du papier, du plastique, etc. et transportées par messager à pied ou à cheval, par poste terrestre, bateau, train, avion monomoteur ou supersonique, laser etc. [10] Un bref examen des textes législatifs montre immédiatement les traces de l'évolution technologique et en particulier l'importance du papier et du courrier. Plusieurs obligations prévues dans les lois consistent en la description de moyens à prendre, à la lecture desquels moyens on peut déduire le résultat recherché par le législateur. Dans un esprit de liberté de choix technologiques, cette façon de rédiger doit être remise en question, car elle oblige à ne recourir qu'au seul moyen décrit dans la disposition législative, alors qu'il pourrait y en avoir d'autres qui permettent d'obtenir le même résultat. [11] Par ailleurs, il ne conviendrait pas davantage de réviser les lois pour y inscrire des listes de technologies ou pour les compléter, car il serait ainsi très difficile de suivre l'évolution technologique. Le droit serait en quelque sorte à la remorque des divers courants technologiques, au lieu de participer à leur définition en précisant les objectifs que ces instruments devraient atteindre pour maintenir le niveau de sécurité juridique que tous recherchent. Par contre, une rédaction neutre au plan technologique devrait pouvoir donner ouverture à l'utilisation par le citoyen des moyens qu'il estime le plus approprié pour répondre aux exigences que le législateur lui indique dans la loi, en y énonçant le résultat à atteindre plutôt qu'en lui fournissant la description des moyens à prendre pour atteindre ce résultat. [12] De plus, pour conserver la liberté de choix technologiques, il faut prendre garde de rédiger les dispositions législatives à l'aide de termes ou d'expressions pris dans un sens technique, comme c'est malheureusement le cas avec les notions par exemple de « signature numérique » ou « d'authentification » . C'est pourquoi, les solutions rédactionnelles recherchées devraient viser à conserver leur sens ordinaire aux termes employés dans la législation. Finalement, avec la rédaction de textes législatifs mettant l'accent sur les résultats recherchés, plutôt que sur les moyens, et avec une législation faisant appel au sens ordinaire des termes, il pourrait s'ensuivre un allégement réglementaire et une simplification du langage juridique importants, souhaitables et attendus. 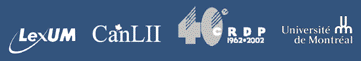 |