
De l'intégration de systèmes divergents au dossier électronique Ivan Verougstraete Introduction[1] Le cadre légal nécessaire pour intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le droit judiciaire a été partiellement adopté par le parlement. Une loi du 20 octobre 2000 a pour objet d'introduire les moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire. Une loi du 9 juillet 2001 contient certaines règles relatives au cadre juridique de la signature électronique et des services de certification. Ces lois constituent en partie l'exécution de directives européennes, et notamment de la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999. [2] Ces textes permettent certes d'envisager l'intégration accrue de nouvelles technologies dans la procédure civile et pénale mais ne constituent pas un passage vers une mode électronique de procédure. Cela avait été envisagé par le gouvernement qui avait favorisé la constitution d'un groupe d'experts qui avait tracé, sur le plan de la procédure civile, les contours d'un véritable dossier électronique[1]. Le gouvernement ne semble, vu la proximité des élections, plus guère poursuivre cette voie pour l'instant. [3] L'évolution se poursuit par contre sur le plan pratique. Les promoteurs des adaptations techniques travaillent sans doute en ayant en tête un vaste projet de dossier électronique, tant pénal que civil et de fonctionnement des cours, tribunaux et parquets sur le mode électronique, mais l'absence de référence à un cadre légal suffisamment précis rend cet exercice périlleux. [4] Les quelques commentaires qui suivent seront plus des descriptions des adaptations techniques du fonctionnement de la justice que de descriptions d'un nouveau régime électronique des procédures. La situation jusqu'en l'an 2001[5] Les investissements en informatique consentis par le gouvernement belge depuis 1990 ont été caractérisés par leur caractère désordonné et autoritaire, en ce sens que l'administration les a plus ou moins imposés aux juridictions. Treize applications ont été conçues : elles sont différentes entre elles selon le type de juridiction et dès lors incompatibles. Ces applications étaient devenues horriblement chères à entretenir (certaines fonctionnaient encore en WP 5.1...) et étaient en outre peu conviviales. [6] L'idée est venue de convertir tous ces systèmes en un seul système de base, avec des adaptations pour autant que les procédures spécifiques ou la juridiction les rendent opportunes. [7] Un projet cogéré par le pouvoir judiciaire et par le département de la justice connu sous le vocable Phenix a été lancé et a atteint en octobre 2002 sa vitesse de croisière. Les premiers effets sur le terrain devraient être perceptibles en 2003. Le projet PhenixLa centralisation des données[8] Après quelque hésitation, les promoteurs du projet ont opté pour une centralisation poussée des données. La banque de données centralisée paraît plus facile à surveiller et entretenir. Les problèmes d'archivage semblent également plus simples. [9] Le contrôle et la gestion des codes sera centralisé. [10] Les données venant de partenaires extérieurs entreront par un seul canal électronique (liste d'avocats, d'huissiers de justice, d'experts, d'inscriptions au registre de commerce). Les données provenant de la police fédérale pourraient également entrer par ce canal unique. Des logiciels harmonisés et du matériel uniforme[11] La centralisation implique l'acquisition de deux mainframe (un servant de sécurité). Le petit matériel (serveurs d'application, PC avec Windows Office 2000 et Word) sera progressivement harmonisé et distribué et renouvelé à périodicité fixe. [12] Les divers programmes utilisés seront donc les mêmes et les interfaces également (browser interne Netscape ou Explorer). [13] L'effort porte sur l'acquisition de logiciels que les membres du pouvoir judiciaire pourront eux-mêmes développer sans crainte de droits que le créateur du logiciel puisse faire valoir ou frais de licence excessifs . Workflow[14] Une partie importante du travail d'analyse, achevée actuellement, a été d'analyser les fonctionnalités existantes dans les juridictions et d'en assurer le maintien dans la nouvelle application (en cherchant la meilleure solution notamment parmi les diverses applications existantes). Les propositions faites de nouveaux écrans sont actuellement à l'examen des divers utilisateurs. [15] Le concept de base a été celui d'une introduction unique d'une affaire en début de chaîne (et de l'attribution d'un numéro séquentiel) qui est ensuite enrichie au cours des différentes phases du parcours du dossier. Les données recueillies doivent en outre permettre d'assurer le suivi statistique des affaires. L'irruption des tiers ; la sécurité[16] Tant que le système reste entièrement en circuit fermé et n'implique que les acteurs immédiats du pouvoir judiciaire, peu de problèmes de confidentialité pouvaient naître. [17] Dès le départ il a toutefois été opté pour que certains tiers puissent au moins alimenter certains éléments du dossier. Ainsi les avocats pourront, en principe encore cette année-ci, déposer leurs conclusions par voie électronique sur des pages web. Les accords doivent encore être pris en ce qui concerne l'authentification et la signature numérique. Les avocats devront se conformer aux exigences formulées par le système Phenix. Cette possibilité se heurte toutefois, au-delà des simples questions d'authentification et de signature, à certaines exigences légales qui pour l'heure ne sont pas remplies. [18] Par ailleurs, la loi permet en principe au greffier de notifier des documents, et tout particulièrement les plis judiciaires, par voie électronique (article 32, 2 ° , du Code judiciaire). Pour que cette notification soit valable les greffiers doivent disposer d'une signature numérique. Ce sera fait en 2002. Mais la loi contient encore une exigence, qui n'a pas été modifiée : le pli judiciaire doit être remis par la poste à la personne du destinataire, qui est invité à signer un accusé de réception (article 46, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire). [19] Ces premiers frémissements de ponts vers des tiers, que ce soit pour envoyer des documents et donc en acter la réception, ou en recevoir, a nécessairement alimenté la réflexion sur la sécurité. Ce point a été d'autant plus examiné que, cette fois sur le plan pénal, des liens sont négociés avec le système de la police fédérale notamment pour reprendre les procès-verbaux initiaux ou pour transmettre les apostilles des membres du parquet ou des juges d'instruction à la police fédérale. Le cloisonnement est dans de telles conditions impératifs. [20] L'information sera la plus transparente possible, en ce sens qu'en règle, le public y compris, puisse avoir accès à tout. Un certain nombre d'informations ne sera accessible qu'en interne et encore un plus petit nombre sera réservé à un petit nombre d'acteurs. La délimitation de ces cercles est fort complexe. La gestion des accès individuels (tant pour prendre connaissance des données que pour pouvoir les transformer)sera délocalisée. [21] Un système d'authentification forte sera mis en place pour tous les membres du pouvoir judiciaire (avec en outre une signature numérique pour les magistrats et les greffiers). Développements induitsTélétravail[22] La possibilité d'un accès à distance pour les utilisateurs internes (magistrats et greffiers) a été tout de suite envisagée. Le télétravail sera encouragé dans certaines limites. [23] Il est acquis que les travailleurs à domicile, magistrats et greffiers, seront reliés par un réseau privé virtuel, à l'application. La firme Belgacom, l'ancien opérateur historique, fournira l'accès. Les PC individuels des magistrats seront configurés de façon appropriée par Phenix. [24] Il est à noter que pratiquement tous les magistrats et greffiers peuvent avoir accès à une liaison par câble de télédistribution ou par une liaison ADSL. Courrier électronique[25] Alors que jusqu'à maintenant le courrier électronique passait par des serveurs opérés au Ministère de la Justice, dès l'acquisition de l'outillage nécessaire, le courrier sera intégré dans le système Phenix. Documentation[26] Le pouvoir judiciaire a créé des sites webs pour pratiquement toutes les juridictions, et ce sous l'impulsion de la Cour de cassation. Les décisions des différentes juridictions arrivent directement sur le web par une procédure vraiment simple. Cinq minutes suffisent pour mettre un arrêt sur le web encodage compris. Le seul problème, non résolu, est celui d'une indexation ou d'un thesaurus convenable pour les milliers de décisions qui afflueront bientôt. [27] D'autres informations pourront être lues sur les sites webs notamment les versions électroniques des revues (moyennant clef d'accès), les inventaires des bibliothèques du pouvoir judiciaire et la législation belge. Statistiques[28] L'intérêt de pouvoir déduire des statistiques de l'application est évident. Les données qui sont relevées et ajoutées à l'application par les acteurs permettent aisément de déduire certaines données concernant l'activité même d'individus. Il a été décidé, tant pour des motifs de principe que de coût, de ne pas inclure la possibilité de time sheet intégrés dans le système. [29] Une discussion serrée a démontré que l'inclusion de trop nombreuses variables dans les données à inscrire par les greffiers lors du traitement des affaires ralentissait les procédures et était souvent hors proportion avec l'intérêt des données recueillies. Le dossier électronique[30] Ce qui précède sont des étapes nécessaires vers le dossier électronique complet. Un consensus existe pour passer à ce stade dans un délai relativement bref, mais aucune unité de vue n'existe pour l'instant sur la façon de le mettre en vigueur. [31] Plusieurs obstacles de nature juridique existent. Il faudra légiférer et si des avant-projets sont prêts, le Ministre de la justice belge ne semble pas désireux de les faire voter à brève échéance. [32] L'idée en elle-même d'un dossier électronique qui se composerait par l'activité même de ceux qui le nourrissent, qui serait consultable de partout pour ses éléments essentiels et qui prendrait lui-même par la main, le greffier et le juge en les aidant pour la marche à suivre, fait lentement son chemin. [33] La voie que le législateur semble vouloir suivre semble être celle des petits pas. En principe- et la chose vaut également en droit privé- le parlement semble vouloir admettre que les documents électroniques peuvent dans la plupart des circonstances offrir autant de garanties que des documents papier pourvus d'une signature manuscrite. La transition concrète vers la solution des dizaines de questions posées n'a pas encore été faite. [34] Un consensus politique existe notamment pour l'introduction des affaires par voie de requête électronique mais les textes requis ne sont pas encore déposés. Vie privée et cadre légal[35] La centralisation des données et les problèmes de confidentialité évidents ont mis en lumière la nécessité de donner un cadre légal à la mise en place et au maintien d'une application. L'ordre judiciaire veut exercer le contrôle sur le système, fût ce avec l'assistance des fonctionnaires, et ce notamment pour assurer le respect de la vie privée. Cette question fait l'objet de discussions intenses avec les autorités gouvernementales. [36] Un organe de contrôle composé de magistrats devrait, dès que le système est mis en place, décider de la façon dont les données doivent être conservées et protégées, de la façon dont le respect de la vie privée doit être assuré ainsi que des limites à la communication des données aux tiers (y compris le ministre de la justice, considéré comme un tiers). [1] Les travaux sont disponibles à l'adresse : http://www.droit.fundp.ac.be/e-justice/documents. Voir aussi Vincent Lamberts et Laurent Guinotte, « Projet e-justice » , Actualités du droit 2002,47-126 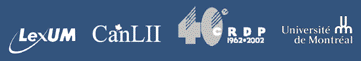 |